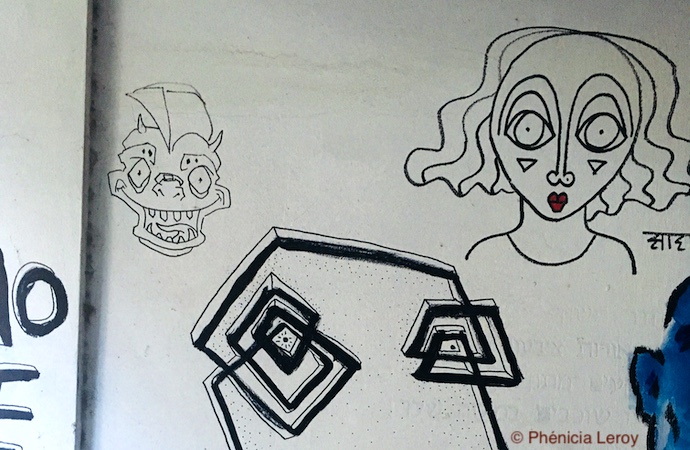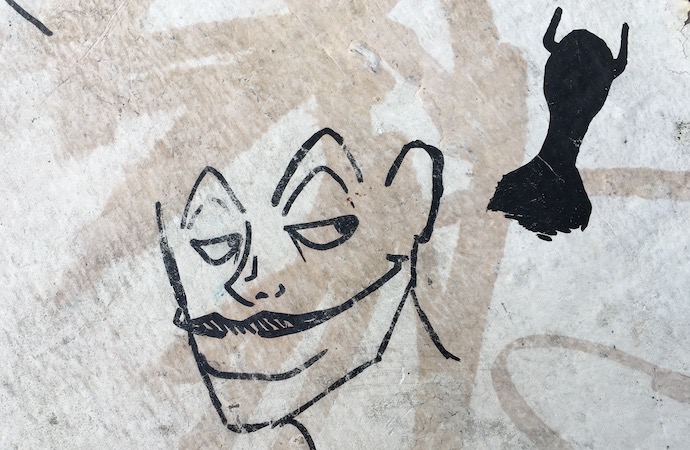CHRONIQUE DU MALAISE : De la civilisation et de la guerre – 3. Retour de la guerre, retour du corps
« La politique comme technique de la co-présence des corps est [...] mise à mal par la révolution technologique qui [lui] substitue la co-présence du virtuel. »
Lire la suite