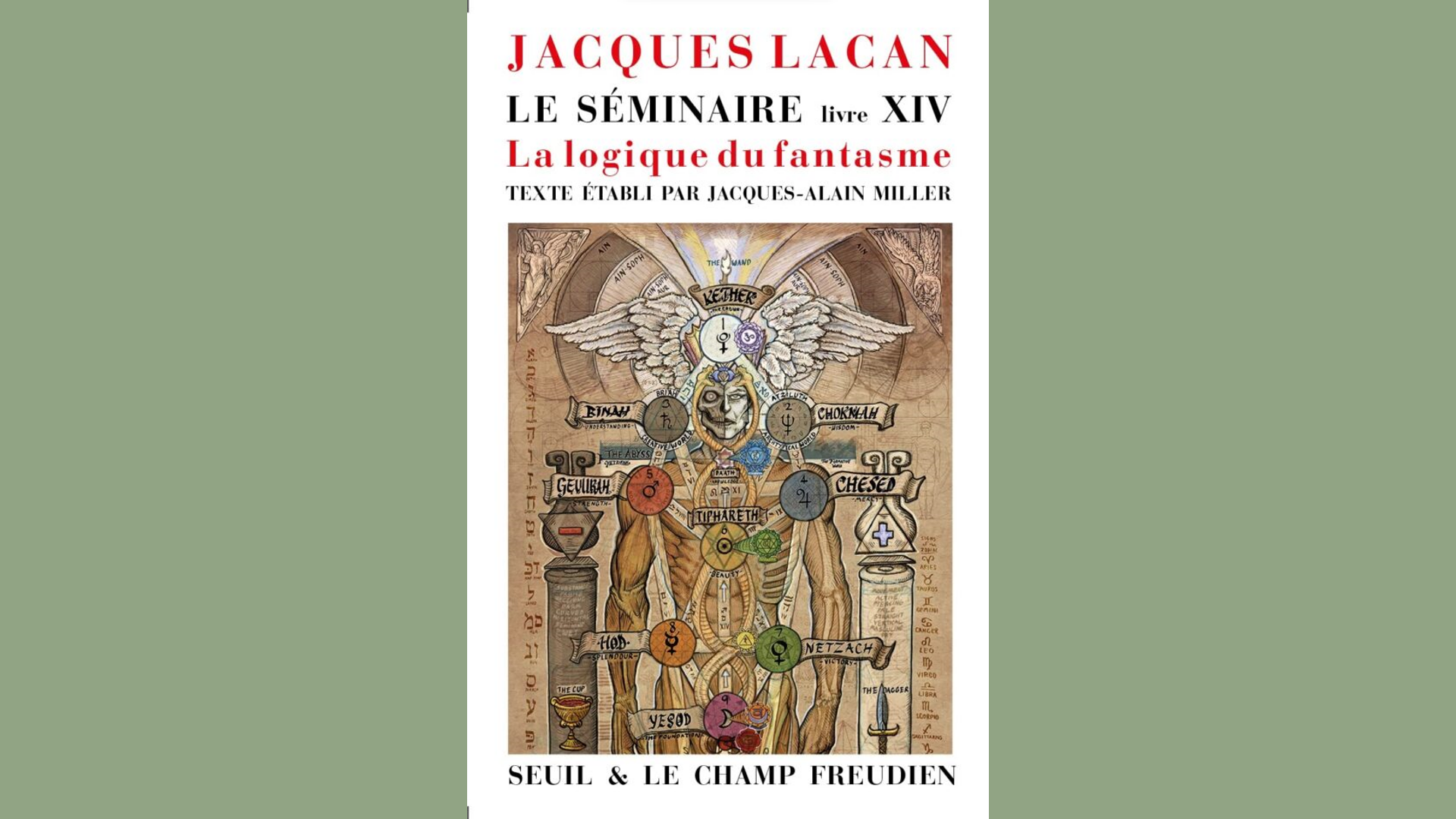Dans la leçon du 20 décembre 1961 du Séminaire « L’identification », Lacan aborde la question du nom propre. Il exprime son désaccord avec Russel pour lequel le nom propre n’est que le « word for particular », sorte d’étiquette pour ce qu’on désigne. Mais le nom n’est pas seulement un son (« Gardiner »), un signifiant sans signifié, puisque, comme il le rappelle, beaucoup de noms, à l’origine, signifient quelque chose, par exemple un métier (« Meunier »,…).
Dans cette leçon, Lacan insiste sur la façon dont se fait le passage au symbolique. Il reprend le petit Hans qui après avoir dessiné les girafes, froisse le dessin (zerwutzeln) et s’assoit dessus. Il donne ainsi un autre statut à sa production. Dans la langue allemande, le mot « besitzen » est équivoque, il signifie « posséder », mais aussi littéralement « s’asseoir dessus » (sitzen = être assis). Ce dont il est question c’est « l’apparition du symbolique comme tel » [1], nous dit Lacan. On y voit apparaître « les deux extrêmes du sujet, le sujet animal [et] quelque chose sur une surface de papier ». Quelque chose du signifiant vient « s’insérer radicalement » dans « l’individualité vitale » [2]. Ce dont il est question, c’est de « l’identification fondamentale » [3], symbolique, qui permet au petit Hans de se soustraire à l’emprise maternelle. Elle constitue ce « minimum d’ancrage, de centrage de son être » qui lui permet ensuite de constituer sa phobie, qui se réfère au signifiant cheval. Loin d’être une étiquette pour une chose, le nom propre est donc en rapport avec la fonction du signifiant, avec cette marque symbolique que le sujet reçoit du langage, et qui lui donne « un point d’amarre » [4]. Le signifiant « cheval » devient une sorte de signifiant « propre à tout faire » [5].
La marque est le traitement de la jouissance par le symbolique. Lacan donne le fameux exemple des entailles sur les côtes d’antilope préhistorique du Mas-d’Azil qui l’ont impressionné. La jouissance passe à la comptabilité, mais ensuite le trait devient le support de la sonorisation et de la voix.
James Février [6] montre le passage de la représentation par idéogrammes qui sont des réductions d’images (la plus connue est celle de la tête de taureau à l’origine de la lettre A) à l’usage des lettres pour noter un son. Ici aussi, il s’agit de l’interface de l’imaginaire avec le symbolique. À l’origine les traces écrites servent surtout à la comptabilité : par exemple, à représenter le nombre de têtes de bétail d’un propriétaire ou d’une transaction. L’écriture hiéroglyphique égyptienne est un mixte des deux qui permet de repérer ce passage : certains glyphes représentent encore l’image, là où d’autres viennent pour le son qu’elles représentent. Lacan explique que le trait de l’écriture précède le son qui vient s’y inscrire. L’écrit, loin d’avoir un simple statut de transposition du dit, a donc une fonction en rapport avec la marque du symbolique et le traitement de la jouissance. Cette marque qui se retrouve aussi dans les pratiques de scarification rituelle ou certains tatouages vient représenter cet effet du symbolique sur le corps.
Le nom propre ne constitue donc pas seulement une étiquette pour désigner (comme le « this » de Russel), mais a une relation étroite avec le symbolique et la mise en fonction du sujet. C’est un invariant. La question que soulèvent les avatars du nom propre, c’est de porter atteinte à cette identification fondamentale.
Jérôme Lecaux
_____________________________
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre IX, « L’identification », leçon du 20 décembre 1961, inédit.
[2] Ibid. : « C’est donc dans cet accolement structural de quelque chose d’inséré radicalement dans cette individualité vitale avec cette fonction signifiante ».
[3] Ibid. : « Ce dont il s’agit, si c’est bien de son identification fondamentale, de la défense de lui-même contre cette capture originelle dans le monde de la mère ».
[4] Ibid. : « La fonction du signifiant, en tant qu’elle est le point d’amarre de quelque chose d’où le sujet se continue ».
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1994, p. 289.
[6] Février J.G., Histoire de l’écriture, Paris, Payot & Rivages, 1984.