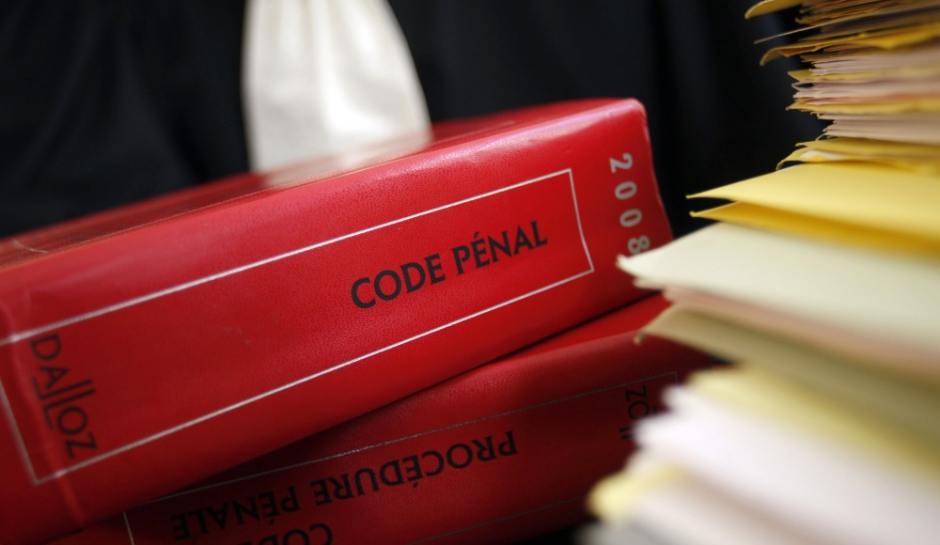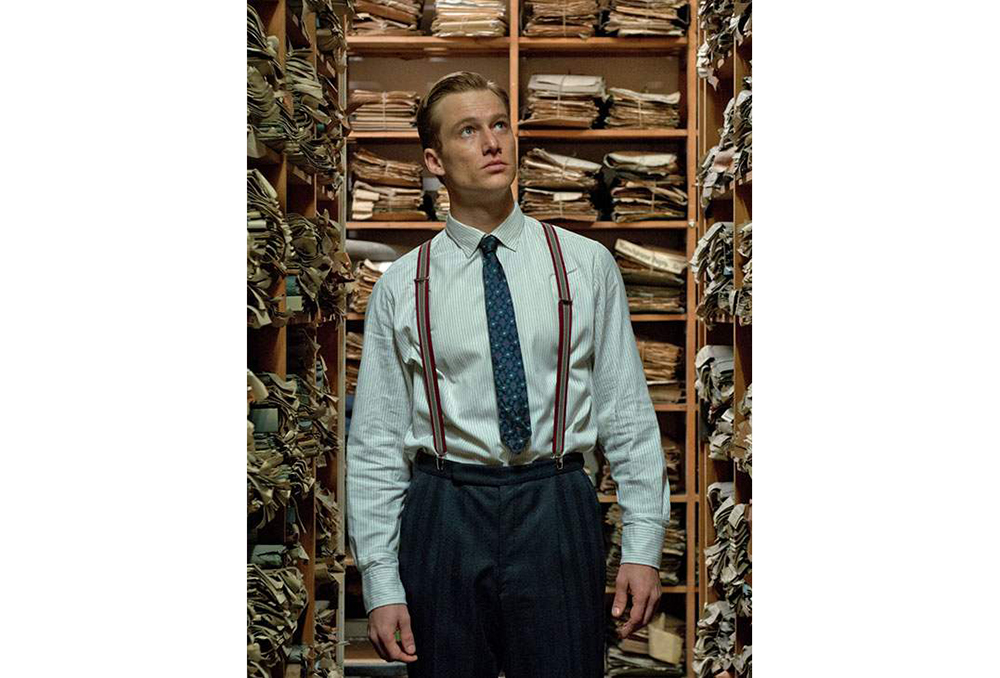Mlle D., jeune femme de vingt-deux ans, s’est adressée au CPCT suite à un dépôt de plainte contre son frère pour violence. Les entretiens au CPCT se déroulèrent entre l’instant du dépôt de la plainte et le moment du verdict du juge. Ainsi, précédant l’audience publique au tribunal, Mlle D. est venue parler en privé au CPCT. Ces entretiens accompagnèrent une attente et une incertitude angoissantes quant à la future décision du juge. Pendant ces quatre mois, Mlle D. est venue traiter quelque chose de son acte, assumé mais hésitant, qui l’avait ébranlée : « Ai-je eu raison de porter plainte ? Parfois J’ai l’impression que tout ça n’a servi à rien. […] Est-ce que mon frère va changer après ça ? […] Tout ça m’a marquée ».
La marque, il a fallu qu’elle la voie sur son visage dans l’image du miroir, il a fallu que sa mère soit très loin, quelque part en vacances, pour qu’elle ose faire le pas d’aller à la police et cesser d’être l’objet de son frère.
Lorsque je la rencontre, son frère, d’un an son cadet, n’a pas le droit de l’approcher jusqu’à la décision du juge, et il est parti habiter alors chez son père. « J’en suis soulagée, enfin j’ai une vie un peu normale, je suis moins tendue », dit-elle, tout en décrivant un quotidien infernal avec son frère, et ceci depuis qu’elle est enfant.
Elle habite donc depuis peu seule avec sa mère qui est ambivalente quant à la procédure entamée, considérant que cette dernière exagère et banalise la situation. Son frère ne comprend pas non plus. Cette banalisation ambiante procure à Mlle D. un sentiment intermittent de folie, est-elle vraiment en train d’exagérer ? Est-ce que quelque chose lui échappe ? Oui, nous pouvons supposer que quelque chose de la loi échappe dans le discours familial, et que Mlle D. se voit donc poussée à faire appel à celle-ci, là où elle fait défaut. Elle fait appel à un tiers qui ne banalise pas son dire, d’abord la justice puis la psychanalyse.
À ce sentiment de folie, je m’oppose en légitimant sa souffrance, en la croyant, en prenant très au sérieux son dire. Car « dire », voilà qui lui a toujours posé problème : « Je n’arrive pas à dire ce que je pense et ça va me porter préjudice. » Elle met en lien l’échec de son dernier stage avec son impossibilité à dire. On lui aurait reproché « de ne pas être assez extravertie ». De même dans ses relations amoureuses : « Je n’arrive pas à dire ce que je pense de peur d’être rejetée, je n’ai rien à dire d’intéressant. » Pour ajouter plus tard : « Il n’y a qu’ici que je peux parler de mon frère, ailleurs ce n’est pas possible […] j’ai honte ». Nous pouvons poser l’hypothèse qu’elle ne peut dire car l’horreur propre au réel du lien à son frère l’empêche de trouver un lieu d’énonciation dans l’Autre qui ne passe pas par la honte de ce réel familial. L’énonciation reste problématique, pointant une difficulté dans le registre symbolique.
Mais une des solutions possibles qu’elle a trouvée pour voiler ce réel passe par l’image, « contrôler par l’image ce que je ne peux contrôler ailleurs », dira-t-elle. Mlle D. est une belle femme, toujours très bien habillée, qui aime le cinéma asiatique et veut en faire son métier (s’occuper de la distribution de films en France). Pourquoi le cinéma asiatique ? « Car j’aime son esthétique », c’est tout ce qu’elle peut en dire.
Une autre solution, qui traite plus directement ce réel, est la découverte assez récente d’une passion pour la boxe, activité à laquelle elle consacre beaucoup de temps et qui lui permet de se « défouler », car, elle l’aura avoué en filigrane lors d’un de nos entretiens : « Mon frère me rend violente. »
Mlle D. aimerait que « ça aille vite et que tout ça soit fini » : laisser derrière ses soucis avec son frère, terminer ses études et trouver un travail, d’où ses multiples activités. Son école privée de cinéma lui prend tout son temps, promesse de bonheur qui lui a valu l’emprunt de huit mille euros. Le soir et le week-end elle s’attelle à des jobs d’étudiante et prépare son permis de conduire. Ses difficultés à dire ne l’empêchent pas de faire, cette sorte « d’hyperactivité » l’épuise, mais peut s’expliquer par des coordonnées familiales peu rassurantes : « En fait j’ai peur d’être comme mon père, il est alcoolique, n’a jamais vraiment travaillé, s’est endetté puis s’est déclaré insolvable […] et mon frère il est comme mon père, il ne fait rien, il ne fait aucun effort, j’ai l’impression que ses problèmes sont fabriqués ».
C’est du côté de la mère, femme qui travaille, qu’elle peut dans une certaine mesure trouver un point d’appui identificatoire.
Mlle D. pense que seul l’éventuel retour de son frère à la maison pourrait venir perturber ses projets, elle constate bien que l’apaisement de l’angoisse depuis son départ lui permet de mieux travailler. Le juge l’aidera dans son sens : le verdict finalement prononcé contre son frère sera de six mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve avec interdiction d’approcher sa sœur.
Mais le traitement au CPCT lui permettra tout de même de constater que tout ne va pas si vite : « Je pensais que tout ça c’était un problème de mon frère, mais je vois que ça m’a marquée plus que je ne l’imaginais. »
Mlle D., malgré son emploi du temps chargé, a quand même su trouver le temps de faire une pause pour venir parler au CPCT. Elle a rencontré un Autre qui l’a crue, qui lui a précisé qu’elle pouvait dire et a donné valeur à sa parole. Elle est repartie en me disant qu’elle serait très occupée dans les mois à venir, mais en me demandant si, de manière ponctuelle, elle pourrait me rencontrer si elle en « ressentait le besoin ».
De notre côté reste en suspens une question qui ne se réglera pas en seize séances. Je ne sais toujours pas si « elle n’a rien à dire » ou si « elle ne peut pas dire ce qu’elle pense », pour reprendre deux de ses formulations, renvoyant l’une à un vide et l’autre à une inhibition en lien à des coordonnées symboliques.





![Antigone : « Une victime si terriblement volontaire »[1] !](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/05/AlbertHD.jpg)