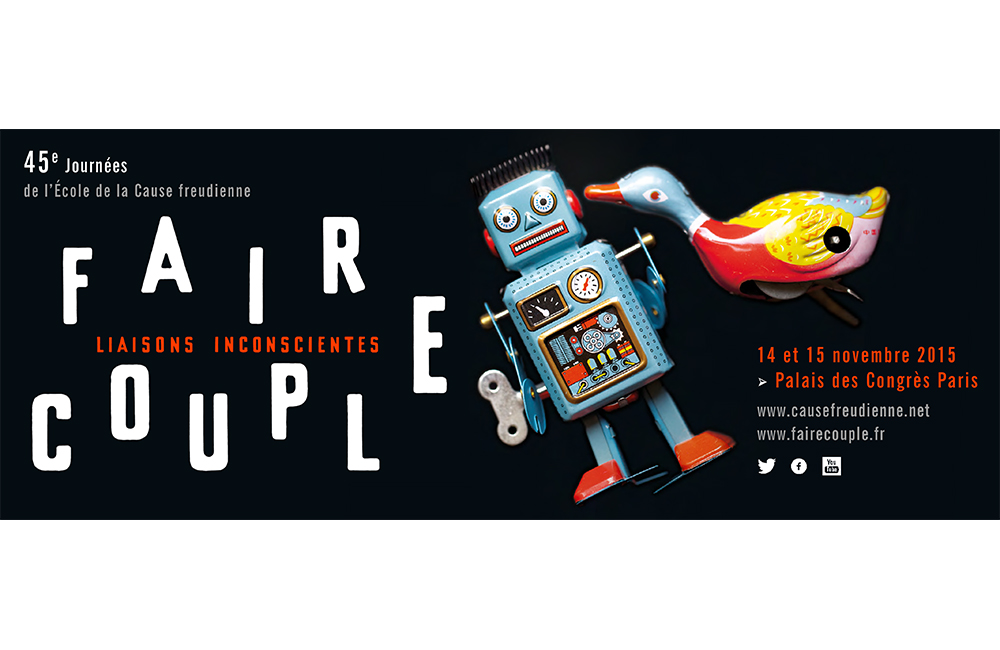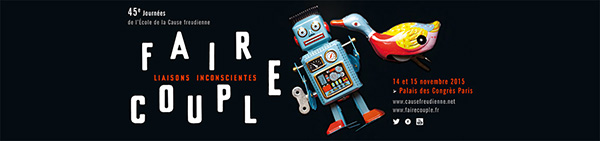Des traumatismes comme entraves au « faire couple »
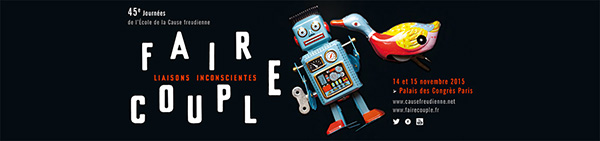
Lise, quarante cinq ans, belle, cultivée, très anxieuse, est venue en analyse peu après la mort de son père, professeur de théologie à l’université. Elle vit seule, n’a pas d’enfant et ne s’est pas mariée alors que c’était le but de son existence, son métier de journaliste étant secondaire pour elle. Elle me parle de son enfance, et d’un souvenir traumatique précis : alors qu’elle était âgée de sept ans, le jardinier de ses parents s’était masturbé devant elle. Elle n’avait rien raconté de peur que sa mère ne fasse un scandale qui nuirait à la femme de ce jardinier, qui était sa nourrice et qu’elle aimait beaucoup. Elle avait aussi gardé le silence quand ses frères aînés l’avaient forcée à des jeux sexuels, quelques années plus tard. Devenue adulte, elle n’a eu de relations qu’avec un metteur en scène alcoolique qui la battait, puis avec un ethnologue qui lui imposait une pratique sexuelle mortifiante pour sa subjectivité, lui rappelant de douloureuses piqûres que sa mère, infirmière, lui faisait pour une pneumonie à dix-huit mois. À cet âge, ses parents l’avaient mise dans un sanatorium où elle s’était crue abandonnée pendant plusieurs semaines. Elle a construit sa féminité en opposition à cette mère qui la terrifiait et en s’inspirant beaucoup de personnages de romans.
C’est de son père, très érudit et attentif à ses demandes, qu’elle s’était rapprochée depuis sa toute petite enfance, et même après qu’il eût commis une « faute » peu de temps avant l’agression du jardinier. Elle se promenait en pensant au mariage quand le fils du jardinier, petit garçon de son âge, était justement apparu au tournant d’une allée. Elle lui avait aussitôt demandé s’il voulait l’épouser et il avait acquiescé. Leurs mères jouant le jeu avaient organisé un goûter en guise de cérémonie. La mère de Lise lui avait cousu une robe blanche visible sur une photo qu’elle me montra avec émotion. La petite fille s’était crue mariée, mais hélas son père, provisoirement absent, avait démoli ce bel édifice imaginaire dès son retour après que la mère le lui eût raconté. Il avait fait mine de s’étonner : « Tu n’es pas avec ton mari ? Où est-il ? » Et il avait continué de plaisanter sans attendre sa réponse en faisant remarquer à la ronde sur un ton de reproche qu’elle ne « dormait pas la nuit dans un lit avec son mari ». Ses frères aussi se moquèrent d’elle. Se sentant humiliée et honteuse elle déclara ne plus jamais vouloir en parler. « Bien » avait maladroitement répondu le père, entérinant la blessure de son enfant.
Le lendemain, sa mère lui déclara sèchement qu’elle se marierait quand elle serait grande. Cet adjectif lui est resté comme une condition de son éventuel mariage. Elle se souvient que, dans son esprit d’enfant, ce dit de sa mère supposait qu’elle avait commis une faute en se mariant petite. Même à l’âge adulte, le doute subsistait : il lui arrivait encore de se demander si elle n’avait pas été vraiment mariée.
Lise dit que c’est son amour pour son père idéalisé qui l’a sauvé de l’autodestruction. Elle n’est pas suicidaire. Et bien que son père l’ait peu protégée de la dureté – attestée par certaines anecdotes qu’elle me raconte – de sa mère à son égard, il l’a soutenue dans ses études et a eu une fonction pour elle : le commentaire un peu trivial de son père à propos de son mariage entrave sa recherche d’un partenaire. On peut supposer que ce souvenir, qui met en scène le père, lui tient lieu de défense fantasmatique. Il voile le réel hors sens auquel elle est confrontée lors de la rencontre sexuelle. Avec ce souvenir, qu’elle reconstruit en analyse, elle parvient peu à peu à mettre un sens aux péripéties de sa vie amoureuse.
Grâce à son analyse, qui dure depuis plusieurs années, elle ordonne ses souvenirs, ce qui lui permet de commencer à lire les difficultés qu’elle rencontre. Ainsi, elle se souvient de certaines informations qui avaient révélé que la malveillance de sa mère remontait à l’époque où elle était enceinte de Lise. Soupçonnant son mari d’être attiré par une autre femme, elle l’avait rejeté ainsi que sa fille, sans pour autant s’en séparer car ses convictions religieuses le lui interdisaient. Elle avait souffert d’abandon, elle aussi, élevée par une tante loin de ses parents pendant une guerre. À partir du moment où, en séance, Lise parvient à cerner une volonté mauvaise de la part de l’Autre, son angoisse d’être abandonnée diminue. Elle peut répondre à sa mère et n’est plus confrontée à l’énigme du désir de l’Autre. Elle a des clés pour comprendre pourquoi l’Autre la quitte. Elle peut commencer à voiler, avec des semblants, le réel obscène qui faisait effraction dans sa vie.
Récemment Lise a eu une relation amoureuse sans violence et donc « normale » avec un homme qui lui plaisait, mais qui assez vite l’ennuya car elle le trouvait immature et insuffisamment cultivé. Ses ruptures amoureuses avaient toujours été torturantes pour elle car elle en pesait chaque fois le pour et le contre pendant des mois ou des années, l’abandon la terrorisant autant que la souffrance. Pour la première fois, au contraire, c’est elle qui a quitté. Elle a pu prendre l’initiative de la rupture, n’étant plus « celle que l’on abandonne ». Elle espère toujours une nouvelle rencontre pour « faire couple ». Elle a quitté, pour un autre journal, le magazine de mode où elle travaillait jusqu’ici. Elle est satisfaite d’y côtoyer des hommes. En effet ses collègues, auparavant, étaient surtout des femmes.
Lire la suite