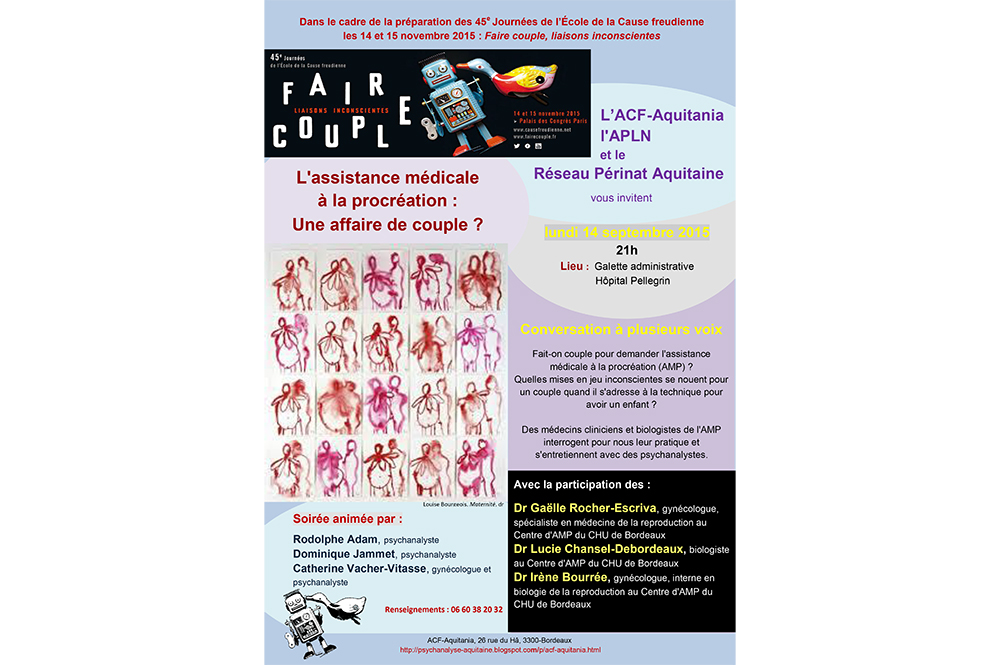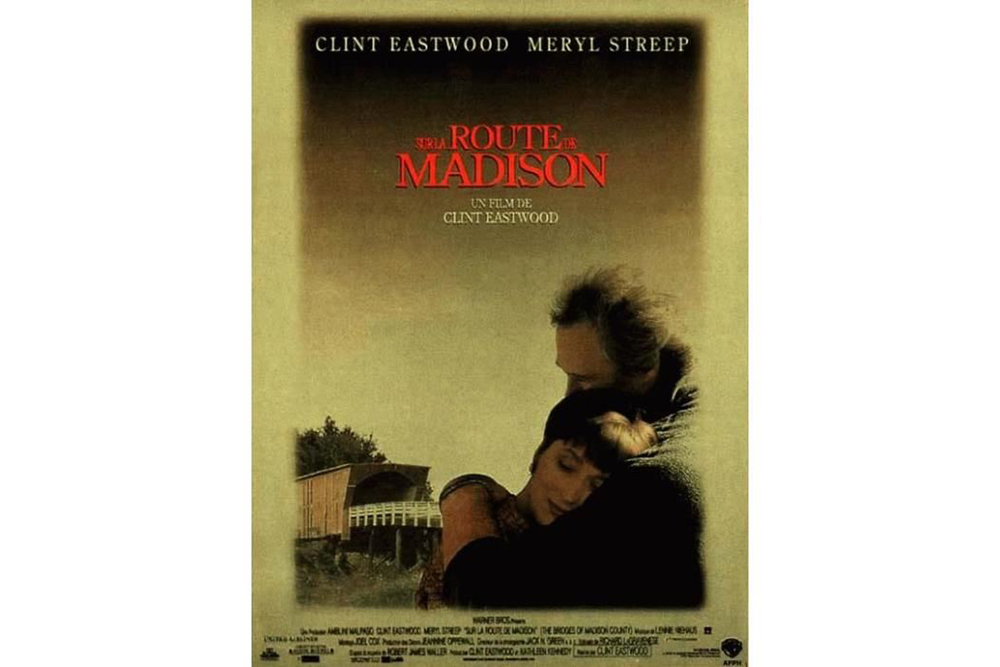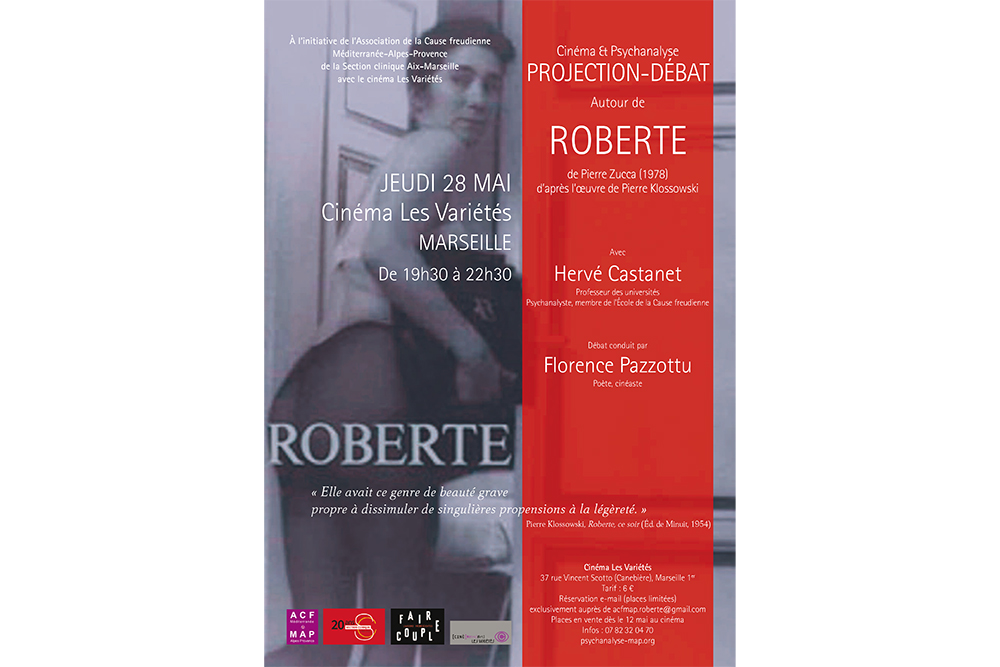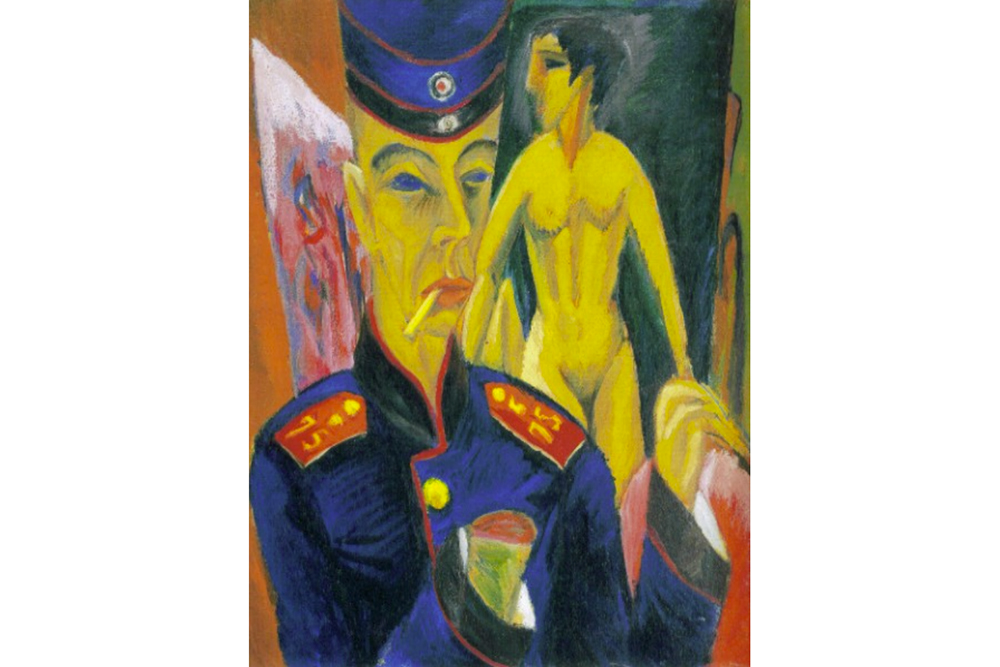Cette soirée organisée par l’ACF-Aquitania, à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux, regroupa trois invités spécialistes[1] dans le cadre de la Procréation Médicalement Assistée au CHU de Bordeaux.
Nous avons beaucoup appris de nos collègues médecins, eux-mêmes assez enthousiasmés par cette réunion médecine-psychanalyse.
La question de départ, en lien avec le thème des 45es journées de L’ECF, concernait le lien qui unit deux sujets au point de se prêter à cette expérience de la procréation médicalement assistée, et surtout le lien qui unit le couple parental et son médecin.
La stérilité n’est pas toujours cause de la demande de PMA. Parfois, le médecin s’aperçoit que le désir d’enfant est peu présent. Ou bien, « le désir d’enfant est dévorant pour les femmes »[2]. Les suites et conséquences de la réussite ou de l’échec d’une PMA restent imprévisibles.
La fécondation in vitro ne répare pas tout. Mais en cas d’échec, le médecin reste insatisfait, souvent perplexe ou inquiet. Son désir est de satisfaire à ce désir d’enfant, et ainsi accorder désir du couple et désir du médecin.
Au CECOS[3], les demandes sont là encore très variées : congélation du sperme à la suite de l’annonce d’un cancer, hommes célibataires, hommes en couple, infertilité masculine, adolescents au sortir de l’enfance atteints d’une maladie grave, obsessionnels désireux de ne pas perdre leur possibilité de paternité, etc. Beaucoup d’hommes en souffrance marqués par la maladie ou l’humiliation de l’infertilité.
L’humanisation n’est pas toujours au rendez-vous. Appliquer les protocoles ne permet pas de tenir compte de la subjectivité d’un sujet. Ainsi en est-il du jour J. Souvent ça cloche ce jour là. Un désir inconscient vient-il se mettre en travers ?
Cette description du CECOS et de ces recueils de sperme illustre réellement le non rapport sexuel. Ici la question du couple n’est pas au premier plan, il est plutôt question de paillettes et de congélation.
Les parents ayant recours à un donneur anonyme s’inquiètent : qui est le père? Pour les rassurer on leur explique la différence entre père biologique et père symbolique. Étonnement encore du médecin quand il s’aperçoit que l’enfant ressemble à son père !
Quelques discussions avec la salle nous ont menés vers la question du deuil de l’enfant à venir, du patrimoine génétique. « Qu’est ce que le deuil ? », « Peut-on faire le deuil d’un être humain qui n’a pas existé ? »
Le rappel du deuil, concept conçu par Freud, est venu clore les débats. De qui et de quoi fait-on le deuil ?
[1] Dr Gaëlle Rocher-Escriva, gynécologue, spécialiste en médecine de la reproduction ; Dr Lucie Chansel-Debordeau, biologiste au Cecos ; Dr Irène Bourrée, gynécologue interne en biologie de la reproduction.
[2] Selon le Dr G Roucher-Escriva.
[3] Centre d’Étude et de Conservation des Oeufs et du Sperme.