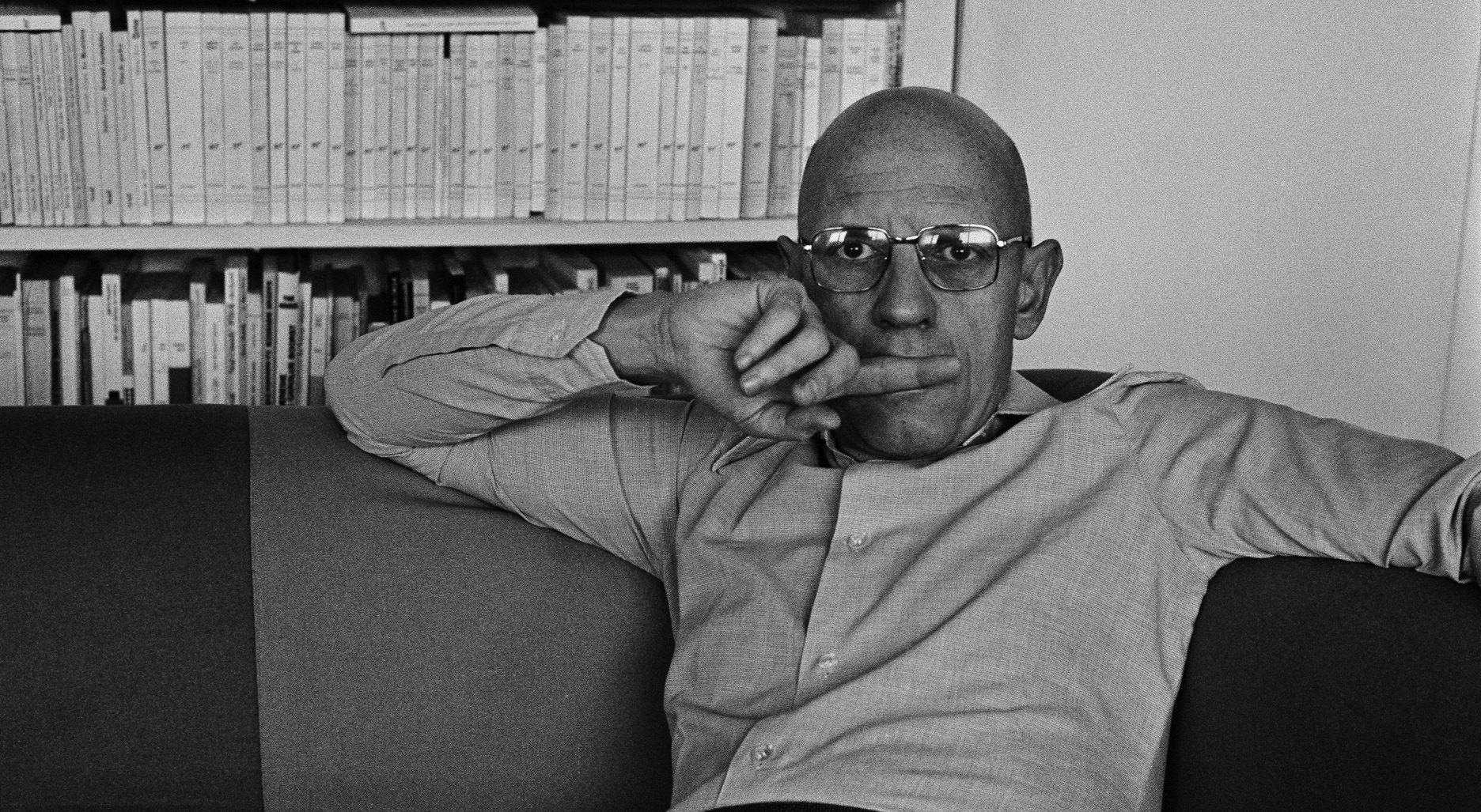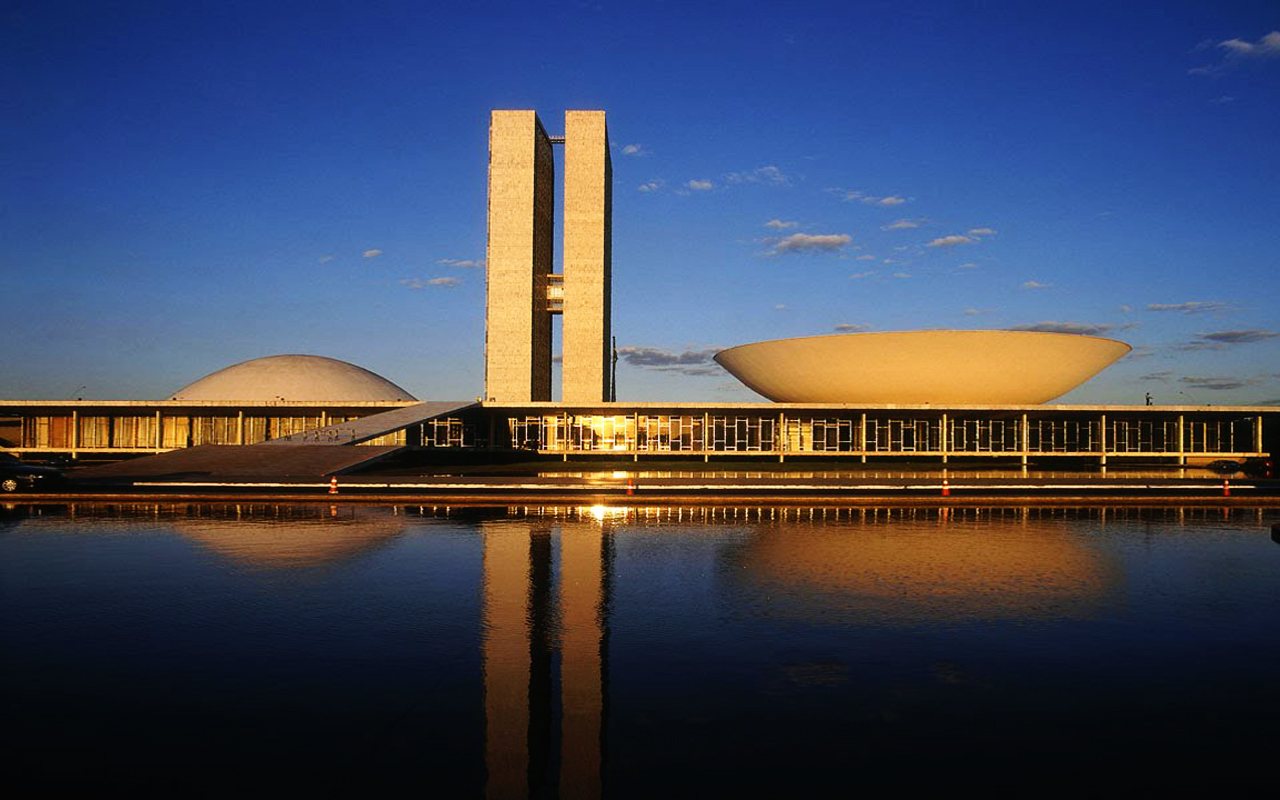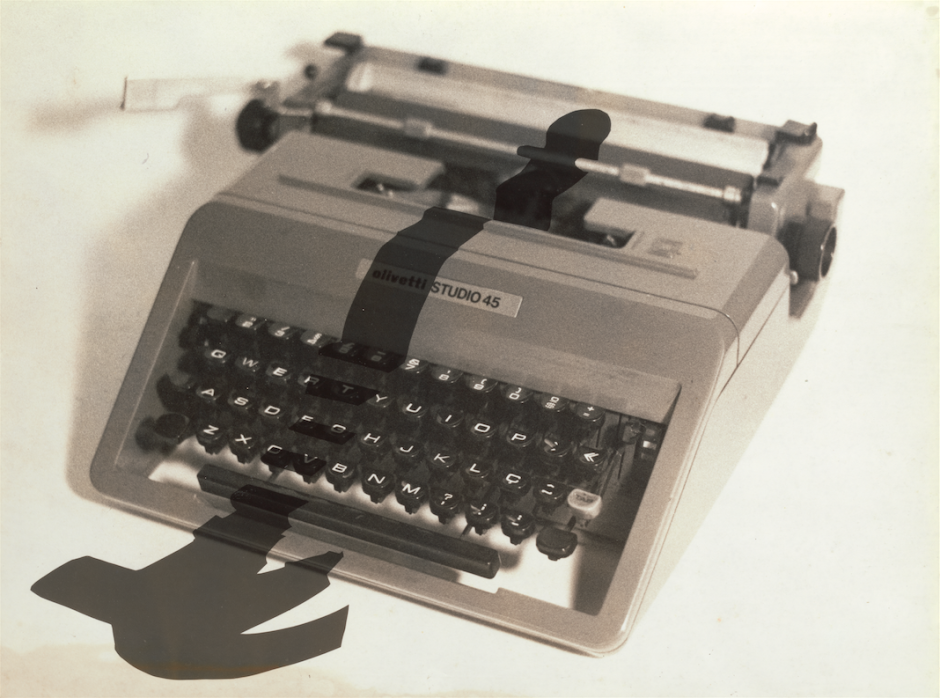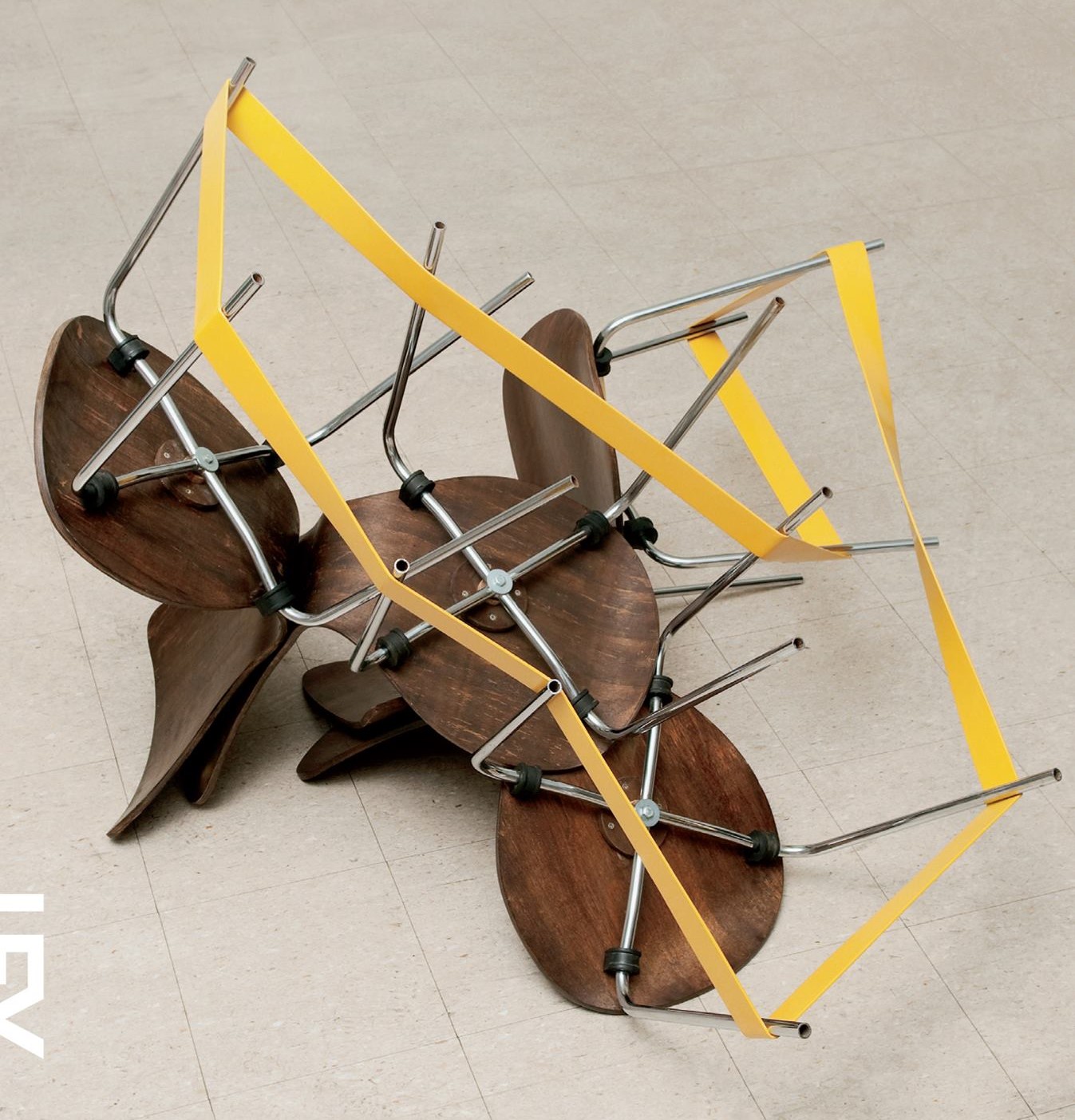Jouissance féminine[1]
La question « Qu’est-ce qu’être une femme ? » parcourt le film de Todd Haynes, Carol, sorti en salle en janvier 2016. Dans les années 1950, deux femmes issues de milieux sociaux différents se rencontrent et tombent amoureuses. Thérèse (Rooney Mara) est effacée, timide, discrète. Indécise, divisée, elle hésite entre deux vocations professionnelles, entre deux hommes. Elle est mal à l’aise dans son corps qu’elle habite avec difficulté.
À l’opposé, Carol (Cate Blanchett) assume avec élégance et raffinement les semblants de la féminité. Ses tenues colorées contrastent avec la pâleur de Thérèse. Elle entretient avec son propre corps un rapport d’adoration. L’esthétique, l’apparence, l’image des corps et le regard sont centraux et servent de fil rouge au réalisateur pour aborder la question de l’énigme de la jouissance féminine. Dès le premier regard, Thérèse est captivée par l’image de Carol, qui incarne pour elle l’idéal de la perfection féminine. Elle représente, à ses yeux, l’Autre femme, une « vraie » femme, capable d’assumer d’avoir un corps et de l’habiter. Dans ce film, nous suivons le chemin de ces deux femmes.
Dans le Séminaire III, Jacques Lacan indique que ce chemin est toujours plus compliqué pour la femme que pour l’homme. Il y a une dissymétrie, qui est une dissymétrie signifiante : parce qu’« il n’y a pas à proprement parler, dirons-nous, de symbolisation du sexe de la femme, comme tel »[2], il n’y a pas d’identification féminine possible.
Comme Dora, fascinée par Mme K qui incarne sa propre question sur sa féminité, Thérèse est captivée par l’image de Carol. « En dépit de ses péripéties devant le miroir, elle, dont l’être ne coïncide pas avec le corps qu’elle a, ne trouve pas la définition du corps de la femme, son identité. »[3] C’est pourquoi elle se captive dans l’image d’une Autre femme : l’imaginaire vient à la rescousse du manque de signifiant. C’est ce que ce film met en lumière. Nous n’avons pas un rapport d’identité à notre propre corps mais un rapport d’extériorité.
Thérèse voit dans Carol l’image d’une femme dont l’être et le corps seraient parfaitement noués, ce qui n’est pas possible. En effet, au lieu « d’un rapport d’identité, nous avons avec le corps le même rapport qu’avec “un meuble” au point que ce corps – qui fonctionne tout seul sans que nous en sachions rien – peut nous apparaître comme étranger à nous-mêmes. » C’est parce que nous construisons avec ce corps « un rapport d’adoration » que cela nous est voilé. La notion de parlêtre qu’introduit Lacan dans son dernier enseignement met l’accent sur le mystère de l’union du corps et de la parole. C’est ce qui s’aperçoit à la fin de ce film : « les chaînes signifiantes sont branchées sur le corps »[4] et un nouveau rapport au corps est possible pour Thérèse, à partir d’une nouvelle modalité de rapport à la parole, c’est-à-dire à la jouissance. À condition de s’extraire de sa fascination pour l’idéal, fascination qui la rendait muette, un nouveau rapport à son désir féminin s’ouvre pour elle.de sa fascination pour l’idéal, fascination qui la rendait muette, un nouveau rapport à son désir féminin s’ouvre pour elle.
[1] Menghi C., « Jouissance féminine », Scilicet – Le corps parlant – Sur l’inconscient au XXIème siècle, collection rue Huysmans, Paris, 2015, p. 185.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, Seuil, p. 198.
[3] Op. cit., Scilicet, p. 186.
[4] Op. cit., Scilicet, p.183.