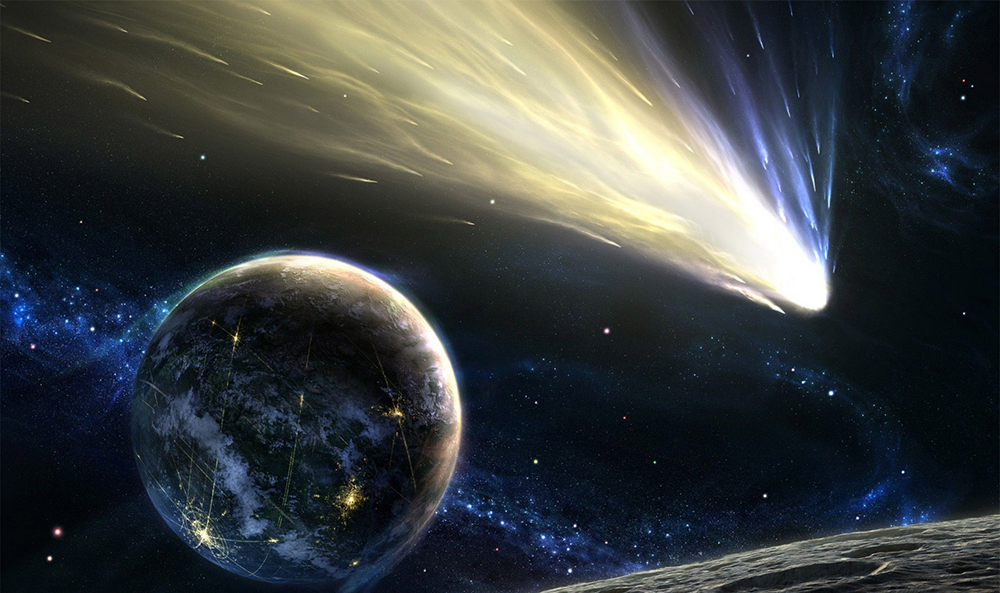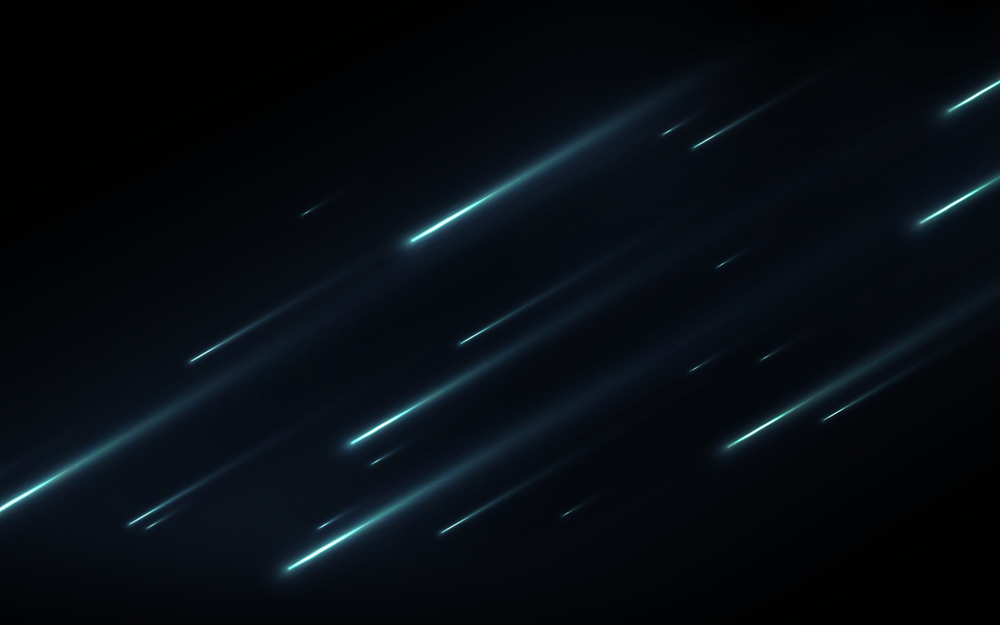L’Être mère, le devenir mère et les fantasmes s’y rapportant se sont déployés pendant ces J44 sous de nombreuses facettes pour constituer, à l’instar de la belle affiche du prochain Congrès de l’AMP qui nous a été dévoilée par Marcus André Viera, une mosaïque de portraits.
Mais une mosaïque vivante, en mouvement, pleine des éclats, murmures ou cris, venus de ce que Marie-Hélène Brousse a nommé, après Lacan, « la bouche d’or des analysants » au cours de la conversation que Christiane Alberti et elle ont eue, devant nous, avec Christophe Honoré.
Oui, des portraits vivants, même si, de manière très frappante, la mort a été souvent convoquée ; des paroles, propos qui résonneront encore longtemps, invitant à lire, écrire, poursuivre le travail.
Et ces Journées n’étaient-elles pas situées exactement dans l’intervalle entre les J43 sur le trauma et ce prochain Congrès de l’AMP dont le thème est « Le corps parlant » ?
Ainsi, deux interventions sur le thème « Ce corps qui change », introduites par le bel exposé sur La couvade d’Armand Zaloszyck, ont samedi matin particulièrement retenu mon attention. Deux mères, l’une emportée par une maladie grave peu après la naissance de l’analysante dont nous a parlé Véronique Pannetier et l’autre, la belle-mère, la propulsent par moments du côté de l’infini, du « trou noir », mais d’un trou « très dense », « vibrant de plus en plus », trou qu’elle articule à une grande solitude, ou du côté de la colère. Quelle chance d’avoir entendu V. Pannetier déplier délicatement l’avancée et les tournants de la cure de cette femme, interrogeant aussi le statut d’un corps « englué » qu’elle isole comme symptôme protecteur face à sa déréliction de nourrisson et rempart contre un Idéal du moi féroce, sous la figure d’un Janus à deux têtes, ses deux Autres maternels.
Dans la même séquence, Nicole Treglia nous a montré à quel statut d’objet déchet abject l’abondante production picturale, plastique et littéraire de l’artiste japonaise Yayoi Kusama répond, comme seule issue possible, comme impérieuse nécessité pour contrer le pousse au suicide. Car c’est un véritable « anathème » que la mère a jeté à sa fille : « Quand tu étais dans mon ventre, tu étais pourrie et mon ventre était tordu. » N. Treglia a construit son propos à partir du livre de Y. Kusama, Manhattan suicide addict, dont elle nous a dit combien la lecture était difficile. L’art comme solution sinthomatique pour cette artiste de renommée internationale peut s’entendre dans cette formule : être « un pois perdu dans un univers de pois ». C’est certes bien peu de chose, la disparition du sujet n’est pas loin, mais c’est tout de même être un pois situé dans un univers !
L’après-midi, c’est José Rambeau qui a déroulé magistralement pour nous son hypothèse sur les mères infanticides dans la suite de sa rencontre avec l’une d’elles, dont il nous a livré des éléments de témoignage. En réponse à ce qu’elle a pu lui dire, se tenant à une rigoureuse position de secrétaire silencieux dont il a fait valoir la nécessité, il nous a proposé trois types de passages à l’acte dans les cas de mères infanticides : celui qui concerne l’être mère, dans le cas des passages à l’acte suicidaires altruistes, celui qui concerne l’être femme, incarné dans le personnage de Médée, et celui qui concerne la maternité appuyée sur un conjugo qui tient lieu de suppléance. Si le conjoint s’efface, plus rien ne tient, ni être de femme, ni être de mère, tout ne peut que s’effacer, disparaître.
Alors, cette formule que j’ai retenue de la conversation de Catherine Lazarus-Matet avec Brigitte Jaques-Wajeman et François Regnault à propos des personnages de mères des trois pièces dont nous avons pu voir une scène jouée comme au théâtre, « chacune est porteuse d’un drame », ne pourrions-nous l’adopter en la modifiant ainsi : chaque mère est porteuse d’un drame ou d’une tragédie ?