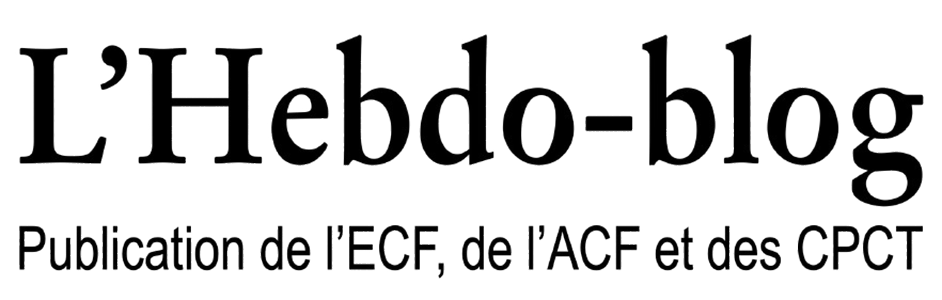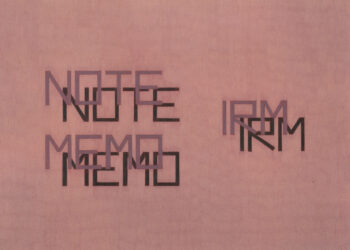Avançons qu’il n’y a plus de question linguistique au même titre que celle qui a traversé le XXe siècle. Elle est inaugurée par Saussure, dont la définition de la langue a marqué les sciences humaines du siècle précédent. Avec ce maître de la linguistique moderne, nous abandonnons les tourments de l’inconnaissable du langage hérité de l’Antiquité. Exit la question de l’origine du langage ou celle d’un langage comme signe des choses comme le note Foucault dans Les Mots et les choses. La langue se définit comme un système de signes, d’entités différentielles écrites selon l’algorithme signifiant/signifié.
Dans son Séminaire Encore, Lacan fait aussi valoir le pas franchi par Jakobson dans ses Essais de linguistique générale. Ce dernier démontre que le sujet de l’énonciation n’est plus enfermé dans l’énoncé. C’est un pas crucial qui résonne avec la définition du sujet tel que l’entend la psychanalyse : un sujet qui parle sans savoir ce qu’il dit – à jamais décalé, il réside dans la méprise du sens.
Traiter l’énonciation à partir de l’apport de Jakobson, puis comme le produit d’un sujet séparé de son énonciation, comme l’atteste la définition de référence de Benveniste, mettant en avant la « mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation1 », c’est la considérer exclusivement à partir des marques linguistiques. Sensible au caractère restrictif de cette définition, Oswald Ducrot infléchit la question de l’énonciation dans les années quatre-vingt. L’énonciation devient, sous sa plume, un « évènement constitué par l’apparition d’un énoncé », un « dialogue cristallisé »2. C’est moins un acte de volonté du locuteur qu’une co-construction de positions d’énonciation, promesse d’une orchestration dialogique limpide. Avec O. Ducrot, perdure l’idéal de communication fondé sur l’intersubjectivité des interlocuteurs, sujets symétriques3, dit Jean-Claude Milner.
Aujourd’hui, il y a un certain consensus sur l’absence de réelles nouveautés sur l’énonciation depuis O. Ducrot. Le débat porte entre autres sur la définition d’une énonciation plus ou moins solidaire du point de vue. Alain Rabatel relève cette notion dialogique de l’énonciation – déliaison du locuteur (celui qui parle) de l’énonciateur (celui doté d’un point de vue) – pour noter que cette perspective survalorise le locuteur. Ce dernier aurait ce rôle de toute-puissance de mise en scène de la parole alors que « l’énonciation part des traces du sujet énonciateur pour aller jusqu’à englober les choix de construction des référents4 », nuance ainsi A. Rabatel. L’effort continu en linguistique pour cerner l’énonciation en interrogeant ses fonctions bute sur l’indétermination du parlêtre qui ne relève pas des seules postures énonciatives, puisqu’il est encombré d’un corps parlant. Lacan ouvre une autre voie à l’énonciation, celle qui surgit dans la cure sur ce chemin de parole. Avec lui, l’énonciation creuse l’énigme du parlêtre, celle de l’opacité du sexuel. S’il y a, en linguistique, une énonciation du possible à dire, qui est affaire de sens et de places définies, de points de vue ou de hiérarchie de traces énonciatives, il y a une autre énonciation, celle de l’impossible à dire, une énonciation du hors-sens, de la déformation et non de la formation signifiante. Cette énonciation-ci est celle de la matière concrète de la parole qui a chance d’advenir dans l’expérience analytique quand le sens ne fait plus obstruction.
Martine Versel
[1] Benveniste É., « L’appareil formel de l’énonciation », Langages, n°17, 1970, p. 12.
[2] Ducrot O., Le Dire et le dit, Paris, Minuit, 1984, p. 179 & 9.
[3] Cf. Milner J.-C., L’Amour de la langue, Paris, Seuil, 1978, p. 101.
[4] Rabatel A., Homo narrans. Pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit, t. I, Les Points de vue et la logique de la narration, Limoges, Lambert-Lucas, 2008, p. 49.