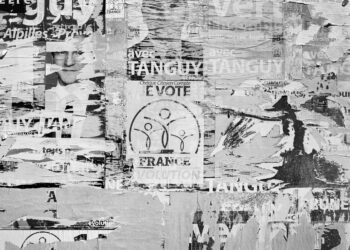Dès 1950, Lacan notait que l’implication croissante « des passions fondamentales de la puissance, de la possession et du prestige » dans les idéaux des sociétés démocratiques avait comme effet « l’apparition d’une criminalité truffant le corps social, au point d’y prendre des formes légalisées, l’insertion du type psychologique du criminel entre ceux du recordman, du philanthrope ou de la vedette »1. Le désir de notoriété2 et les « satisfactions scoptophiliques3 » infiltrent les idéaux sociaux contemporains, ce qui tend à normaliser le crime. Tentons de lire, avec cette orientation, les transformations de la criminalité dite organisée, et plus précisément des gangs de rue.
De l’ombre à la lumière
C’est dans les années 1920 que les bandes criminelles deviennent un objet sociologique avec la parution de l’ouvrage The Gang4, dans lequel Frederic Thrasher relate son observation ethnographique des quelques mille trois cents gangs qu’il a dénombrés à Chicago. Ceux-ci sont alors envisagés comme des sociétés spécifiques qui « fleurissent à la frontière », dans « les franges de la civilisation »5.
Dans les années 1970, qui marquent le début de la diffusion à grande échelle des drogues dures, d’autres chercheurs vont montrer comment l’organisation des gangs de rue imite les tendances de l’économie américaine, passant d’une orientation territoriale à une orientation de marché6.
À la fin des années 2010, les observateurs commencent à constater qu’internet est en passe de transformer les activités des gangs de façon significative7. Leurs membres se servent des messageries cryptées mais aussi des réseaux sociaux grand public pour organiser les trafics et toucher de nouvelles recrues. Alors que le crime organisé « traditionnel » prospérait dans l’ombre, les gangs affichent désormais au grand jour leur réussite dans le crime, à coup d’images d’objets de luxe, de femmes et d’armes, afin de promouvoir leur « marque » et d’intimider leurs rivaux.
Règlements de comptes instantanés
Avant les réseaux, les gangs diffusaient leur nom et insultaient leurs ennemis par graffitis ou morceaux de rap interposés. Désormais, ils twittent et postent, ce qui accélère la temporalité des règlements de comptes. « On a des morts, des meurtres qui surviennent immédiatement après l’envoi d’une vidéo », constate le responsable de la commission du crime de Chicago8 – certains de ces meurtres étant retransmis en direct.
Le scoring est un autre phénomène, pour l’instant marginal, apparu à Chicago à l’époque des confinements, et qui s’est propagé aux gangs d’autres métropoles, comme Montréal ou Londres. Les gangs rivaux se lancent des défis sur les réseaux, avec un système de comptage de points selon l’endroit où le corps de l’ennemi – ou, à défaut, son lieu de résidence – est touché. « Il y a des répliques presque immédiates, [témoigne un jeune], parce qu’on – les membres du gang – ne peut pas ne pas répliquer. Faut qu’on montre, premièrement, qu’on a une arme à feu, […] et […] qu’on ne laisse pas ça comme ça. Le but c’est de scorer en représailles, donc ça tire de partout9 ». Le crime doit être montré.
Monstration du crime
Avant l’apparition d’internet, travailleurs sociaux et violence interrupters, souvent choisis parmi les anciens membres de gangs, tentaient de résoudre les conflits en allant à la rencontre des jeunes, non en se référant à la loi mais en tentant d’introduire de nouvelles normes pour « dénormaliser10 » le crime.
Désormais, policiers et criminologues épluchent les profils virtuels des membres de gangs à l’aide d’outils comportementalistes11 et bientôt d’algorithmes, afin de détecter l’imminence d’un crime ou de réunir des preuves dans l’après-coup. Les gangs exposent leurs forfaits, les policiers les regardent et les arrêtent. Ce qui ne s’arrête pas, et qui est à l’œuvre dans ces mutations du crime, c’est la pulsion scopique déchaînée.
Alice Delarue
[1] Lacan J., « Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 145-146.
[2] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Pièces détachées », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, leçon du 2 février 2005, inédit.
[3] Lacan J., « Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie », op. cit., p. 145.
[4] Thrasher F., The Gang : A Study of 1313 Gangs in Chicago, The University of Chicago Press, 1927, disponible sur internet.
[5] Park R. E., « Editor’s preface », in Thrasher F., The Gang…, op. cit., p. 9.
[6] Cf. Coughlin B. C. & Sudhir A. V., « The Urban Street Gang after 1970 », Annual Review of Sociology, n°29, 2003, p. 41-64, disponible sur internet.
[7] Cf. The Chicago Crime Commission Gang Book, 2018, cité par D’halluin N., « Les réseaux sociaux, accélérateurs de la violence des gangs à Chicago », Le Figaro, 13 juin 2018, disponible sur internet.
[8] Ibid.
[9] « Glorification des armes à feu sur les médias sociaux et pratiques de prévention : un état des lieux », Centre international pour la prévention de la criminalité, Montréal, 2022, p. 23, disponible sur internet.
[10] Ibid., p. 28.
[11] Ibid., p. 28-30. La Citizens Crime Commission Of New York City a lancé un projet pilote, le E-Responder, à la fois « boîte à outils d’interruption de la violence » et « programme de leadership pour les jeunes », avec une échelle de risque, depuis « se vanter de son appartenance à un gang ou à une bande » (risque moindre de violence) à « photos avec des armes » (risque élevé de violence).