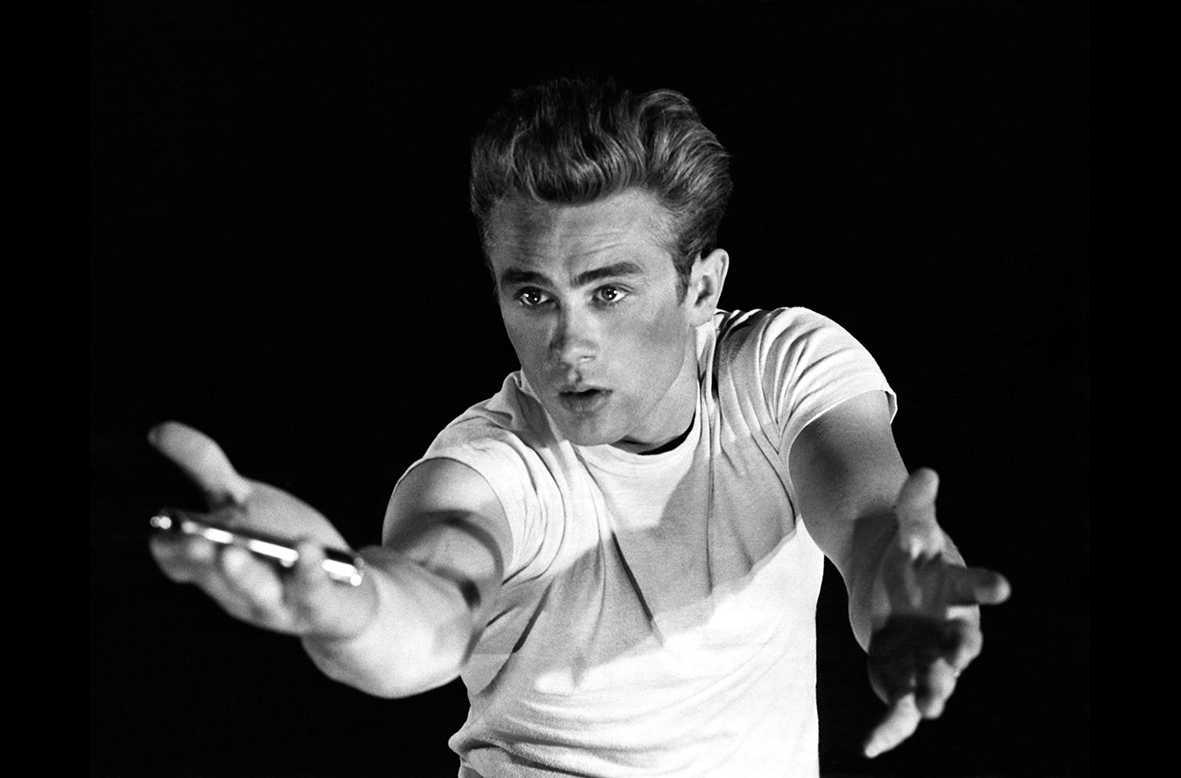Le thème « La solitude de la victime » a été abordé à travers la question du langage : celui-là même qui parfois ne répond plus face à l’horreur.
Le recours à l’analyste, à rebours des collectifs de victimes, introduit le sujet à un bien-dire qui fera son chemin au-delà du pathos.
Les événements de l’Histoire font apparaître ce qui atteint le fondement du langage :
– l’indicible et l’impossibilité de penser,
– la politique du langage et l’exil de la langue,
– la solitude du sujet.
De nos deux invités, Jean-Louis Aucremanne, psychanalyste auprès de toxicomanes en institution, rencontre ces violences du /et dans le langage.
Comment se tenir à la hauteur du réel de façon digne ? Comment œuvrer avec le réel ? sont les deux questions qui orientent une éthique. Interroger à quel Autre le sujet a affaire quand il est poussé aux insultes, à l’agression, à se faire le déchet du monde… Apprendre la langue du sujet et le poids des mots pour lui, c’est faire de l’institution une alternative de paroles.
Mais nous ne sommes pas dans une pastorale, et si le langage selon Georges Steiner peut avoir une certaine force de vie, il peut aussi devenir une « mécanique gelée » et amener la mort de la culture.
Que pouvons-nous apprendre des artistes, des poètes ? J.-L. Aucremanne rappelle que si le mot est le meurtre de la chose, sous la chose soi-disant morte la pulsion est toujours vivante, irréductible à une simple cognition. La poésie n’est-elle pas « résistance » ? C’est à travers l’œuvre de Francis Ponge, puis celle d’Antonin Artaud, que J.-L. Aucremanne nous mène à cette respiration vitale : il faut parler contre la langue, contre les paroles entendues, contre la jouissance mortifère et trouver dans la langue « ce qui la brise ».
C’est avec son goût de la langue, des langues, que Susanne Hommel, quant à elle, nous restitue son « passage » d’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre :
« Être née en Allemagne en 1938 faisait de moi une victime qui n’avait pas le droit de se plaindre puisque j’étais du côté des bourreaux. Il fallait faire avec cette “profonde fissure” comme disait Freud : “déchirure dans le Moi, qui ne guérira jamais plus”[2].
En allemand, victime se dit Opfer et résonne dans le corps comme résonne le cri dans la tragédie grecque. Le franchissement de la position de victime se fait dans l’urgence, dans une fraction de seconde. Souvenir-écran de notre départ de Dresde, Opfer-stadt, par le dernier train grâce à la fraction de seconde de la décision maternelle. Sauvés !
Ainsi Thomas Bernhard[3] évoque lui aussi des moments de ruptures radicales, de décision, de questions de vie ou de mort. Au moment de l’acte on ne réfléchit pas aux conséquences, c’est un temps logique, comme l’acte d’Antigone vis-à-vis de Polynice.
Petite fille allemande victime de la peur, de la faim, du froid, mais aussi victime de ne pas pouvoir revendiquer d’être victime. La culpabilité et la dette ont en allemand le même signifiant : Schuld !
Cette phrase de mon amie Anne-Lise Stern, déportée à Auschwitz, “nous sommes allemandes toutes les deux” a été un cadeau inouï, m’extrayant de la position de bourreau.
Quitter l’Allemagne, couper, tout était à inventer au risque de rencontrer le vide… J’ai refusé la langue allemande pendant des années, l’analyse me l’a rendue. »
Précieux temps de travail qui a traité d’une profonde « question humaine », celle de la vigilance que nous devons porter à l’usage de la langue, comme il a été dit dans la conclusion.
[1] Après-midi proposé par le Bureau de Rennes de l’ACF-VLB et préparé par Caroline Doucet, Véronique Juhel, Gaël Nevi, Géraldine Somaggio – Avec deux invités : Susanne Hommel et Jean-Louis Aucremanne
[2] Freud S., « Le clivage du moi dans le processus de défense », Résultat, idées problèmes II, Paris, PUF, 1985, p.284.
[3] Bernhard T., Sur la terre comme en enfer, traduit et présenté par Susanne Hommel, La Différence, 2012.


![La solitude de la victime[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/04/JouclaHD.jpg)