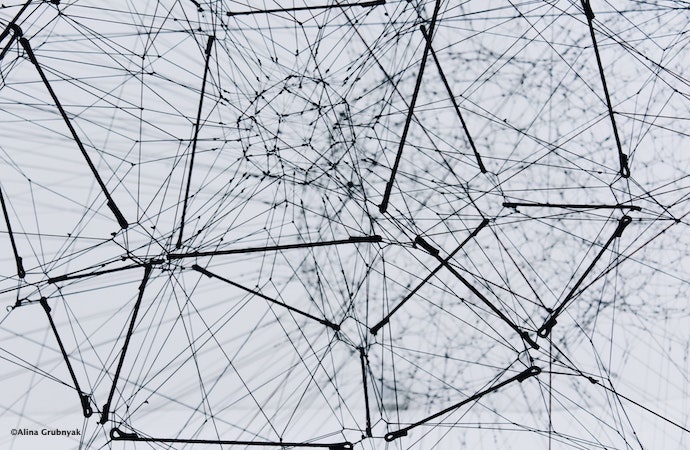« On a ainsi pu constater qu’un branchement, même fugace, sur le savoir supposé, que nous appelons par hypothèse inconscient, se traduit dans la règle par un rebranchement sur ce que l’on appelle traditionnellement le discours de l’Autre. Je prends mes distances, nos distances, avec cette formulation. “Le grand Autre”, cette désignation est une approximation, puisqu’il ne s’agit pas d’une instance unifiée, ce n’est pas un monolithe. Aussi je ne vois pas d’objection à parler d’un rebranchèrent sur la réalité sociale. » (Miller J.-A. « Vers PIPOL IV », Mental, n°20, février 2008, p. 187.)
Exercer au CPCT nous confronte à des formes de désinsertion, d’effondrement symbolique, de désorientation subjective. Des sujets perdent leur logement, rompent avec leur famille, ne parviennent pas à maintenir une activité professionnelle, s’isolent, se murent dans le silence. Parler pour l’être parlant est vital ; toute l’expérience humaine le démontre. Chacun porte la marque inéffaçable de l’expérience première du rapport à l’Autre [1]. Alors, comment permettre à ces sujets déboussolés de s’arrimer au discours de l’Autre ? Le CPCT peut-il être l’outil, la courroie de transmission vers le lien social, et comment ?
Avoir un rendez-vous au CPCT offre au sujet, des coordonnées symboliques lui permettant de s’inscrire dans une temporalité, un lieu vers lequel se déplacer et s’adresser. Dans ce lieu « analytique » [2], la régularité des séances est nécessaire pour construire un point d’ancrage, un appui, à partir duquel pourra se construire un dire. L’accueil réservé à une parole singulière constitue au fil des allers-retours, de la présence–absence, le premier pas pour que s’établisse un transfert à partir duquel le praticien opère.
Si le discours analytique transporte avec lui le lieu de l’Autre, alors un branchement sur l’Autre offre la possibilité au patient de s’appuyer sur la parole pour tempérer une jouissance en excès. Cette prise symbolique, qui s’exerce sur le corps, est la tentative d’introduire une forme d’homéostase, une stabilisation par des points d’arrêts en l’absence du Nom-du-Père. Nous serons attentifs à soutenir chez le sujet une modalité singulière de capitonnage de la jouissance. « Il s’agit, précise Éric Laurent, de chercher comment peuvent tenir ensemble signifiant et jouissance » [3].
Ainsi, tel sujet en cours de traitement au CPCT, bricole sa réponse en se nommant « schizophrène », véritable S1, lui conférant une certaine identité. Elle peut désormais raccrocher les voix qu’elle entend à ce signifiant trouvé sur internet, auprès de la communauté des « entendeurs de voix ». Elle s’y inscrit et l’envahissement de jouissance trouve à se localiser, se border. L’ouverture vers une forme de lien social, l’extraction et l’usage d’un nouveau savoir produisent un apaisement notable et un rebranchement sur l’Autre social.
Pour tel autre, le choix de devenir chef de chœur est le traitement salutaire de la cacophonie des voix. La pratique du chant choral ordonne, au fil de la partition, les voix intérieures, la sienne et celles de autres chanteurs. Mises au diapason de la musique et du texte chanté, elles sont désormais orchestrées et agencées par celui qui trouve, dans la musique, « sa véritable maison ».
« Au fondement de la réalité sociale, il y a “la prise du symbolique” » [4], indique Jacques-Alain Miller. Soulignons cependant que le lien social ne peut être réduit qu’aux seules conditions du langage. Le lien social ne se fonde pas uniquement sur les signifiants, mais également sur les corps parlants : « Le discours est le lien entre ceux qui parlent, le lien qui fait tenir les corps ensemble », indique Christiane Alberti [5]. C’est un discours qui nous tient et fait tenir notre corps grâce à la parole de l’Autre.
Ainsi, se faire partenaire d’un sujet au CPCT, c’est également lui permettre de renouer avec un discours, en incluant son corps dans le lien social.
* Véronique Villiers est praticienne au CPCT Marseille.
[1] Cf. Alberti C., « “En fin de compte, il n’y a que ça, le lien social” », in Hulak F. (s/dir.), Lire Lacan au XXIe siècle, Nîmes, Champ social, 2019, p. 56-57.
[2] Miller J.-A., « Vers PIPOL IV », Mental, n°20, février 2008, p. 185-192.
[3] Laurent É., « L’interprétation ordinaire », Quarto, n°94-95, janvier 2009, p. 148.
[4] Miller J.-A. (s/dir.), Situations subjectives de déprise sociale, Paris, Navarin, 2009, quatrième de couverture.
[5] Alberti C., « “En fin de compte, il n’y a que ça, le lien social” », op. cit., p. 57.