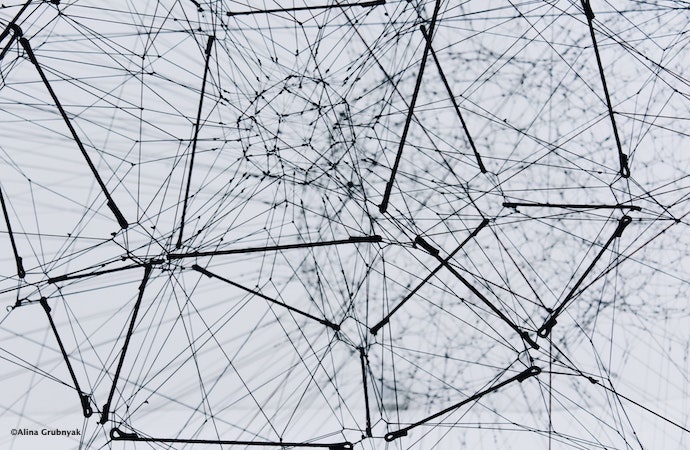En 1918, Freud formule le vœu de voir naître des lieux thérapeutiques dans lesquels un traitement gratuit, orienté grâce « à l’aide de l’analyse » [1], serait dispensé à une large partie de la population. Mais il alerte fermement les analystes contre les « excès de bon cœur » : si l’on « cherche à rendre la vie aussi douce que possible au malade[,] [alors on renonce] à le fortifier pour la vie et à le rendre plus capable de remplir ses véritables devoirs. En analyse, il faut éviter toutes ces gâteries » [2]. Il indique qu’il faut doser les effets de la moindre manifestation d’empathie. L’analyse doit s’opérer dans un état de frustration, car dans le cas contraire le symptôme chercherait d’autres satisfactions substitutives. C’est le transfert lui-même qui permet à l’analyse de devenir une satisfaction substitutive, et celui-ci est plus à même de faciliter le maniement de la cure. Le symptôme et ses variantes peuvent alors s’y interpréter.
La prédiction d’une extension de la psychanalyse à travers des instituts de soin conduit Freud à envisager que la technique pourrait en être modifiée. Il met cependant en garde concernant toute adaptation de la cure analytique : « quelle que soit la forme de cette psychothérapie populaire et de ses éléments, les parties les plus importantes, les plus actives demeureront celles qui auront été empruntées à la stricte psychanalyse dénuée de tout parti pris » [3]. Freud pressentait-il déjà que le déplacement de l’analyste vers la cité ne pouvait s’opérer que si les conditions de la « force pulsionnelle de l’analyse » [4] restaient par ailleurs garanties ?
Ce sont, signale Jacques-Alain Miller, « les concepts lacaniens de l’acte analytique, du discours analytique, et de la conclusion de l’analyse comme passe à l’analyste, qui nous ont permis de concevoir le psychanalyste comme objet nomade, et la psychanalyse comme une installation portable, susceptible de se déplacer dans des contextes nouveaux, et en particulier dans des institutions » [5]. L’objet pulsionnel, caractérisé par sa métonymie, est nomade [6]. L’analyste, dont Lacan a formalisé qu’il doit être à la place de l’objet dans le discours analytique, est donc conduit à se déplacer, n’occupant pas toujours la même position pour un sujet. Lacan dit plus précisément que « l’analyste n’est pas tout objet a [mais qu’il] opère en tant qu’objet a » [7], c’est-à-dire qu’il emprunte pour un sujet cette place de semblant et incarne tour à tour, de déplacement en déplacement, les différents objets cause du désir.
C’est pour cette raison que, lorsqu’on le questionne sur le fait que ce qu’il dit échappe toujours au sens, Lacan répond en faisant du déplacement la « condition même du discours analytique » [8]. La formalisation du discours analytique, en posant les principes de l’interprétation et de l’acte analytique, démontre que « les effets psychanalytiques ne tiennent pas au cadre, mais au discours [et que] la qualité d’analyste, indique J.-A. Miller, ne dépend pas de l’emplacement du cabinet, ni de la nature de la clientèle, mais de l’expérience dans laquelle lui s’est engagé » [9]. Ce sont les déplacements successifs que l’analyste opère dans sa propre cure, parce qu’il dégage le vide central qu’occupe l’objet comme semblant, qui lui permettent d’étendre sa pratique à d’autres contextes que celui de son cabinet tout en en préservant le tranchant.
Ce numéro de L’Hebdo-blog, Nouvelle série, montre comment les CPCT continuent à tirer les principes et les conséquences de ce nécessaire déplacement.
[1] Freud S., « Les voies nouvelles de la thérapeutique », La Technique psychanalytique, Paris, PUF, 1953, p. 141.
[2] Ibid., p. 137.
[3] Ibid., p. 141.
[4] Ibid., p. 137.
[5] Miller J.-A., « Lieu Alpha », in Perrin Chérel M. (s/dir.), Être parents au 21e siècle. Des parents rencontrent des psychanalystes, Paris, Michèle, 2017, p. 24.
[6] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La Relation d’objet, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1994, p. 127.
[7] Lacan J., Le Séminaire, livre XV, « L’acte psychanalytique », leçon du 7 février 1968, inédit.
[8] Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 171.
[9] Miller J.-A., « Lieu Alpha », op. cit., p. 24.