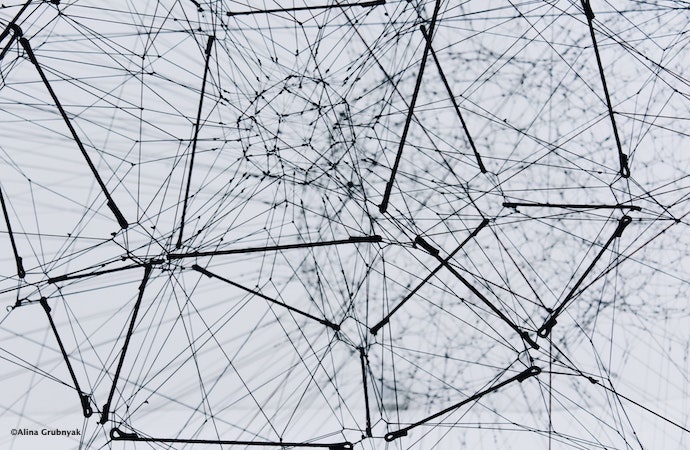« Qu’est-ce que le social ? […] C’est d’abord un mot passe-partout, éminemment commode, qui fait interface entre le langage des autorités politiques et administratives et le nôtre, au prix sans doute d’une équivoque. Le secret, le nôtre, c’est que nous ne distinguons pas entre la réalité psychique et la réalité sociale. La réalité psychique, c’est la réalité sociale. » (Miller J.-A. « Vers PIPOL IV », Mental, n°20, février 2008, p. 188.)
Pour ceux qui franchissent le seuil du CPCT, parfois après plusieurs appels et absences, le transfert est d’emblée un transfert au corps. Une parole est adressée au consultant, qui lui donne abri pour un transfert à la langue. La parole, qu’elle soit confuse, silencieuse, tranchante ou balbutiante, est accueillie pour ouvrir un lieu autre, eu égard de la réalité sociale telle qu’elle est vécue par ceux qui nous rencontrent.
Aujourd’hui, le discours contemporain est bien l’effet du langage, mais dévoile l’Autre comme inexistant et prône la récupération d’une jouissance sans limite, comme Lacan l’annonçait à la fin de son enseignement. Les signifiants de l’Autre n’identifient plus le sujet, mais l’estampillent ou l’ordonnent tels les maîtres mots d’insertion, d’intégration, d’autonomie, de bien-être à la mesure des réponses des politiques sociales qui ne cessent de créer autant de réseaux que de plateformes, dispositifs ou parcours. Plus les réponses sociales sont individualisées, plus l’anonymat est de mise, plus chacun est laissé seul avec sa jouissance. Plus le discours actuel – par exemple, « zéro chômeur », « zéro personne à la rue » – est adressé à chaque Un, moins il prend en compte la part de subjectivité de celui auquel il s’adresse, et il devient un mot d’ordre qui participe de l’accablement du sujet. L’isolement, accentué par la pandémie, a mis au grand jour la solitude sur son versant de jouissance autiste ainsi que ses conséquences sur les corps.
Ce qui s’apparentait à de la précarité, quand le CPCT Lyon a ouvert ses portes, s’avance de plus en plus comme détresse, errance, exclusion, isolement qui sont des manières de loger sa douleur de vivre. Dans le repli de l’isolement, le sujet disparaît et devient invisible dans l’espace social. Freud n’avait pas manqué de rendre compte des conséquences des discours de son époque sur la subjectivité. Dès 1924, dans son article « La perte de la réalité dans la névrose et la psychose » [1], il nous indique que la réalité est une construction subjective, un fait de langage, aussi bien fiction que défense du réel, tel que Lacan nous y introduit dans son enseignement.
Au CPCT, nous usons de la faille ouverte par le discours moderne, à l’endroit où les parcours toujours plus individualisés laissent les sujets toujours plus seuls avec leur jouissance, pour répondre par la singularité sinthomatique de chaque parlêtre, terme par lequel Lacan désigne l’être charnel « ravagé par le Verbe » [2]. Le parlêtre réintroduit la dimension de la pulsion dans le verbe alors que le sujet de l’inconscient et la jouissance sont en exil. C’est cette clinique du parlêtre qui détermine une expérience pouvant ouvrir au sujet, s’il y a rencontre, à une éthique de la responsabilité de son mode de jouir singulier.
Il s’agit d’alléger la tyrannie du surmoi contemporain qui écrase, d’habiller le réel, de donner goût à la parole pour en changer le statut, et créer une distance avec son dire. Cette clinique nous rend particulièrement attentifs à la façon dont la parole résonne, à ses effets sur le corps, et à la menace que peut produire ce qui résonne des signifiants. Le CPCT est un lieu de réponse, « Tu peux savoir » [3], en prenant la mesure de ce qui se dit et de la façon dont ça se dit. Le discours analytique offre une souplesse d’inventions et des réponses mesurées aux capacités du sujet qui le rencontre. Nous vérifions, lors des groupes cliniques, les effets de la parole sur le chaos de la vie et combien notre boussole, celle d’un impossible à dire, est la seule qui permette de faire accueil. Il s’agit de donner toute sa portée au « ça rate », car le symptôme, signe du non-rapport, est toujours le caillou dans la chaussure du discours scientifique ou social. L’approche du réel de l’inconscient reste la chance d’articuler la singularité subjective et l’éthique de la responsabilité dans le groupe social.
* Geneviève Valentin est la directrice du CPCT Lyon.
** Miller J.-A., « Vers PIPOL 4 », Mental, n°20, février 2008, p. 188.
[1] Freud S., « La perte de la réalité dans la névrose et la psychose », Névrose et psychose, in Œuvres complètes, vol. XVII, 1923-1925, Paris, PUF, 1992, p. 35-41.
[2] Lacan J., Le Triomphe de la religion, Paris, Seuil, 2005 p. 90.
[3] Lacan J., « Introduction de Scilicet au titre de la revue de l’École freudienne de Paris », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 283.