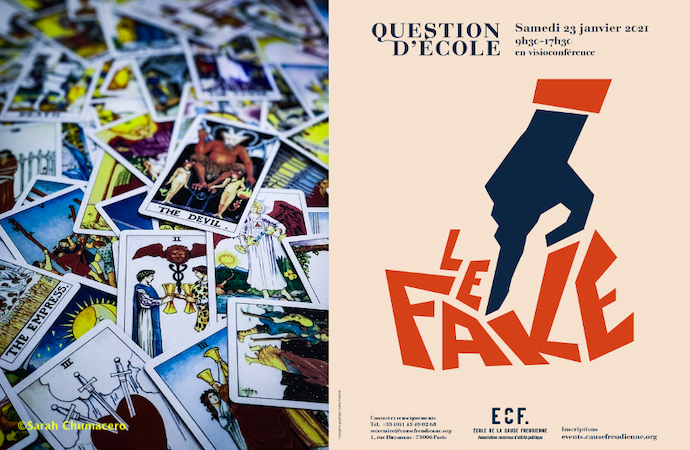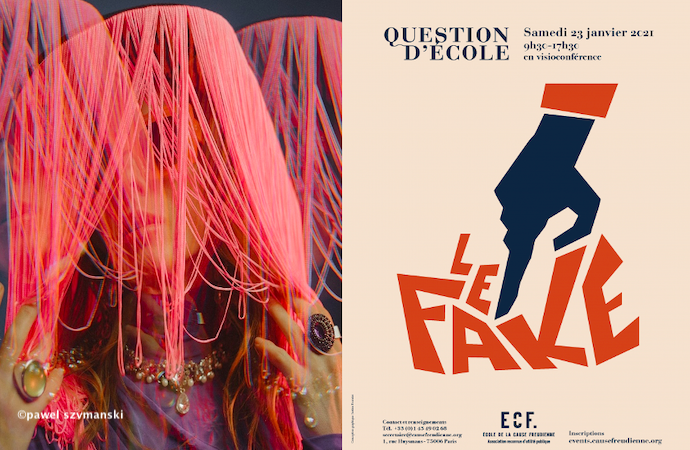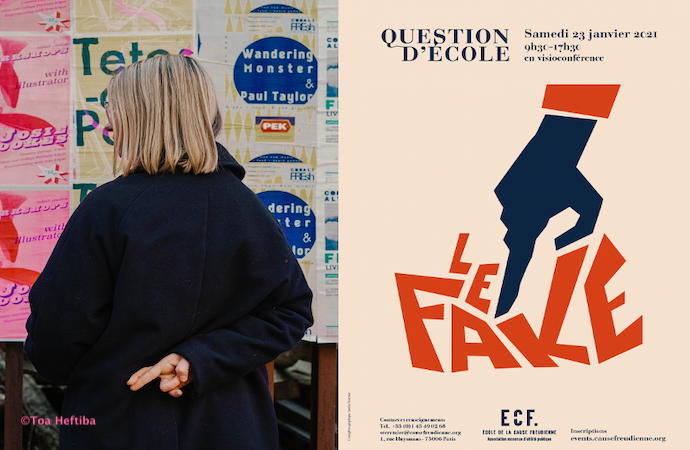« The Devil speaks truth much oftener than he’s deemed,
He hath an ignorant audience » [1].
De cette « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI » [2], qui est une mine, nous avons tous retenu quelques formules qui nous ont donné du grain à moudre ces dernières années : « On le sait, soi » [3], reprit par Éric Laurent, pour évoquer la certitude qu’on peut avoir de son être. « [É]pars désassortis » [4], qui définit le un par un de notre lien au groupe. Mais surtout, « l’inconscient, soit réel » [5], où Jacques-Alain Miller nous a fait lire cet inconscient réel comme terre de Canaan du tout dernier Lacan.
Mais dans ces courtes pages, une définition de la vérité nous concerne, dans la perspective de « Question d’École » [6] : « Il n’y a pas de vérité qui, à passer par l’attention, ne mente. » [7] Ainsi se trouve mis en cause le statut de cette vérité, dont Freud disait que son amour était une condition nécessaire à l’analyse, et qu’elle consistait précisément dans le fait de tenir compte de la réalité. Voilà le « grain de sel » que Lacan apporte à cette embrouille, qui est celle d’une discipline nouvelle venue, qu’il place ainsi par-delà le vrai et le faux.
Un mot d’esprit insiste dans ce texte, dans lequel il a cinq incidences : hystoire, substantif néologique du verbe hystoriser. Le bonheur de ce Witz est de condenser au moins deux champs (c’est-à-dire plus). Celui de l’histoire, qui est affaire de Faits, dont on sait, de la bouche des historiens eux-mêmes, qu’ils sont faits. Autrement dit : un fait historique n’est pas un donné brut de l’expérience ou des sens, une réalité intangible. Il est construit par le regard et l’élaboration d’un auteur, qui interprète les éléments épars de l’expérience pour établir le texte depuis sa place de secrétaire des événements. C’est ainsi que les historiens reconnaissent leur discipline comme une science conjecturale, catégorie définie par Renan et à laquelle Lacan a rattaché la psychanalyse à l’occasion.
L’autre champ est celui d’un discours, c’est-à-dire d’un lien social, dont l’agent est le sujet lui-même, tel qu’il s’adresse à l’Autre depuis sa division. Lacan l’appelle discours de l’hystérique. C’est de là que le sujet subjective, comme on dit, ce qui lui est arrivé et construit sa vérité avec les lambeaux de ses expériences et de ses souvenirs. L’historien comme l’hystérique font ainsi des contingences de l’existence les nécessités de la destinée.
Dans ce texte de 1976, Lacan résume ce qui est alors pour lui l’enjeu de la procédure de la passe, qu’il a proposée en 1967, soit la « mise à l’épreuve de l’hystorisation de l’analyse » [8] : « La question reste de ce qui peut pousser quiconque, surtout après une analyse, à s’hystoriser de lui-même. » [9] C’est ici qu’un troisième champ sémantique montre le bout de son nez, celui de l’autorisation : « Comment peut lui venir l’idée de prendre le relais de cette fonction ? » [10] Comment on se fait auteur ?
Hors du contexte analytique, je connais un petit ouvrage saisissant qui témoigne de ce qu’est une hystorisation par laquelle un sujet construit le récit d’un moment traumatique de sa vie, dont il fait la cause de sa position d’écrivain et la détermination de son œuvre et de son style. Il s’agit de L’Instant de ma mort [11], de Maurice Blanchot. Ce court récit détonne par une apparente simplicité et une clarté quasi clinique, avec les ouvrages que cet auteur a livré pendant cinquante ans au happy few qui le lisait. En quelques pages denses, il raconte alors pour la première fois comment jeune homme, il s’est trouvé face aux fusils d’un peloton d’exécution. Ce laps de temps indéfini, pendant lequel il se sent hors-réel et éprouve une incroyable légèreté, se résout après qu’il échappe par hasard à la salve fatale, par un temps suspendu où il se trouve en instance, de cette mort dont il a fait ce jour-là l’inexpérience et qui est depuis resté suspendue. Il y a là un franchissement qu’il dit « inanalysable » [12] , passe ou impasse, comme on dirait à une table de jeu, dont il témoigne avec le synthétisme et l’impression d’authenticité que l’écriture permet : « Seul demeure le sentiment de légèreté qui est la mort même […], l’instant de ma mort désormais toujours en instance » [13].
Parmi les éléments où le génie de l’auteur se montre, j’ai à chaque fois été frappé par l’oscillation du sujet grammatical des phrases, où il est tantôt question du jeune homme, du châtelain, d’un il ou d’un on qui représente le personnage, et où tantôt le narrateur dit je. C’est ce flottement, d’un homme qui est resté à jamais dans l’entre-deux de sa mort (pas au-delà, dit-il ailleurs [14]) et qui tantôt décrit ce qui arrive à un personnage de fiction, tantôt l’endosse (comme on le fait d’un chèque qu’on signe), qui fait d’un épisode en marge de la grande histoire (la férocité des nazis au moment de leur défaite et les soubresauts de la résistance) un formidable témoignage d’hystorisation. Nous sommes entre Dichtung und Wahrheit, Poésie et vérité, comme l’écrit Goethe pour sa propre autobiographie [15] ; titre dont on est surpris (ou pas) de lire que Blanchot le traduit par « vérité et mensonge ». Pas « ou bien, ou bien », mais : et.
[1] Byron, cité par Goethe, in Conversations de Goethe avec Eckermann, Paris, Gallimard, 1949, p. 170.
[2] Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 571-573.
[3] Ibid., p. 571.
[4] Ibid., p. 573.
[5] Ibid., p. 571.
[6] « Question d’École. Le fake », événement de l’École de la Cause freudienne, 23 janvier 2021, en visioconférence, information en ligne.
[7] Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », op. cit., p. 571.
[8] Ibid., p. 573.
[9] Ibid., p. 572.
[10] Ibid.
[11] Blanchot M., L’Instant de ma mort, Paris, Gallimard, 2002.
[12] Ibid., p. 16-17.
[13] Ibid., p. 18.
[14] Blanchot M., Le Pas au-delà, Paris, Gallimard, 1973.
[15] Goethe, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, trad. Poésie et vérité. Souvenirs de ma vie, Paris, Aubier, 1941.