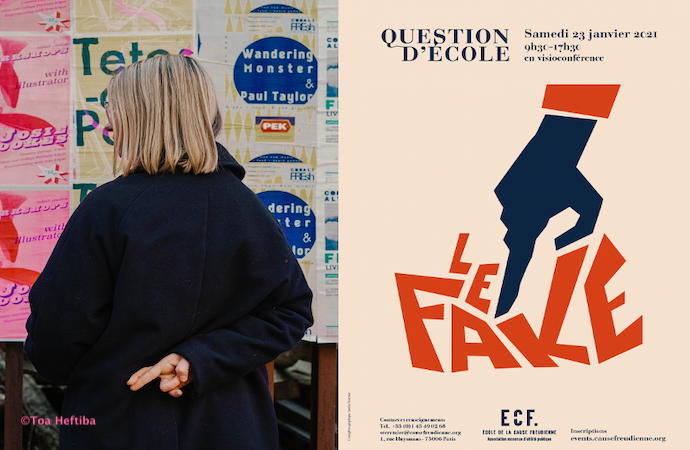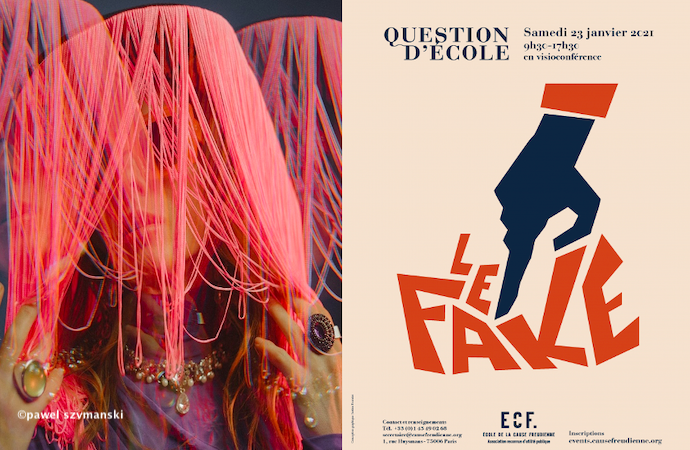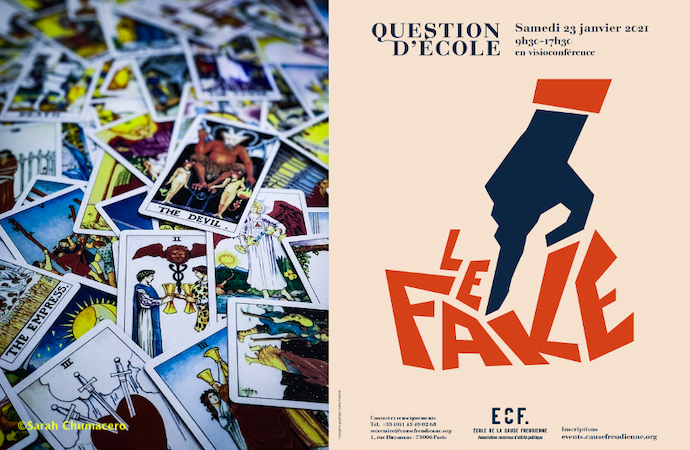« …rien qu’une vie, voilà le tort que j’ai eu, un des torts,
m’être voulu une histoire »
(Samuel Beckett, Nouvelles et textes pour rien)
« C’est un incident beaucoup plus minuscule, celui qui m’a mis en demeure de prendre soin de vous en tant que poignée de psychanalystes dont je vous rappelle que de la vérité, vous n’avez certes pas à revendre, mais que quand même c’est ça votre salade, c’est ce que vous vendez. » [1] C’est un avertissement adressé à l’analyste qui signale toute la complexité du rapport à la vérité dans l’analyse. Le rapport que l’analyste entretien à la vérité doit être suffisamment dégagé pour lui-même, car la tâche qui l’attend n’est pas simple : il n’a pas à revendre de la vérité, tout en n’oubliant pas qu’il en vend malgré lui, parce qu’il n’a pas à dissuader celui qui part à sa quête. Drôle de salade dont l’analyste a lui-même à s’y retrouver, c’est-à-dire à éclairer le rapport qu’il établit dans l’orientation de ses cures entre la vérité et le réel.
En effet, « il est clair que, à venir vers vous, c’est après du vrai qu’on court » [2], du côté de l’analysant, la quête d’une vérité sur l’énigme du symptôme permet à une analyse de commencer, pas d’analyse sans un point d’opacité, les entretiens préliminaires étant là pour le vérifier. Cette opacité déclenche la question qui fait de la quête d’une vérité, une quête de sens : « Qu’est-ce que ça veut dire ? » L’inconscient est alors l’hypothèse qui viendrait expliquer ces émergences absurdes et insensées (acte manqué, rêve, lapsus, symptôme). Pour l’analysant, il y a attente d’une vérité qui se manifeste sous la forme d’une attente de sens, il veut donner sens à l’insensé. Ici ce qui opère est une opposition entre conscient et inconscient, car les effets de vérité sont le résultat d’un retour du refoulé, c’est l’heure de la révélation.
Néanmoins, à chaque fois, celle-ci est incomplète, partielle, imparfaite, relative. » [3] Le poète questionne « Sommes-nous voués à n’être que des débuts de vérité ? Cela tient à la structure même du discours et du désir : entre S1 et S2, entre surgissement et savoir, la vérité obtenue est incomplète et fragmentaire. Elle tient à une articulation qui risque de se révéler remaniable à chaque visite. Qu’on la rate fait que l’on court après [4].
La vérité est « trompeuse », pourrions-nous dire afin de l’opposer à la vérité « menteuse », mise en valeur à propos de la passe en 1976 [5]. Sous la logique d’une quête de vérité trompeuse, la fin de l’analyse devient problématique, puisque la vérité parle, mais ne conclut pas. L’avertissement de Lacan signale une méfiance : si vous devez vendre de la vérité pour commencer une analyse, n’en revendez pas pour la conclure !
Lacan ne semble pas avoir attendu les effets sur la vérité auxquels le monde contemporain nous confronte pour la désacraliser. Son dernier enseignement porte sur le décalage entre le vrai et le réel et, de ce fait, se déduit un autre témoignage qui cherche à « Mesurer le vrai au réel » [6] : « Pourquoi dès lors ne pas soumettre cette profession à l’épreuve de cette vérité dont rêve la fonction dite inconsciente, avec quoi elle tripote ? Le mirage de la vérité, dont seul le mensonge est à attendre […] n’a d’autre terme que la satisfaction qui marque la fin de l’analyse » [7].
Ce passage m’a toujours frappé, car l’inconscient est défini comme un rêve de vérité. S’il est un rêve, il porte un wunch : l’inconscient rêve d’accéder à la vérité. Si pendant la cure le sujet s’efforce à dire le vrai, la passe témoigne de la faille de cette vérité qui est venue voiler le réel. La façon dont le sujet a produit du sens à partir d’un point de réel, c’est ce que la fin de l’analyse mesure. La narration ne se contente pas de sa belle forme. Le témoignage rend à la vérité trouvée dans l’analyse son statut d’histoire, d’élucubration, de mirage. Il s’agit de faire surgir, au-delà du sens, les marques et les traces écrites sur un corps qui en éprouve les effets. Aller jusqu’au point où le discours même reconnait son mensonge à dire le réel. Non pas expliquer, mais dire au plus juste le trauma par des mots qui font résonner ce qu’ils échouent à dire.
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre IX, « L’identification », leçon du 29 novembre 1961, inédit.
[2] Ibid.
[3] Char R., Fureur et Mystère, Paris, Gallimard, 1967, p. 130.
[4] Cf. Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 571.
[5]« Je l’ai laissée à la disposition de ceux qui se risquent à témoigner au mieux de la vérité menteuse » (Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », op. cit., p. 573.)
[6] Miller J.-A., « La passe bis », La Cause freudienne, n°66, mai 2007, p. 213, disponible sur internet.
[7] Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », op. cit., p. 572.