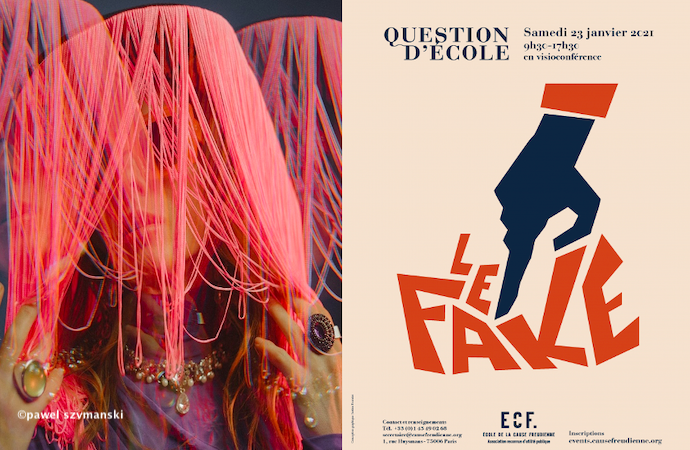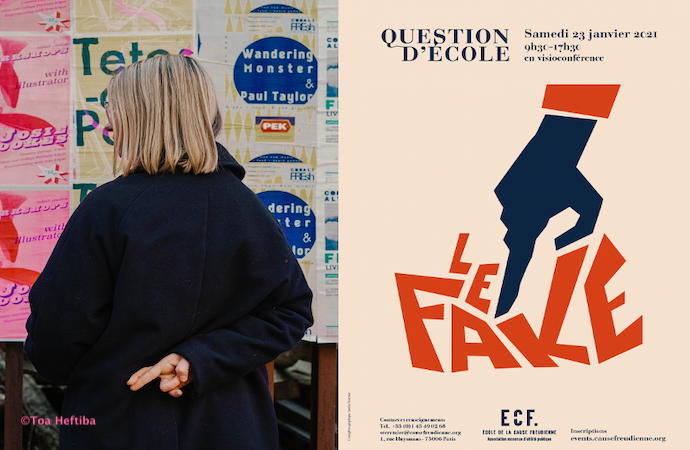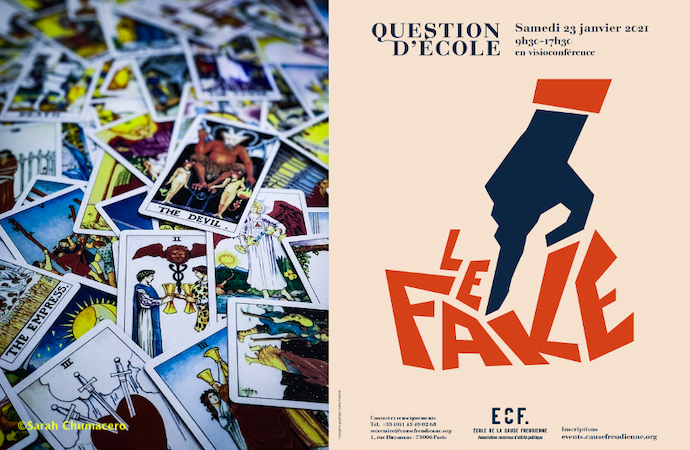Au commencement était la vérité : l’invention de la psychanalyse par Freud place la parole vraie au centre du procès analytique. L’interprétation permettrait au sujet d’accoucher d’une vérité inconsciente qui affecte son corps. Le symbolique doit traiter le symptôme hystérique, qui se révèle rétif à l’interprétation. Avec la réaction thérapeutique négative, Freud constate les limites de l’action analytique visant à lever le symptôme par l’émergence d’une vérité refoulée.
Lacan y met son grain de sel en considérant que la vérité ne peut que se mi-dire, et surtout qu’elle est foncièrement menteuse : « fait d’hystoire, autant dire d’hystérie » [1], souligne-t-il en 1976, dans un texte fulgurant qui vient ponctuer son Séminaire [2] consacré à Joyce le Sinthome.
L’hystérie, on le sait, se spécifie de son lien au discours de l’Autre et d’un amour de la vérité qui peut s’avérer sans limite : compléter l’Autre jusqu’au sacrifice, faire consister la Vérité comme toute, faire exister La femme, sont autant de façons de refuser l’inconsistance de l’Autre.
Se déprendre du mirage de la vérité devient alors l’enjeu d’une analyse orientée, au-delà des semblants, par le réel. Un réel qui est celui du trou, du traumatisme, de l’urgence qui précipite un sujet en analyse, avant que le sujet supposé savoir ne s’instaure et que la chaîne signifiante ne se déploie.
Avec Lacan, la vérité est dévaluée, transformée en des « effets de vérité » toujours relatifs, ou en une vérité variable qui devient varité. Lacan nous conduit au point de bascule où « cette stratégie de la vérité doit faire sa place au mensonge qu’elle comporte » [3]. Car le déploiement de la chaîne signifiante ne peut que rater le réel en jeu. L’« esp d’un laps », c’est le surgissement d’un réel évanescent qui surprend le sujet – « alors seulement on est sûr qu’on est dans l’inconscient. On le sait, soi. Mais il suffit que s’y fasse attention pour qu’on en sorte » [4].
Lacan fait ici valoir le trébuchement de la langue, l’espace d’un lapsus, comme ce qui ne relève plus des formations de l’inconscient, mais d’un réel sans loi. Alors qu’il vient de consacrer son Séminaire à un Joyce « désabonné de l’inconscient » [5], c’est sa façon subversive de nous introduire à un inconscient qui n’est plus transférentiel, mais réel, surgissant dans la coupure et renvoyant chacun à une solitude radicale.
« Pas d’amitié n’est là qui cet inconscient le supporte. Resterait que je dise une vérité. Ce n’est pas le cas : je rate. Il n’y a pas de vérité qui, à passer par l’attention, ne mente. » [6]
Dès lors, l’horizon de la cure ne sera plus le savoir mis en place de vérité, mais la satisfaction de la fin d’analyse. Une perspective nouvelle s’ouvre pour la passe.
S’adressant à « des épars désassortis » qui « se risquent à témoigner au mieux de la vérité menteuse », la passe du dernier Lacan devient une « mise à l’épreuve de l’hystorisation de l’analyse » [7]. Il s’agit pour chaque Un de réinventer la psychanalyse en démontrant que « la vérité en tant que varité n’est qu’un semblant au regard de ce qui est réel » [8].
L’esp d’un laps vient radicaliser l’impasse logique annoncée dans « Télévision » : « La dire toute, c’est impossible, matériellement : les mots y manquent. C’est même par cet impossible que la vérité tient au réel. » [9]
Comme l’a montré J.-A. Miller, l’enjeu pour Lacan était de libérer la psychanalyse de la croyance au vrai, qui faisait son point commun avec la religion. Lacan a voulu « pousser la psychanalyse hors d’elle-même, l’obliger à considérer son opération d’une autre perspective que celle du vrai » [10]. Atteindre au réel traumatique est ce qui rend la vérité obsolète, et ramène le parlêtre à une solitude fondamentale. Celle de Freud, et aussi celle de Lacan.
[1] Lacan J. « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 571-573.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005.
[3] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », enseignement prononcé au département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 15 novembre 2006, inédit.
[4] Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », op. cit., p. 571.
[5] Lacan J., « Joyce le Symptôme », Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, op. cit., p. 166.
[6] Lacan J., « Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI », op. cit., p. 571.
[7] Ibid., p. 573.
[8] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », op. cit., cours du 22 novembre 2006.
[9] Lacan J., « Télévision », Autres écrits, op. cit., p. 509.
[10] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan », op.cit., cours du 22 novembre 2006.