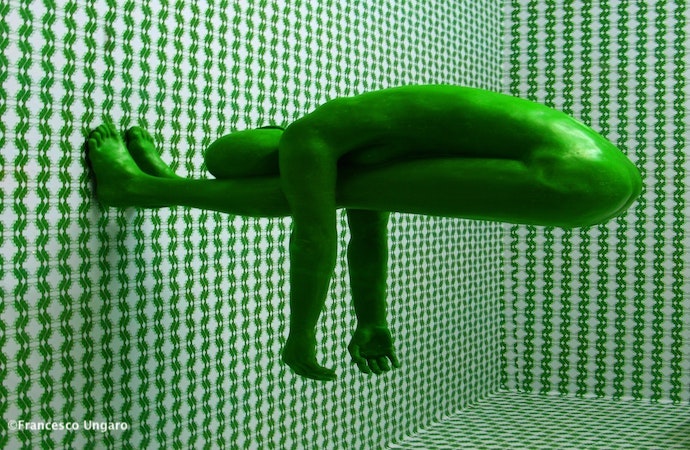C’est en 1979, dans son court texte « Lacan pour Vincennes ! », que l’on peut lire, en référence à Freud : « Il a considéré que rien n’est que rêve, et que […] tout le monde est fou, c’est-à-dire délirant. » [1]
Cette phrase suit son interrogation sur l’enseignement de la psychanalyse : « Comment faire pour enseigner ce qui ne s’enseigne pas ? » [2]. Et il ajoute : « Mais reste à le démontrer ».
Ce qui ne peut s’enseigner, à suivre Lacan puis Jacques-Alain Miller, c’est le réel, car il est hors sens et hors savoir. Excepté, peut-être, pour le discours analytique, c’est la grande question de Lacan dans son dernier enseignement.
Tout le monde est délirant, vient à dire Lacan, parce que tout sujet est irrémédiablement séparé du réel par le langage. Le délire est la réponse à l’impossible accès au réel.
L’idée générale, classique, que nous avons de la folie et du délire, et ce depuis toujours, concerne un petit nombre. Avant Lacan, le délire n’a jamais été considéré comme universel. Le délire concerne la psychose, il en est une des manifestations majeures. Le névrosé ne délire pas, au sens classique de la psychiatrie. Le délire, Freud l’a écrit [3], est la conséquence d’une perte de la réalité, le moi se coupe d’une part de la réalité. Le délire est une reconstruction à partir de cette perte : « le nouveau monde extérieur fantasmatique de la psychose veut se mettre à la place de la réalité extérieure » [4].
Jusque dans les années 70, Lacan garde la notion de binaire névrose-psychose. Cette répartition se fait à partir de l’Œdipe freudien. La grande majorité des humains s’inscrit dans la structure œdipienne (logique structurale langagière), les autres ne s’inscrivent pas dans cette logique, ils sont coupés de la réalité œdipienne et ils construisent, chacun à leur façon, une autre réalité, dont le délire a la part principale.
Comment Lacan en est-il arrivé à faire du délire une réponse pour tous ?
Cela ne peut être considéré qu’à partir de la logique lacanienne du nouage borroméen comme représentant de la psyché humaine, le nouage des trois registres : imaginaire, symbolique et réel.
Lacan considère que tout sujet a à constituer son nouage, suivant sa singularité. Certains, de moins en moins de nos jours, sont pris dans un nouage ready made qui s’appelle l’Œdipe et le Nom-du-Père. Très « à la mode » à la fin du XIXe siècle et dans le monde paternaliste de la première moitié du XXe, il a aujourd’hui perdu de sa superbe. La structure œdipienne n’est plus si présente, et c’est dans ce contexte que Lacan a dégagé la voie du nouage singulier, de la trouvaille que chacun a à faire pour nouer les trois registres et ainsi bricoler une tenue dans l’existence.
Mais cela n’est pas encore suffisant pour saisir la généralisation du délire. Dans son tout dernier enseignement, Lacan déplace la question de l’inébranlable binaire structural névrose-psychose, entre Nom-du-Père et forclusion du Nom-du-Père. Il part du réel et de la nécessité pour chacun de s’en défendre. La mise en valeur, la mise en exergue du réel à la fin de l’enseignement de Lacan inverse toutes les données antérieures de la psychanalyse. Ce n’est plus le rapport au langage qui domine, la recherche du sens et de la vérité, mais bien plutôt la façon dont chacun se défend du réel par l’élaboration d’un nouage singulier RSI.
Toute construction singulière, quelle qu’elle soit, reste du semblant, un mixte d’imaginaire et de symbolique pour se défendre du réel, qu’il s’agisse du semblant œdipien, d’un autre ou encore de multiples autres. C’est ainsi qu’on peut saisir que tout le monde délire. Toute construction imaginaire-symbolique à l’égard du réel est considérée par Lacan comme un délire du fait qu’il n’y ait pas de discours « qui ne [soit] pas du semblant » [5].
[1] Lacan J., « Lacan pour Vincennes ! », Ornicar ?, n°17/18, printemps 1979, p. 278.
[2] Ibid.
[3] Freud S., « La perte de la réalité dans la névrose et dans la psychose », Névrose, psychose et perversion, Paris, PUF, 1973, p. 299-303.
[4] Ibid., p. 303.
[5] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2007.