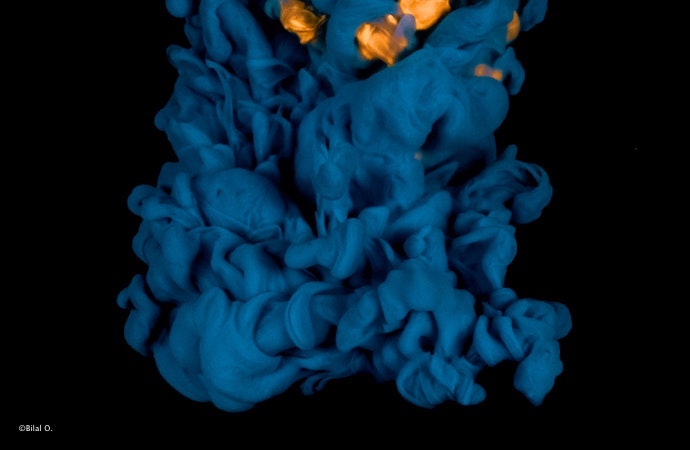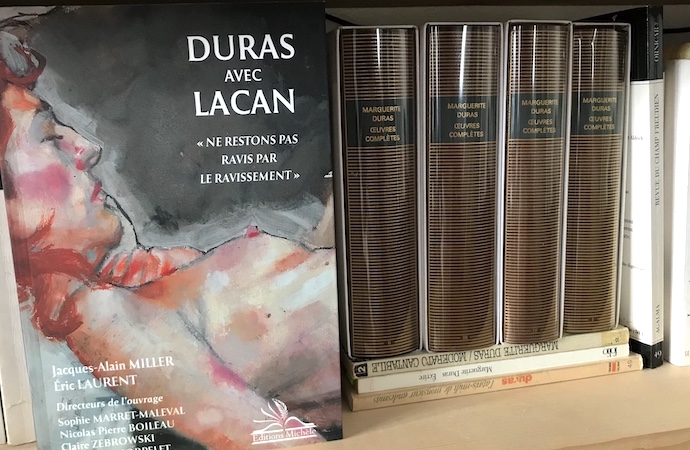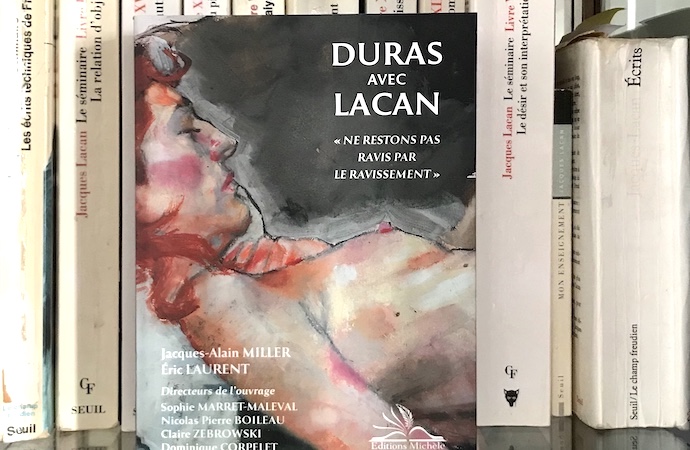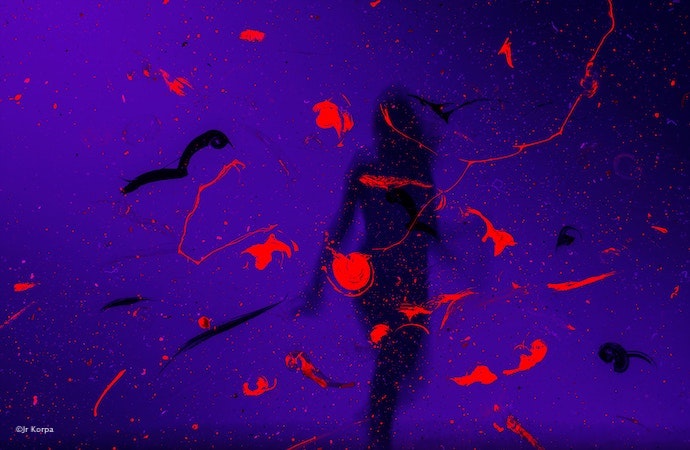L’homme de plume se fascine parfois pour l’illettré qui incarne la limite de l’empan de son oeuvre : Queneau, Céline aiguisent chacun un style du parler peuple, Borges rêve au gaucho, Paulhan au premier-venu, Malherbe s’inspire du crocheteur du port au foin qui parle sans le savoir La langue parfaite… Orwell ajoute l’homme de la rue, Sartre le « tous ou n’importe qui ». Je suis – mais n’est-ce pas plutôt on est ? –, le temps de le lire, le dernier des Mohicans ou le premier homme, inachevé, de Camus. Autant de Noms-du-père dans la civilisation, panneaux sur la route de « LOM » [1] et des « trumains » [2] n’empêchant pas l’insistante présence de la pierre : Magritte la suspend au-dessus de nos têtes ; Drummond de Andrade [3] l’installe au milieu du chemin : d’une pierre l’autre, n’est-ce pas le parcours d’une analyse qui peut, juste le temps de le dire, se figurer ainsi ?
Son nom de psychanalyse…
Avec l’incipit de la Traumdeutung, le lieu de l’inconscient est nommé [4]. Dernier venu dans cet enfer, lettré aimant les arts, Freud n’y fut pas mieux accueilli [5] que par ses pairs de la faculté des sciences, ce pourquoi il fit des compromis – création de l’International Psychoanalytic Association, réception du prix Goethe [6] –, pourvu que demeure le lien entre nom de psychanalyse et ce qu’il nomme, à savoir l’inconscient en tant que réalité sexuelle. Reste donc ce nom, pierre au milieu du chemin qui mène de la commune condition mortelle aux jouissances autistiques des « uns » désaccordés [7]. Sur ce chemin, la préséance ou la concurrence entre les artistes et les psychanalystes est fausse, mais vraie la divergence qui marque le parlêtre.
Portes ouvertes et refermées
Je ne résiste pas à citer l’essai d’un maître : Emerson, dont George Apley, père d’une fille qui lui donne du fil à retordre dans le film de Mankiewicz, Un mariage à Boston [8], s’enseigne pour tenir la corde et qu’il compare sans cesse… à Freud : « Chacun devrait apprendre à déceler et à observer les éclats de lumière qui viennent du fond de son esprit, plus que les scintillations du firmament des poètes et des sages. Cependant nous écartons nos pensées sans y prêter attention, parce que ce sont les nôtres. Dans toute œuvre de génie, nous reconnaissons les pensées que nous avons rejetées : elles nous reviennent avec une certaine grandeur dont on se sent dépossédé. C’est la leçon la plus marquante des grandes œuvres d’art. Elles nous apprennent à rester fidèles à notre impression première » [9].
Rien que d’impartageable en son fond
L’artiste, le philosophe, le poète, s’ils se servent de l’inconscient, restent serfs de leur élection de l’objet langue ; proprement manié du fait d’un savoir-faire nouveau qui émeut la pulsion, cet objet supposé commun peut, par contamination insidieuse, colorer d’universel les objets qui vibrent et fascinent – regard, voix. Chacun qui croit s’y retrouver oublie qu’il s’oublie pour que ces retrouvailles aient lieu, dans l’étrange proximité des œuvres qu’il élit.
Poussé dans ses derniers retranchements, le lecteur amoureux peut néanmoins, pour peu qu’il ait un rapport juste avec l’inconscient, rejoindre le créateur au point où se séparer de ce que Ferdinand Alquié a nommé Le Désir d’éternité [10]. Catherine Millot le montre dans son dernier livre [11] Un peu profond ruisseau…
Conversant avec Pierre Soulages [12], en présence de leur ami commun Pierre Encrevé, Jacques-Alain Miller s’est intéressé à l’exploration de l’outrenoir, ainsi qu’à l’éthique de la peinture, puisque de l’art il y a « à prendre de la graine » [13].
Il est plaisant que la femme de l’artiste ait fait savoir que cet entretien, qui ne ressemblait à aucun autre, était, selon les époux, du meilleur cru.
[1] Lacan J., « Joyce le Symptôme », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 565.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XXV, « Le moment de conclure », leçon du 17 janvier 1978, inédit.
[3] Miller J.-A., L’Os d’une cure, Paris, Navarin, 2018, p. 10-21.
[4] Si nequeo Superos, Acheronta movebo.
[5] D.-H. Lawrence ironisa sur la trivialité de la découverte freudienne.
[6] Notons la concomitance pour Freud de cette élection avec la parution, la même année à Vienne de Malaise dans la civilisation.
[7] Cf. Terrisse Ch., « The smell of us, le film », Lacan Quotidien, n°518, 23 juin 2015, publication en ligne.
[8] Mankiewicz J. L., The Late George Apley, trad. Un mariage à Boston, film, États-Unis, 1947.
[9] Emerson R. W., Compter sur soi, Paris, Allia, 2018, p. 9-10.
[10] Alquié F., Le Désir d’éternité, Paris, PUF, 2014.
[11] Millot C., Un peu profond ruisseau…, Paris, Gallimard, 2021.
[12] Soulages P., « Soulages le réfractaire », entretien avec J.-A. Miller, P. Encrevé, N. Georges-Lambrichs & P. Fari, La Cause freudienne, n°75, juillet 2010, p. 135-167, disponible sur Cairn.
[13] Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 9 avril 1974, inédit.