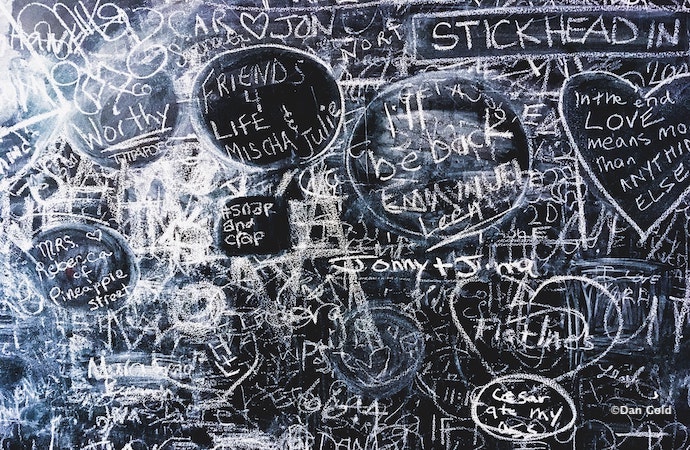D’aussi loin que je me souvienne, j’aime (peut-être plus que tout) les « lecteurs » qui, de façon inventive, font d’un texte écrit une architecture et ne cessent de la parcourir, d’y revenir, de dériver dans les espaces qui s’y déploient, avec leurs recoins secrets et autres culs-de-sac. Ces derniers sont bien plus passionnants que les larges avenues où règne en maître le principe dit de Boileau : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, / Et les mots pour le dire arrivent aisément. » [1] Belle foutaise qui vérifie la phrase de Lacan : « sottise, qui se redit dans les lettres, de quoi la faute, comme toujours, revient aux spécialistes » [2] !
À cet amour, il faut lui donner son nom de passion, pris chez Descartes, qui le distingue du « se rendre aimable » : l’admiration. Le « lecteur » ne crée pas cette architecture – elle lui préexiste. Mais, sans lui, elle demeure morte. L’architecture textuelle n’est pas une, elle est plurielle, contradictoire, rhizomatique. Chaque lecture en invente une nouvelle. Un texte, lorsqu’il est connu, prend de l’âge, marque son temps, devient architectures superposées, emmêlées – un palimpseste. Le « lecteur » que j’aime (c’est-à-dire que j’admire) n’est pas occasionnel. Il ne cède jamais, il y voue toute sa vie. Il est topographe et promeneur, parfois alpiniste. Il repère et parcourt – et sa vie est là-bas, à Babel.
J’ai rencontré Jacques Aubert au milieu des années 1990 à l’occasion de ma thèse [3] à Paris 8. La conversation tutoyée entre nous commença mezzo voce et, au fil des années, elle s’est poursuivie, jusqu’à aujourd’hui. Un « lecteur » se reconnaît à ceci : même lorsqu’il vous dit bonjour ou vous parle du plus banal, il engendre un récit – soit un texte et une énonciation qui épelle les promenades, passages et transitions. Vous voilà aussitôt logé dans un bout de récit. Jamais je n’ai éprouvé autre chose avec Jacques : que le récit ne soit pas au-dehors, en plus ou un exercice. Le récit est la vie. Ce, parce que « le vrai est toujours neuf » [4]. Jamais il ne m’ennuya.
Chaque fois que je voyais Jacques, je lui reposais la même question. Je m’en excusais presque sachant que je l’interrogeais, frontalement (donc grossièrement), sur son amour d’un anglais disloqué, démantibulé, réinventé par Joyce qu’il traduisait ou mieux décryptait. La question était indiscrète. L’été, invité dans sa maison de campagne en Provence, « La Chapelle », je lui reposais la question sachant que le temps ne nous était pas compté. Chaque fois, il répondait par des saynètes qui apparemment n’avaient aucun rapport avec sa recherche : les loirs qui, la nuit, faisaient la sarabande dans les combles, l’anglais que pendant son service militaire il enseigna à la fille d’un colonel, un incroyable périple pour vendre une 2CV pur jus, etc. La description était fine, avec ses effets sur l’auditoire, non sans les détails qui introduisaient un suspens avant la chute. Quelle chance ! Car jamais il ne fut psychologue de sa lecture/passion pour Joyce. Il sut toujours éviter l’obscène de la psychobiographie. La preuve ? Dans son « Exposé au séminaire de Jacques Lacan », prononcé le 20 janvier 1976, Jacques Aubert livre une lecture qui force le respect et l’intelligence de ce qu’est lire un texte posé comme « illisible »[5]. Que dit-il ? Je cite en sept points, presque au hasard, ce qui fait non pas protocole (« frotti-frotta littéraire »[6]), mais pratique :
- Suivre un texte [7]
- « par petits morceaux » [8]
- en se faufilant (= « conscience du faufil » [9])
- pour le faire fonctionner [10]
- afin d’y repérer dans ses entrelacs [11]
- hors la « pièce définitive » [12]
- « ce qui fait mine de trou » [13].
Je cite : « Car cela se tient, cela fonctionne, et des choses se passent justement à côté de ce qui fait mine de trou. Justement le tour de main de Joyce consiste, entre autres choses, à déplacer […] l’aire du trou de manière à permettre certains effets » [14]. Il ajoute : « à côté justement de ce qui fait mine de trou il y a les déplacements de trou et il y a les déplacements du nom du père » [15].
Au début de son exposé, Jacques Aubert se crée un nom de lecteur : il se dit « cantonnier » parce qu’il questionne les « accotements » de l’écrit joycien plutôt que la « voie royale ». Mais l’expression qu’il utilise, dans son équivoque, fait mouche : devant Lacan, il tient des « propos à la cantonnier » [16]. Chacun a entendu : des propos à Lacan… tonnier. N’est-ce pas une belle illustration de comment « faire litière de la lettre », pas sans le trou où passe a litter [17] ?
[1] Boileau N., « Chant I », L’Art poétique, in Œuvres poétiques, vol. I, France, Imprimerie générale, 1872, p. 209, disponible sur internet.
[2] Lacan J., « Kant avec Sade », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 765.
[3] Pour laquelle il écrivit une postface dans sa version publiée : Aubert J., « Postface », in Castanet H., Pierre Klossowski. Corps théologiques et pratiques du simulacre, Bruxelles, La Lettre volée, 2014.
[4] Jacob M., cité par J. Lacan, in « Propos sur la causalité psychique », Écrits, op. cit., p. 193.
[5] Aubert J., « Préface », in Joyce J., Ulysse, Paris, Gallimard, 2013, p. 7. Sur le lien lecture/texte à propos d’Ulysse, p. 36 : « une œuvre résistant pareillement à la lecture : plutôt qu’un roman, un texte ; autrement dit, selon la tradition, la comparution d’un fragment d’écriture autorisant à relancer la parole ».
[6] Lacan J., « Lituraterre », Autres écrits, Seuil, Paris, 2001, p. 12.
[7] Cf. Aubert J., « Exposé au séminaire de Jacques Lacan » in Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 177.
[8] Ibid., p. 174.
[9] Ibid., p. 171.
[10] Cf. ibid., p. 177.
[11] Cf. ibid.
[12] Ibid., p. 171.
[13] Ibid., p. 177.
[14] Ibid.
[15] Ibid., p. 182. Et pour l’exemple appliqué au mot mud/mother : cf. p. 178-179.
[16] Ibid., p. 171.
[17] Lacan J., « Lituraterre », op. cit., p. 11.