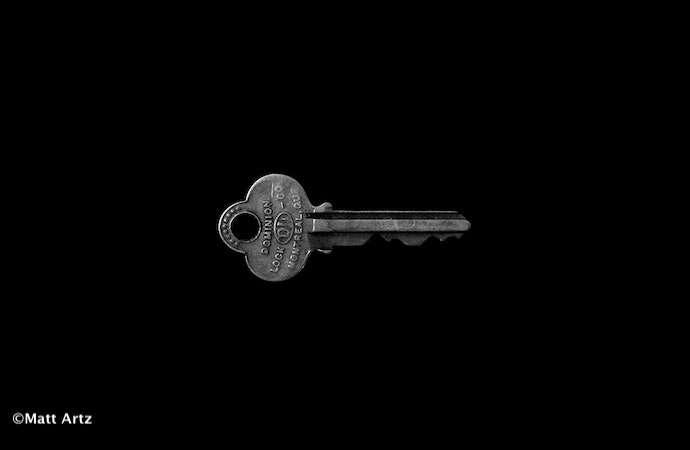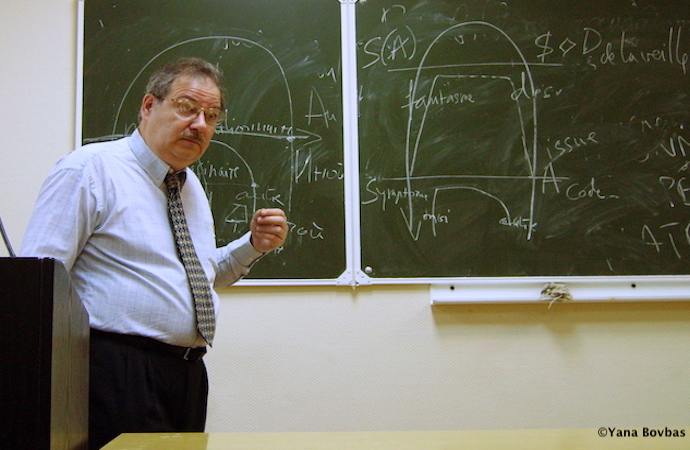Les hallucinations verbales psychotiques ont incontestablement un statut spécial dans la psychanalyse lacanienne[*]. On ne retrouve ce statut comme tel ni dans les autres formes de psychanalyse, ni dans les théories psychanalytiques de l’hallucination verbale. La première chose indispensable est de situer la conception lacanienne par rapport aux conceptions psychiatriques. Historiquement, elle est liée à ce qu’Henri Ey a appelé le passage de l’hallucination comme perception sans objet à la pseudo hallucination.
Trois successeurs de Séglas
Alors qu’au XIXe siècle, la thématique de l’erreur hallucinatoire est massive, et restera inentamée dans la psychiatrie anglo-saxonne, conférant à celle-là un retard dont elle ne s’est guère rattrapée, le passage au XXe siècle est marqué, dans la psychiatrie francophone, par le recentrement sur les hallucinations verbales, et tout particulièrement le phénomène de Séglas, dans lequel il est démontré que les voix hallucinées sont proférées in petto par le sujet halluciné, et qu’une continuité peut être prouvée entre pensée, discours intérieur, profération et impulsion verbale ; un mouvement que j’ai appelé « désensorialisation des hallucinations verbales » [1].
Ce phénomène, central, mais pas unique, dans ce qu’on a appelé la seconde psychiatrie classique française, donnera lieu à plusieurs interprétations divergentes, dont au moins trois nous intéressent :
- Celle de Gaëtan Gatian de Clérambault qui en propose une explication irritative (lésion serpigineuse) et qui, dans presque tous les cas, exclut la notion d’une signification qui y serait immédiatement attachée.
- Celle de Henri Ey, (qui fait préfacer par Séglas son premier ouvrage sur les hallucinations), qui insiste contre Clérambault sur la solidarité indissociable entre délire et hallucinations psychotiques, solidarité qui, formellement, se retrouve dans la continuité reconnue dans les années 1920 par l’École française entre intuition délirante, pensées imposées et hallucinations verbales. Ey prétend rendre compte de cette unification, en s’inspirant de Wilhelm Mayer-Gross et en présentant tout vécu délirant comme un trouble de la conscience.
- Initialement solidaire de Ey sur la nature de l’automatisme et la continuité des vécus élémentaires psychotiques, Lacan s’en sépare, tant de la dépendance de celui-ci vis-à-vis d’une phénoménologie centrée sur la conscience, que pour l’avoir, dans les congrès qu’il organise, systématiquement mis en position d’orateur second. D’où l’énigmatique proclamation que Clérambault serait son « seul maître» en psychiatrie [2] – rappelons-nous que Ernst Kretschmer, un des très rares défenseurs avec Robert Gaupp de la notion de paranoïa en Allemagne après 1918, déclarait que Lacan était son élève direct et que Lacan évoque à plusieurs reprises l’importance de G. Petit [3] dans ses propres élaborations, etc. –, certes référable à la prévalence de la chaîne signifiante, mais aussi vengeresse par rapport à la semi-trahison de Ey, sans préjudice des nombreuses critiques que Lacan adresse à la théorie de Clérambault.
Hallucination et énonciation
Un second pas consistera, logiquement, à attacher l’hallucination à la question de l’énonciation, spécialité de la linguistique francophone depuis Charles Bally, et encore aujourd’hui. Toute une série de textes de Lacan portent sur cette question, notamment le Séminaire III [4] qui peut être considéré à maints égards, comme je l’ai montré [5], comme un débat avec les thèses d’Édouard Pichon. Le plus clair des apports de Lacan en résultera, et notamment la thèse selon laquelle les phénomènes élémentaires sont une sorte d’énonciation, dont le modèle articule une principale et une relative, en jouant sur la notion, hautement controversée, d’une latitude propre au français concernant l’accord des personnes entre l’une et l’autre, de façon unique défendue par Damourette et Pichon. Le « Tu es celui qui me… » pichonien est ainsi élevé par Lacan à la hauteur de structure élémentaire réglant les rapports entre énonciation et énoncé, avec comme conséquence d’appeler énonciation deux choses distinctes : le « tu » préalable (dont le développement complet donnera « notre message nous revient de l’Autre sous une forme inversée »), et la façon, dont, dans le sujet, quelque chose y répond, qui l’y lie et l’en distingue tout à la fois. Voilà donc un point de discorde particulièrement massif par rapport aux travaux anglo-saxons. Pour tout analyste de l’IPA, une hallucination reste une erreur de jugement, et la référence tardive, depuis Feighner, aux symptômes de premier rang de Kurt Schneider n’est pas faite pour arranger les choses ; pour un analyste lacanien, une hallucination est un type particulier de rapport entre énonciation et énoncé pouvant se dissimuler de diverses façons.
Effets de retour
Autant la notion de phénomène élémentaire a été construite par Lacan en référence à cette question de l’énonciation, autant cette dernière a profité de cette application. Le graphe du désir est littéralement construit sur la base d’une structure bipartie des hallucinations verbales (M=C/M et C=M/C) [6], qui a d’importantes conséquences au niveau de l’étage supérieur, où fantasme et désir modulent jouissance et castration. Autrement dit, la structure des hallucinations est la base d’où dérive la structure du sujet de l’inconscient, comme une variante de celle-ci. Pratiquement, je constate que ce graphe reste difficilement lisible pour qui ne dispose pas de cette notion. L’hypothèse de « l’inconscient interprète » [7], relevée par Jacques-Alain Miller lors de discussions sur la passe, en réponse à la notion de « déclin de l’interprétation » [8] proposée par Serge Cottet, peut également être lue comme une conséquence de la prévalence du modèle de l’hallucination verbale. Une autre conséquence est l’opposition frontale entre l’approche lacanienne et celle de l’IPA concernant la question paternelle. Alors que le modèle classique de l’IPA est centré sur la solidarité entre une instance paternelle garante de la réalité et la fonction de contrôle d’un moi supposé a-conflictuel, mais dans les faits obsessionnalisant, le modèle qui se maintient chez Lacan à partir des années 1950 fait fond sur la fonction de la nomination, c’est-à-dire l’envers de l’insulte hallucinatoire, de la persécution et de la perplexité (ou absence de signification).
Hallucination et supposition de savoir
Autre conséquence encore, sur le traitement du transfert par Lacan, c’est une banalité de dire que les mathèmes lacaniens s’inspirent de mécanismes psychopathologiques, et le destin du discours de l’hystérique comme modèle du discours analytique est dans toutes les mémoires. Il faut certainement y ajouter la supposition de savoir qui en quelque sorte décentre la passion hystérique pour l’intersubjectivité imaginaire [9]. Rappelons qu’on doit à Joseph Capgras la notion de « délire de supposition », ce qui n’a probablement pas eu moins d’importance que la référence à l’hupokeimenon aristotélicien. Ce décentrement, rien ne le manifeste mieux que l’hallucination elle-même. Écho par où se défait la familiarité spéculaire, énigme s’imposant dans le grain d’une voix, soupirs énigmatiques dont le sujet se trouve entouré, sensorialisant a minima l’étrangeté de l’ambiance (Wahnstimmung), à moins qu’un retournement se réalise dans une profération pouvant osciller du questionnement obsédant à l’insulte, on peut multiplier à l’infini les exemples. Tous marquent la façon dont la supposition de savoir prend naissance de façon brute chez le psychotique, alors que le névrosé, au contraire, tend à s’assurer au préalable que « l’habit ne va pas au psychanalyste » [10]. Un étonnant récit de passe témoignait, il y a une dizaine d’années, jusqu’à quelles extrémités de désupposition ceci peut aller pour un sujet hystérique, disons, sans ambages. D’où d’ailleurs le paradoxe que l’incroyance (Unglauben) aille de pair avec cette imputation brute de savoir, comme s’en émerveillait Lacan à propos de Cantor – sauf dans l’ironie schizophrénique.
Le retour de l’objet
Mais si le tournant marquant, dans le domaine francophone – la prévalence de l’hallucination verbale sur la conception romantique de l’hallucination comme « perception sans objet » (« à percevoir » précisait Ey) –, a fait date, une conséquence curieuse de sa lecture lacanienne a été de faire renaître l’objet hallucinatoire sous une tout autre forme, comme « pure énonciation » détachée de tout énoncé [11], objet n’incluant pas la séparation.
Nous remercions Damien Guyonnet qui a trouvé cet article paru dans La Lettre mensuelle (n°276, mars 2009, p. 22-24), nous permettant de publier ce texte original de François Sauvagnat ; et le travail de Mauricio Diament qui l’a transcrit précisément, et en un temps éclair.
Références bibliographiques
Capgras J., « Le délire d’interprétation hypothétique. Délire de supposition », Annales médico-psychologiques, 88, t. II, novembre 1930, p. 272-299.
Sauvagnat F., « Fatherhood and naming in Jacques Lacan’s works », The Symptom. Online Journal for lacan.com, n°3, automne 2002, publication en ligne (www.lacan.com/fathernamef.htm).
Sauvagnat F., « La systématisation paranoïaque en question », in Hulak F. (s/dir.), Pensée psychotique et créations de systèmes. La machine mise à nu, Paris, Érès, 2003, p. 141-175.
Sauvagnat F., « Psychanalyse et linguistique : le surmoi et la question de l’énonciation chez J. Lacan », in Vilela I. (s/dir.), Freud et le langage, Éditions langage et inconscient, 2018.
[1] Cf. Sauvagnat F., « La “désensorialisation” des hallucinations acoustico-verbales : quelques résultats actuels d’un débat centenaire », in Collectif, Polyphonie pour Iván Fónagy, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 165-182.
[2] Lacan J., « Propos sur la causalité psychique », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 168.
[3] Petit G., Essai sur une variété de pseudo-hallucination. Les autoreprésentations aperceptives, Bordeaux, Thèse, 1913.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981.
[5] Sauvagnat F., « Hallucinations psychotiques et énonciations », Psychologie clinique, La Voix dans et hors la cure, n°19, mai 2005.
[6] Message = Code/Message et Code = Message/Code.
[7] Miller J.-A., « L’interprétation à l’envers », La Cause freudienne, n°32, février 1996, p. 10.
[8] Cottet S., « Les limites de l’interprétation du rêve chez Freud », La Cause freudienne, n°32, op. cit., p. 129.
[9] Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 247-248.
[10] Cf. ibid., p. 243-259.
[11] Cf. Lacan J., « Kant avec Sade », Écrits, op. cit., p. 765-790.
[*] Communication faite à l’après-midi de l’ACF-IdF et d’APCOF « Les voies de l’hallucination. Enjeux épistémologiques et cliniques » le 22 novembre 2008.