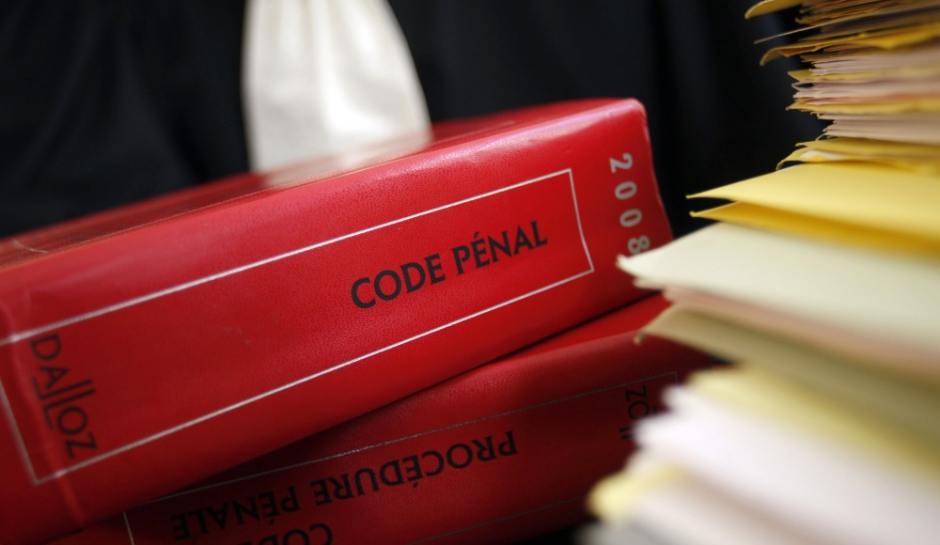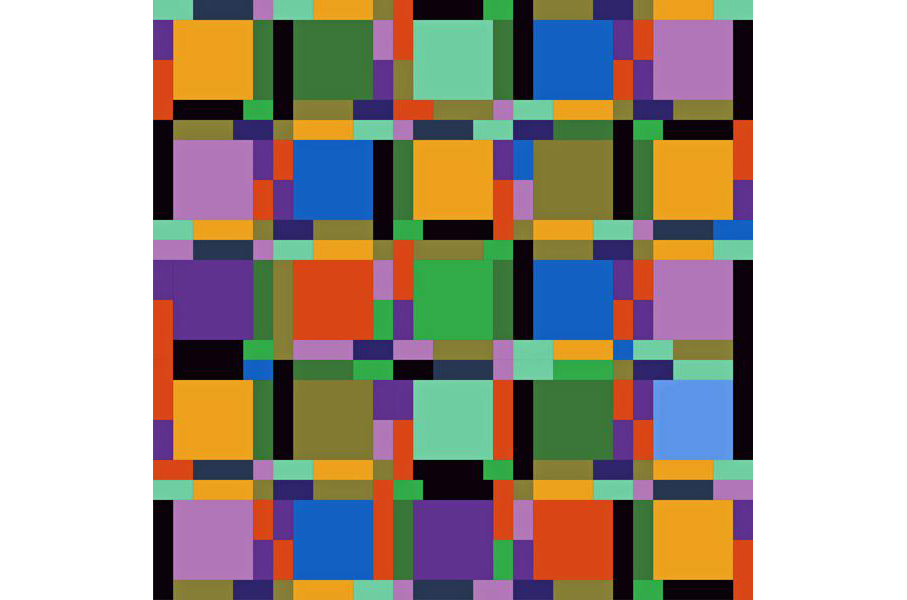Écho de l’ACF-Île-de-France
Selma au Ciné 220
Au cœur de Brétigny-sur-Orge, le cinéma du centre-ville, le Ciné 220, accueille depuis quelques temps l’ACF-Île-de-France pour la projection de films sur l’autisme. Cette année nous avons inauguré une nouvelle manière d’exister dans la ville.
Sensible au thème des prochaines Journées PIPOL, la responsable du cinéma nous a proposé d’intervenir après la projection de Selma, d’Ava DuVernay, programmé en mai dans la série des « soirées-débat » du Ciné 220.
Ces « soirées-débat » sont planifiées pour l’année autour de films choisis par la responsable du cinéma. Le public, des habitants de Brétigny essentiellement, peut s’y abonner ou venir librement. Certains viennent voir le film sans même savoir qu’il sera suivi d’un débat…
Selma relate un événement dont on fête le cinquantième anniversaire cette année. En mars 1965, environ deux ans après l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy et deux ans après le célèbre discours « I have a dream » prononcé le 28 Août 1963 par Martin Luther King, sont menées trois marches partant de Selma en direction de Montgomery, dans l’état de l’Alabama. Ces marches de protestation aboutiront au « Voting Rights Act » que le Président Johnson fit adopter[1].
Il s’agissait donc là d’échanger avec un public « tout-venant » ! Défi relevé par France Jaigu et Xavier Gommichon. Le public s’est passionné pour l’éclairage de F. Jaigu concernant le parti pris de la cinéaste. À partir d’une scène-clé, F. Jaigu a mis en évidence le changement de position du Pasteur King : lors de la seconde marche, face au barrage policier, les manifestants s’agenouillent, prient, puis font demi-tour, renonçant ainsi à se faire victime, à choisir la fonction de martyr.
En ouvrant la conversation avec les paires « victime/bourreau », « bon/méchant », Xavier Gommichon a suscité des réflexions et des questions dans le public, dont certaines témoignent que quelque chose du discours de la psychanalyse « a pris » dans le public. En voici un bel exemple : « Quand on se dit victime, n’y trouve-t-on pas quelque bénéfice ? » !
[1] Le Voting Rights Act (Loi sur les droits de vote) est une loi du Congrès des États-Unis qui a été signée par le président Lyndon Johnson le 6 août 1965. Bien qu'en théorie les Afro-Américains disposaient du droit de vote depuis 1870, depuis le vote des 14e et 15e amendements de la constitution des États-Unis, le droit de vote dans certains États du sud était subordonné à la réussite à un test de type scolaire qui avait pour objectif d’empêcher le vote des Noirs, même pour ceux qui avaient certainement les aptitudes requises. De plus, une taxe était souvent requise avant de voter, que la plupart des Noirs n’avaient pas les moyens de payer. Le Voting Rights Act supprima, entre autres, ces restrictions et permit donc à toute la population noire de voter. Le président George W. Bush a signé son extension pour vingt-cinq ans, le 27 juillet 2006. Lire la suite