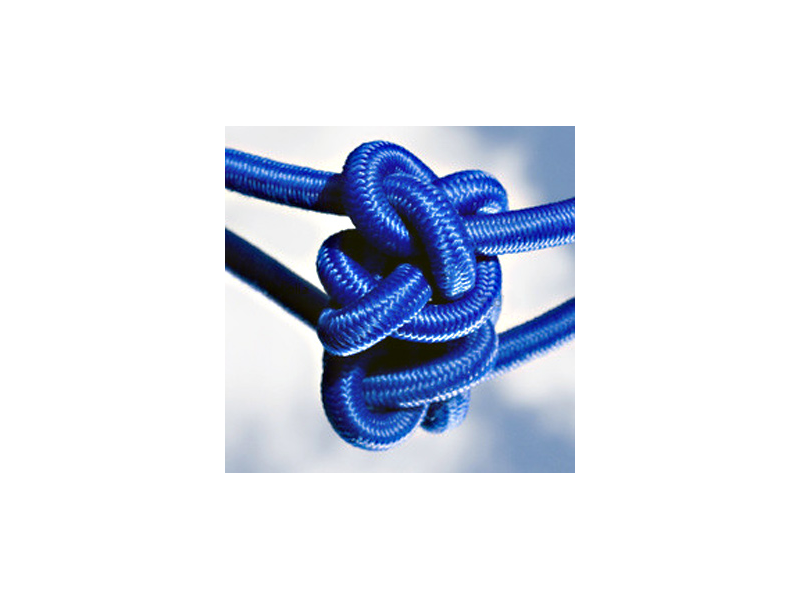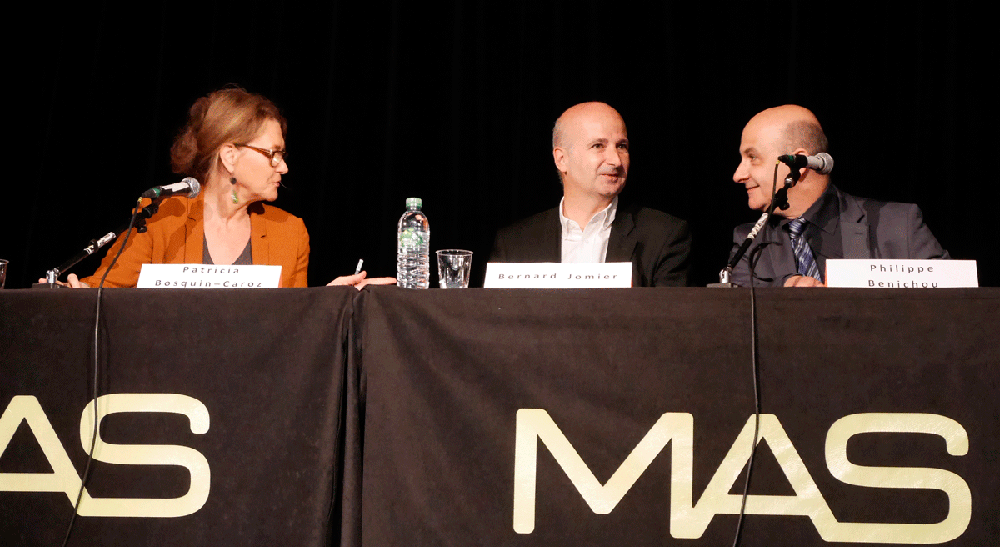Les ressorts d’un symptôme
Jacques-Alain Miller, dans sa conférence du 17 avril 2014 à Paris[1], nous indique que l’interprétation est un dire qui vise le corps parlant pour y produire un événement. Il ajoute que tout ce que l’analyste peut faire, c’est de s’accorder à la pulsation du corps parlant pour s’insinuer dans le symptôme.
Cécile se présente dans les entretiens préliminaires avec deux plaintes autour de la féminité : elle ne parvient ni à rencontrer quelqu’un ni à prendre la parole devant les hommes. La quarantaine, mère célibataire, son parcours professionnel brillant l’amène à diriger et à prendre la parole devant une assemblée essentiellement masculine. Un choix de métier qui la confronte au quotidien à ce qu’elle appelle son symptôme.
À priori, l’amour n’est pas une question pour Cécile. À sa question Comment faire pour être une femme ? elle répond du côté de l’avoir : avoir un enfant, avoir de l’argent et avoir quelqu’un… À la béance ouverte par la question qui porte sur l’être, répond l’avoir phallique. Avoir un enfant et de l’argent, c’est fait. Il lui manque « quelqu’un » pour qu’elle soit enfin une femme. Si elle séduit les hommes par une certaine assurance, lorsqu’il s’agit de la rencontre sexuelle, elle se réfugie dans une posture de petite fille. Elle est pétrifiée et les hommes finissent par la quitter car ils la trouvent « frigide ». C'est dans le discours de sa mère sur les hommes qu'elle situe la cause de ses malheurs. Celle-ci, dépressive, vivant dans l’amertume d’être laissée tomber par le père, qui préférait passer son temps dans le lit de sa maîtresse, lui disait : « Ne sois jamais la femme de, ne dépends jamais de… ». Le ravage mère-fille touche l’énigme de la féminité.
Cécile vient me rencontrer à la suite d’une séparation amoureuse : son nouvel ami l’a quittée pour une autre femme et « ça la fiche par terre ». C'était enfin l’homme qui lui convenait et voilà qu’il la quitte, comme les autres. « Ça se répète », dit-elle, « pourtant c’est un homme mature, avec des vraies valeurs, et un bon père ». Je relève ce « un bon père » et elle associe sur son propre père qui est un homme très à l’aise en public « beau parleur, mais c’est aussi un cavaleur ».
Deux hommes font exception à la série de ceux qui la quittent. Le premier, quitté deux mois avant leur mariage, « je l’ai quitté car je l’ai trompé ; je ne voulais pas être comme mon père, cavaleur ». Dès que Cécile a un aperçu sur son identification au père, elle renonce à être « la femme de ». Le second, rencontré peu de temps après cette séparation, est celui qui fera d’elle une mère. Elle le quittera aussi.
Ses relations amoureuses se terminent la plupart du temps de la même façon : elle est laissée tomber ; les hommes qu’elle choisit sur le modèle du père cavaleur finissent tous par la quitter et ceux qui font d’elle la « femme de », elle les quitte. Entre une identification à la mère et une identification au père, Cécile se trouve devant cette impasse qui inscrit le féminin du côté phallique et ainsi met en échec la solution qu’elle avait élaborée.
Cécile est une cavalière confirmée. La pratique de l’équitation lui permettait, petite, de se séparer de sa mère et sa dépression. Ce qui l’intéresse dans l’équitation, c’est de gagner des médailles et de briller aux yeux du père : « Monter à cheval c’est avoir un sentiment de liberté et de puissance, j’étais loin des problèmes de couple de mes parents et de la dépression de ma mère. Malgré son emploi du temps très chargé, mon père se débrouillait toujours pour assister aux compétitions équestres importantes, il était très fier de moi quand je lui ramenais une médaille ».
Juste après l’annonce par le médecin de l’imminence du décès de sa mère qui souffrait d’une maladie incurable, Cécile a un accident d’équitation. Elle dira que la chute va la stopper net dans « sa chevauchée folle ». Que réalise-t-elle ainsi ?
À son incapacité de prise de parole devant les hommes, qu’elle appelle son « symptôme », elle associe la position silencieuse de sa mère face à « la virulence masculine » de son père.
Pour Cécile, cet accident d’équitation et la mort de sa mère l’ont « fichue par terre ». Elle termine en disant : « Il est toujours question de chute chez moi ». Je lève la séance en isolant le signifiant « chute » en jouant sur l’équivoque : « Chut ».
Dans les semaines qui suivent cette séance, Cécile oubliera de prendre le petit comprimé qui lui permettait de calmer son angoisse avant chaque prise de parole en public et finira par s’en passer.
[1] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », présentation du thème du Xe Congrès de l’AMP, Rio, 2016, http://wapol.org/fr/articulos/Template.asp?intTipoPagina=4&intPublicacion=13&intEdicion=9&intIdiomaPublicacion=5&intArticulo=2742&intIdiomaArticulo=5 Lire la suite