« Ces phrases ne visent pas à reconnaître la forme des corps :
si elles s’attardent sur eux, c’est pour ne pas voyager seules. »[1]
Quoi de mieux que la nuit pour faire couple ? Partout, les nuits du monde servent d’écrins aux corps parlants, ces errants qui tentent de suppléer au rapport sexuel qu’il n’y a pas en s’essayant à la comédie du faire couple. Parmi les mille et une variantes nocturnes du faire couple, voyons comment entre un homme et une femme, à l’occasion, une piste de danse peut être ce lieu où le faire. Au bord de chaque piste où le tango se danse, un trait d’esprit court de chacun en chacune : « le tango, c’est avant le divorce… ou après le divorce ». Façon de faire entendre le rapport mœbien qu’entretient cette danse avec le faire couple.
Quelques règles minimales, quelques façons de faire dessinent les possibles même si, en cas de rencontre, c’est toujours hors-piste qu’il faudra consentir à danser.
À l’heure des derniers métros, la milonga devient refuge des solitudes. Même si la marche du monde tend à brouiller les pistes, en ce lieu la partition est encore classique : d’un côté, les hommes ; de l’autre, les femmes. Pour qui sait danser, ce lieu ne sera jamais terre inconnue : au-delà de la langue, des codes soutiennent et civilisent ce mode particulier de la rencontre. Ils font notamment que l’on peut danser sans parler.
Avant l’étreinte, le regard. Comment danse-t-elle ? Après qui court-il ? À qui dit-elle non ? Et puis, ils se choisiront, sans échanger un mot. D’un regard, d’un hochement de tête, dans ce silence des corps que ne recouvre pas le bandonéon, un homme et une femme se lient. Ils se lient pour una tanda, quatre morceaux. La brièveté est écrite d’avance. De façon sure et garantie, la cortina séparera. Cette danse est une orthodoxie, les durées sont standard.
La danse en elle-même, si elle se veut « d’improvisation », n’en est pas moins très codifiée. Des structures, mises en forme par cette lente tentative de ponçage du réel qu’est la tradition, sont enseignées, apprises, répétées jusqu’à plus soif. Elles sont la tentative de langue commune à même de donner l’illusion d’un rapport entre les corps dansants. Hommes et femmes savent ainsi ce que chacun, de leur corps, ils ont à faire en cette occasion. Le génie de la danse, celui qui parvient à faire croire au Un, est celui qui fait de la danse un rite. Et alors, comme chez Borges, « le rite constitue le Secret »[2]. Commentant cette nouvelle, Jacques-Alain Miller propose de penser le rite comme « une action symbolisée qui comporte qu’on prête son corps au symbole »[3]. Prêter son corps au symbole, là est bien le ressort de ce rite qui consiste à se ranger, le temps d’un tour de piste, côté homme ou côté femme, et à en assumer la nature de semblant.
Seulement, au fond, chacun ne danse qu’avec son symptôme, symptôme qui trouvera à se loger, à s’incarner dans le partenaire de l’instant. Il y a celui qui s’accroche un peu trop, ou qui maintient les corps à distance raisonnable. Celle qui en fait des tonnes, ou qui ne fait que ce qu’elle imagine que l’autre lui demande. Il y a les passionnés et les tempérés, les sobres et les extravagants, les solitaires et les altruistes. Infinités de versions.
Et à l’aube, la cumparsita vient clore chaque nuit. Dans ce morceau, un homme déroule sa longue plainte. Pathos au zénith : depuis qu’elle est partie, tous sont partis… même le chien. Plutôt que de lire dans cette complainte un ratage structurel, ne faut-il pas entendre dans ces ultimes notes le rappel que faire couple n’est rien qu’être lié à un scénario, à un fantasme chiffrant dans lalangue propre à chacun les coordonnées d’une jouissance incommunicable ? Ainsi donc, chaque nuit, cette danse à deux se referme sur la solitude qui la fonde, et fait surgir la satisfaction autistique que chacun y rencontre.
Alors… ¿ Bailas ?
[1] Haenel Y., Introduction à la mort française, Paris, Gallimard, 2011, p. 11.
[2] Borges J.-L., « La secte du Phénix », Fictions, Paris, Gallimard, 1956, p. 175.
[3] Miller J.-A., « Le Coït énigmatisé : Une lecture de La secte du Phénix de Borges », Quarto, Paris, Agalma, n°70, avril 2000, p. 6.







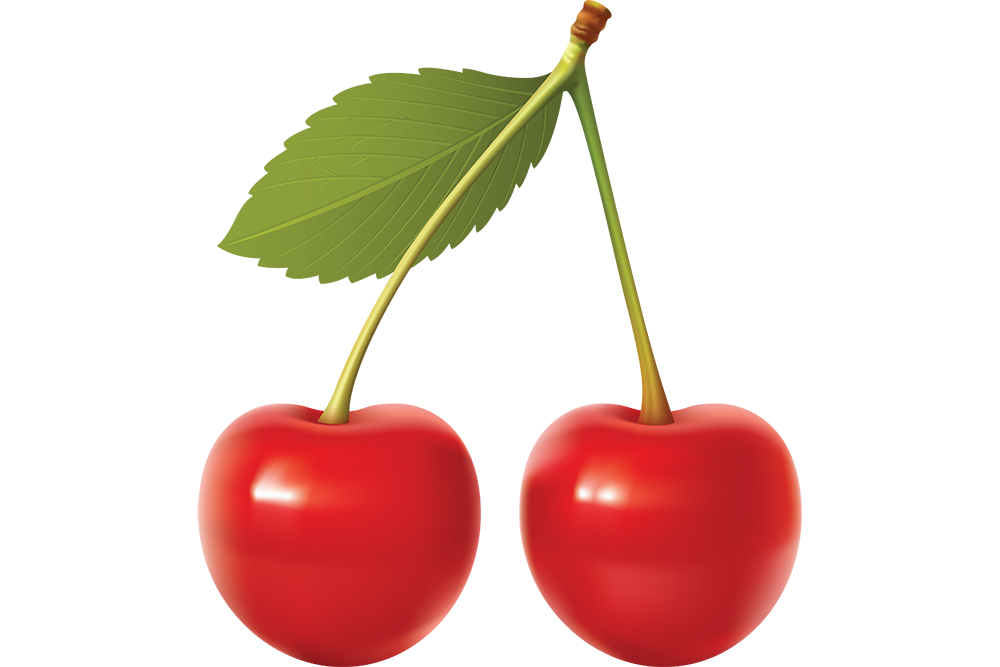



![Entretien avec François Ansermet à propos de son livre La fabrication des enfants, un vertige technologique[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/07/AnsermetHD.png)

