« Et voilà, tralala,
Zut à celui qui le lira ! »
Ferdydurke
W. Gombrowicz
Ferdydurke est le premier roman de Witold Gombrowicz, paru en 1937. Sa rédaction est toute issue d’un effort bouffon et ironique pour assumer la critique qui avait suivi la parution de son premier ouvrage, un recueil de contes intitulé Mémoires du temps de l’immaturité, qui justement l’épinglait par l’immaturité de son écriture. De ce signifiant vexatoire de l’Autre dans lequel il est pris à son corps défendant, il fait la marque de son style.
L’amour contrarié et contrariant de sa propre immaturité est le nœud du livre, à partir duquel va germer le reste de son œuvre. D’aucuns y voient un conte philosophique voltairien ; mais il faut alors imaginer un Voltaire difforme et bancal, dont l’écriture serait déformée et grignotée de l’intérieur par une outrance davantage rabelaisienne. C’est l’ordre du Nom-du-Père bousculé par le grotesque, la grimace, l’effronterie. Le véritable couple du livre, c’est celui qu’engendre la lutte entre la forme dans son état terminal – la maturité qui nomme autant qu’elle emmure – et l’informe qui la défait, au moyen de l’immaturité comme appareil de dégradation de la complétude.
Jojo, le narrateur de Ferdydurke, est comme hésitant au seuil du stade du miroir, rattrapé sans cesse par sa prématuration initiale. Il est poussé à rejeter la forme dans laquelle il est pris dans l’Autre et qui le désigne contre son gré précisément comme immature, le précipitant dans une zone de honte de lui-même qu’il est impératif de fuir. Un rêve entame le livre : « Par une inversion temporelle qui devrait être interdite par la nature, je m’étais vu tel que j’étais à quinze ou seize ans : transféré dans mon adolescence […]. Il me semblait que, tel que j’étais ce jour-là, à plus de trente ans, je moquais et singeais le blanc-bec mal léché que j’étais jadis, mais que celui-ci me singeait à son tour et avec autant de raison ; bref, que chacun de nous deux singeait l’autre »[1].
Jojo est ensuite pris au piège d’un professeur pédant qui cherche à l’infantiliser pour asseoir son propre sérieux en le ramenant sur les bancs de l’école et en le faisant passer pour un adolescent dont le caractère poseur et affecté expliquerait ses faux airs d’adulte. Pour ce faire, il lui impose de vivre dans une pension de famille à proximité de Mlle Lejeune, une moderne lycéenne, dont il compte bien que la juvénilité le contaminera radicalement. En la rencontrant, il est aussitôt capturé par la perfection de son image : « Seize ans, un sweater ; une jupe, des sandales en caoutchouc, sportive, libre d’allure, lisse, mince, souple et insolente ! À sa vue je sentis trembler mon cœur et mon visage. Je compris au premier coup d’œil que c’était un phénomène sérieux, plus sérieux peut-être que [le professeur pédant] mais non moins absolu dans son genre […]. Lycéenne parfaite dans sa lycéanité et plus que moderne dans sa modernité »[2].
Aussitôt amoureux, il désire plus que tout lui ressembler : « Avec quelle véhémence je voulais lui montrer, avec quelle avidité ! Oui, mais lui montrer quoi ? Un adulte arrivé à la trentaine ? Non, non jamais de la vie ! À cet instant je ne souhaitais plus du tout m’évader de la jeunesse et révéler mes trente ans, mon univers s’était écroulé et je n’en voyais pas d’autre que celui d’une moderne lycéenne, avec sports, courage, entrain, mollets, jambes, danses, déchaînement, canotage – nouveau pilier de ma réalité ! C’est en moderne que je voulais me montrer ! »[3]
Alors, l’amour ? Est-il pour Jojo une voie de réconciliation entre la forme et l’informe, la maturité et l’immaturité ? Jojo pourra-t-il consentir à adopter une forme grâce à la puissance imaginaire de l’amour ? Mais comment faire quand le burlesque ridiculise sans cesse tous les semblants, contaminés les uns après les autres ? Hélas, l’amour, dans Ferdydurke, est voué à alimenter l’embrouille, car « contre le cucul, il n’y a pas de refuge »[4].
[1] Gombrowicz W., « Ferdydurke », Moi et mon double, Paris, Gallimard, 1996, p. 271-272.
[2] Ibid., p. 355.
[3] Ibid., p. 365.
[4] Ibid., p. 504.






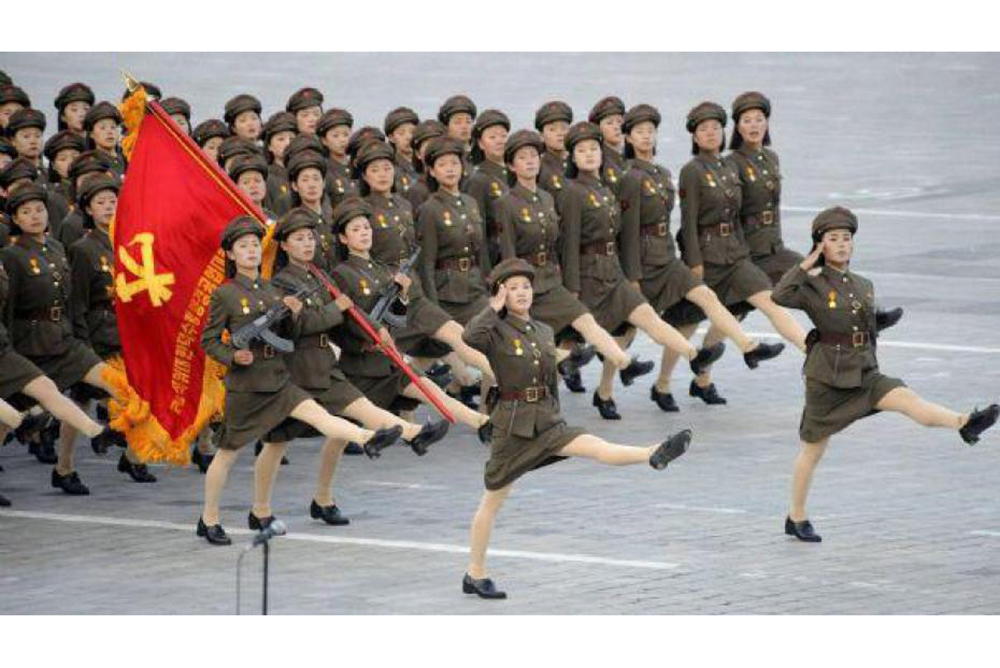
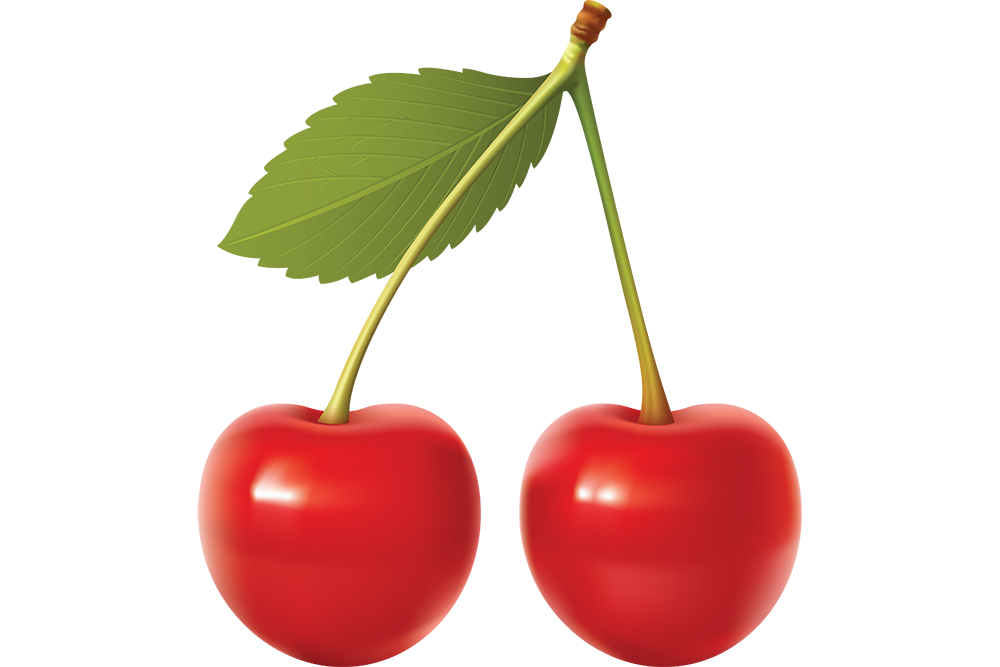




![Entretien avec François Ansermet à propos de son livre La fabrication des enfants, un vertige technologique[1]](https://www.hebdo-blog.fr/wp-content/uploads/2015/07/AnsermetHD.png)

