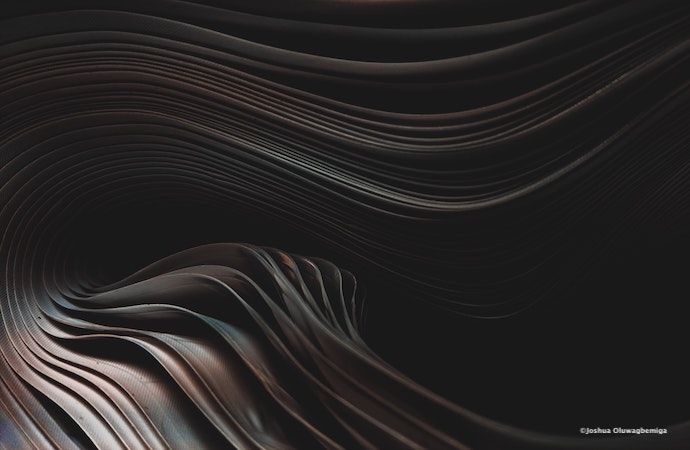Dans le premier chapitre du Séminaire XI, Lacan précisait ce qui fut depuis le début l’enjeu de son Séminaire : un enseignement visant à la formation des analystes [*]. Il remarquait donc que ce Séminaire était impliqué dans les fondements mêmes de la psychanalyse, puisqu’il contribuait à la fonder in concreto. Il relevait aussi que cette pratique était nécessairement dans la dépendance d’un désir inaugural, celui de Freud, à entendre non comme une subjectivité originelle, mais comme objet. C’était déjà poser que la transmission de la psychanalyse passe irréductiblement par le particulier. On sait que c’est dans la singularité de l’être du sujet que se situe pour nous le réel et non dans les universaux. C’est à cette singularité même que doit s’articuler ce qu’il y a de savoir dans le réel, c’est-à-dire les structures.
C’est dire que la formation de l’analyste est à conjuguer avec l’enseignement et non avec l’instruction. En effet, le postulat de départ d’une instruction est que l’autre ne sait pas, ce qui ne s’accorde pas avec l’hypothèse de l’inconscient où c’est l’autre qui sait, l’analysant, dépositaire d’un savoir insu qu’il s’agit de délivrer. Or, c’est justement à cette position de l’analysant qu’il faut rapporter celle de l’enseignant, qui part lui aussi de son point d’ignorance. La formation en l’occurrence, pour l’analyste, est donc avant tout la sienne propre.
Il reste que cette formation, toujours éminemment particulière, doit pouvoir être transmise. Loin de considérer qu’elle ne se transmet pas ou qu’elle est de l’ordre de l’ineffable, Lacan en a balisé le chemin par le mathème, présentant à chaque fois pour chacun ce qu’il ne sait pas, ce qui est de l’ordre du réel, et il a posé la condition de son parcours : le style. C’est ce qu’il évoque déjà partiellement dans la conclusion de « La psychanalyse et son enseignement » : « Tout retour à Freud […] digne de ce nom, ne se produira que par la voie, par où la vérité la plus cachée se manifeste dans les révolutions de la culture. Cette voie est la seule formation que nous puissions prétendre à transmettre à ceux qui nous suivent. Elle s’appelle : un style » [1].
Pour savoir ce qu’est un style, on peut bien sûr recourir à la bibliothèque de Babel, propice au tourisme littéraire. Lacan y ayant fait un tri, il a utilisé, dans son ouverture des Écrits consacrée à la question, le « Discours sur le style » de Buffon ; nous n’allons pas le recommencer. Sinon pour citer brièvement Aragon, qui dans le Séminaire XI occupe une certaine place [2]. Voici sa définition du style extraite de son livre rageur et polémique intitulé Traité du style : « Ainsi je donne un sens très élevé au mot style. Je lui remets sa belle robe. Je lui rends son regard très pur. J’appelle style l’accent que prend à l’occasion d’un homme donné le flot par lui répercuté de l’océan symbolique qui mine universellement la terre par métaphore. Et maintenant détache cette définition, valet d’écurie ! Qu’elle rue et qu’elle te casse les dents ! » [3]
Pour définir le style, Lacan considère la référence à « l’homme » comme approximative : « “Le style est l’homme même”, répète-t-on sans y voir de malice, ni s’inquiéter de ce que l’homme ne soit plus référence si certaine. » [4] Pour lui, le style ne sera pas plus l’homme donné d’Aragon, que l’homme même de Buffon : « C’est l’objet qui répond à la question sur le style, que nous posons d’entrée de jeu. À cette place que marquait l’homme pour Buffon, nous appelons la chute de cet objet, révélante de ce qu’elle l’isole, à la fois comme la cause du désir où le sujet s’éclipse, et comme soutenant le sujet entre vérité et savoir. Nous voulons du parcours dont ces écrits sont les jalons et du style que leur adresse commande, amener le lecteur à une conséquence où il lui faille mettre du sien. » [5]
On peut remarquer que ce texte construit, à propos du style, une tension entre deux pôles : l’objet qui y répond et l’adresse qui le commande. On constate aussi que le vidage de l’homme par l’objet s’effectue aux deux places, à celle de l’auteur, où le sujet est alors en question, et à celle de l’adresse. Lacan ne rallonge pas la formule buffonesque, « [l]e style est l’homme même » par « l’homme à qui l’on s’adresse », considérant que cette adresse est autre chose que le lieu de retour de notre discours. Elle est à rapporter du côté de l’objet, évidemment en place de semblant. Pour les Écrits, cette place est occupée par un lecteur qualifié de nouveau, envers lequel le rassemblement de ses articles en volume se justifie.
Que ce soit l’objet soutenant le sujet entre vérité et savoir qui réponde à la question sur le style, montre déjà que le style n’est pas un attribut, une forme ou une mode dont le sujet s’affuble, mais un mode selon lequel il se manifeste. Pour l’atteindre, il devra s’astreindre à quelque chose que Lacan habituellement n’hésite pas à qualifier d’un terme religieux : une ascèse. C’est donc qu’un style, cela doit se trouver, parfois après de nombreux tâtonnements, et cela se pratique. Mais en aucun cas cela ne se maîtrise, et n’est réductible à un truc ou à un tuyau. Banalité que les artistes savent sans doute. De leur style, ils ne pourront témoigner que par leurs productions, la tâche d’en éclairer les déterminants incombant plutôt au critique.
Un écrivain, Henry James, l’a non seulement compris, mais en a fait la matière d’une de ses nouvelles : L’Image dans le tapis. On y voit le narrateur, critique littéraire, délogé de sa torpeur satisfaite, que James, dans la préface qu’il écrivit à ce texte, qualifie de « flasque curiosité », par un romancier lui faisant remarquer qu’aucun critique n’est encore parvenu à mettre le doigt sur le fil de son œuvre. Réveillé, le critique essaie à l’aide des instruments habituels – une idée philosophique, la forme, le fond – d’en extorquer le fin mot à son interlocuteur. Celui-ci ne peut que lui répondre que sa trouvaille est incorporée dans « chacune de ses pages et de ses lignes, chacun de ses mots. Ce qu’il y a à trouver est aussi concret que l’oiseau dans la cage, que l’appât de l’hameçon, que le bout de fromage dans la souricière. C’est ce qui compose chaque ligne, choisit chaque mot, met un point sur tous les i, trace toutes les virgules » [6].
Cette mise en rapport du style et de l’objet a retenu Lacan très tôt. Déjà dans ce texte de 1933, paru dans la revue Minotaure et republié dans les Premiers écrits sur la paranoïa, « Le problème du style et la conception psychiatrique des formes paranoïaques de l’expérience », il l’articule en parlant de l’« identification itérative de l’objet » [7] dont témoigne la syntaxe des délires paranoïaques. En serait responsable le caractère immanent et imminent de signification personnelle qu’éprouvent ces sujets dans la perception des objets. Il remarque, judicieusement d’ailleurs, que c’est dans la perception bien plus que dans son interprétation que leur monde est transformé : « Ces intuitions sont manifestement parentes de processus très constants de la création poétique et paraissant l’une des conditions de la typification, créatrice du style. » [8] Il conclut en affirmant combien les problèmes de style ne seront jamais éclaircis qu’à la condition de se « libér[er] du réalisme naïf de l’objet » [9]. […]
Dans son enseignement, Lacan ne se contenta pas de témoigner de la singularité de son style, il en montra l’articulation obligée au mathème. S’agissant notamment du graphe du désir, il indiquait impérativement à son auditoire la nécessité, pour le comprendre, de passer par les effets de style du texte qui l’introduit. Cette articulation peut être éclairée en recourant à la distinction entre structure et construction. Si la première est à considérer comme un savoir déjà là dans le réel, la seconde est plutôt une conjecture variable édifiée comme support de l’interprétation. Sa validité sera donc étroitement dépendante des repères structuraux qu’elle utilisera. C’est dire que l’enseignement et en conséquence la transmission de la psychanalyse passent nécessairement par un nouage nouveau de la vérité et du savoir. Ne prendre que la voie de l’effet de vérité reviendra purement et simplement à redoubler le discours hystérique. Cette voie n’a rien de neuf, puisqu’elle ne fait que prolonger le choix forcé de l’aliénation. Nous savons que ce n’est pas là parier au pire comme Lacan le soutenait. Choisir à nouveau le Je ne pense pas n’équivaut qu’à préserver le Je suis illusoire : le moins-pire, où est déjà installé le sujet. Le pire est un chemin plus difficile, car on y paie la pensée du prix de l’existence. C’est néanmoins le seul qui nous mène, par le transfert, vers l’inconscient – le choix refoulé étant formulable comme un Je pense, je ne suis pas [10]. L’opération du discours analytique, en regard du discours de l’hystérique, le montre suffisamment :

On y constate en effet une perte d’être pour le sujet, le savoir venant occuper, au lieu de la vérité, la place qui était d’abord celle de l’objet.
On voit donc que s’il faut nécessairement à chacun un style pour soutenir le discours analytique, celui-ci ne s’appuiera pas sur l’exaltation complaisante de l’être et de la vérité. Mais plutôt sur un savoir à construire, portant sur l’émergence de la vérité du sujet. En revanche, la transmission ne passe pas non plus par l’assujettissement à un signifiant-maître. Ce n’est pas à l’appel de l’Autre que nous sommes conviés à répondre, mais plutôt à prendre en compte cet objet a, qui seul permet justement d’en alléger le poids.
[*] Extrait d’un texte initialement paru dans Quarto, n°22, décembre 1985, p. 53-55. Relu par l’auteur pour la présente édition.
[1] Lacan J., « La psychanalyse et son enseignement », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 458.
[2] Cf. Michaux G., « Place d’un poème d’Aragon dans le séminaire XI de J. Lacan », Analytica, n°43, 1986, p. 59-63.
[3] Aragon, Traité du style, Paris, Gallimard, 1928, p. 210.
[4] Lacan J., « Ouverture de ce recueil », Écrits, op. cit., p. 9.
[5] Ibid., p. 10.
[6] James H., L’Image dans le tapis, Paris, Pierre Horay 1984, p. 24.
[7] Lacan J., Premiers écrits sur la paranoïa, in De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, suivi de Premiers écrits sur la paranoïa, Paris, Seuil 1975, p. 387.
[8] Ibid.
[9] Ibid.
[10] Cf. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. 1, 2, 3, 4 », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 24 avril 1985, inédit.