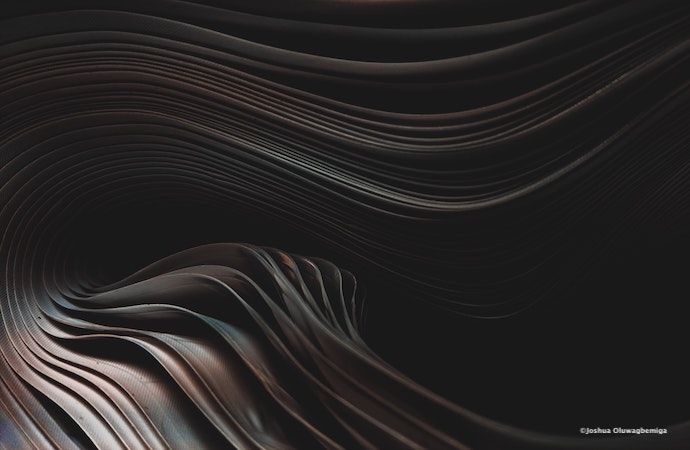« Quel que soit son raffinement, le style a toujours quelque chose de brut […] ; il fonctionne à la manière d’une Nécessité, […] terme d’une métamorphose aveugle et obstinée, partie d’un infra-langage qui s’élabore à la limite de la chair et du monde. »
Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture
Spécifiant l’écriture, les modes d’expression et la manière d’un sujet, le style est synonyme de singularité, et de symptôme aussi bien. Car notre insertion dans le langage et dans la communauté humaine se trame à partir d’un exil qui nous hante, d’un désert qui nous aimante. De là, nous nous démenons, travaillons, aimons, jouissons…
Roland Barthes fait admirablement résonner cette zone secrète où s’encre le style : « des images, un débit, un lexique naissent du corps et du passé de l’écrivain » [1]. Sa puissance allusive ne tient pas à la mobilité, à l’écoulement fluide du langage, mais bien plutôt à « un phénomène de densité, car ce qui se tient droit et profond sous le style, rassemblé durement ou tendrement dans ses figures, ce sont les fragments d’une réalité absolument étrangère au langage ». En ce sens, s’il enlumine l’incomparable, le style nous sépare du monde : « Indifférent et transparent à la société », ce « langage autarcique […] est la “chose” de l’écrivain, sa splendeur et sa prison, il est sa solitude » [2].
Tout le monde n’a pas l’heur d’être écrivain. Mais l’existence de tout un chacun prend corps d’un vagissement inaudible, d’un balbutiement inarticulable, de ce noyau extime du langage que Jacques Lacan nomme lalangue. C’est peu dire qu’elle nous affecte ; cette langue privée est le tressaillement qui bouleverse incessamment notre chair. Meurtrissure incurable, elle est à la fois notre prison, le poinçon de notre subjectivité et le lieu d’où nous nous arrachons pour nous adresser à l’autre. À la limite de la chair et du monde, appareillant la jouissance singulière de lalangue, le style est la façon dont une vie s’arrange avec ces marques immémoriales.
Faire une analyse, c’est précisément dégager la langue symptomatique dont s’ourdit l’inconscient. Le sujet découvre le réel intraitable qui le plombe. Jacques-Alain Miller le signale dès 1974 dans son texte sur la Théorie de lalangue [3]. Déblayant les lieux communs, les préfabriqués de notre histoire et de notre préhistoire, rasant le sens et les indécences dont on s’abritait, délogeant les signifiants-maîtres qui ont servi à boucher le trou de l’indicible, une cure dénude notre rapport intime à lalangue. « Ce n’est qu’à partir du moment où quelque chose s’en décape qu’on peut trouver un principe d’identité de soi à soi » [4], indique Lacan.
Par la grâce de ce décapage analytique, le style – qui est par nature réfractaire au changement – a donc chance de s’affiner au cours d’une analyse. Du bord de l’impossible à dire, des incandescences jaillissent. Blessure insupportable ou caresse exquise, les mots nous touchent. Le style est fait de ces alluvions, inventions, concrétions… À condition qu’elles restent vives. Car « lalangue est une langue morte, même si elle est encore en usage » [5] – cet oxymore si parlant souligne sa force indestructible et sa pétrification. Mettant à jour ses ressorts tant féconds que mortifiés, le ciselage de lalangue dans le travail analytique donne vie à des équivoques épatantes. À suivre la veine de la singularité s’ouvrent des partitions inouïes. Allégée de son pathos, la terre de désolation pourra même se reconvertir en formidable terrain de jeu.
Nulle pastorale à l’horizon cependant. La jouissance ne se dissoudra pas. Ennemie jurée du style, l’inertie est aux aguets, toujours prête à engloutir ce qui a été si laborieusement défriché. Les formules aiguisées s’émoussent en moins de temps qu’il ne faut pour les ânonner.
Une analyse permet de symptomatiser notre rapport singulier à lalangue. La trouvaille garde l’empreinte d’une déchirure inoubliable et son éclat demeure inséparable des « coups de ciseau »[6] qui ont extirpé le fragment de la langue perdue. Ce « qu’on sait faire avec lalangue dépasse de beaucoup ce dont on peut rendre compte au titre du langage » [7]. Ce savoir-faire à la limite de la chair et du monde est la marge de l’inconscient. C’est aussi celle du style.
[1] Barthes R., Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Seuil, 1972, p. 16-17.
[2] Ibid.
[3] Miller J.-A, Théorie de lalangue, Paris, Navarin, 2021, p. 88.
[4] Lacan J., La Troisième, Paris, Navarin, 2021, p. 46.
[5] Ibid.
[6] Milner J.-C., La Puissance du détail, Paris, Grasset & Fasquette, 2014, p. 10.
[7] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 127.