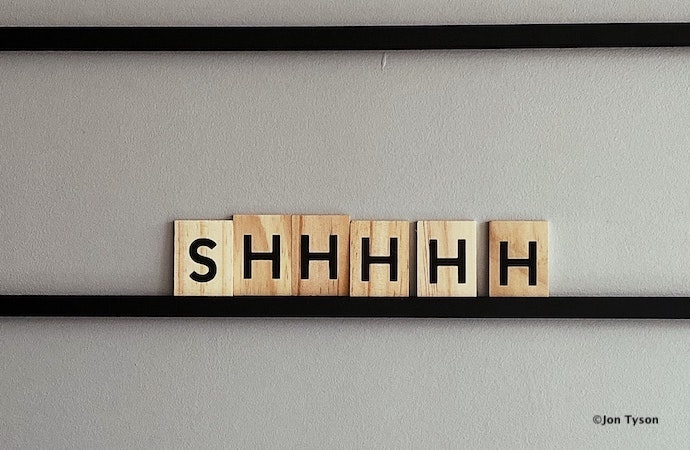Interrogeons-nous d’abord sur le silence. Prenons le tableau de Munch intitulé Le Cri, et le commentaire qu’en fait Lacan. Ce cri ne s’entend pas et indique pourtant le lieu d’où le silence se produit : cri d’effroi devant la Chose innommable.
Très tôt, dans L’Esquisse, Freud pose le cri en regard de la Chose muette, il est alors la façon dont l’étranger, l’hostile apparaît dans la première expérience de la réalité. Le cri – qui n’est pas le mot – est transformé en appel par l’Autre qui lui donne cette valeur et devient le lieu, à l’intérieur de nous-même, dont nous ne pouvons approcher sans effroi. C’est en ce point que Freud a établi la notion de défense, vis-à-vis de « ce qui m’est le plus intime [et qui] est justement ce que je suis contraint de ne pouvoir reconnaître qu’au dehors » [1]. Ce lieu sera le recel de jouissance qui sans cesse poussera l’être parlant au sacrifice à des dieux obscurs.
Le silence est le vide où résonne le cri, ce dernier introduit un silence qui ne lui préexiste pas, il incarne « une jouissance […] qui échappe aux lois de la parole » [2]. C’est un « silence qui hurle, un silence absolu ne connaissant pas […] l’alternance présence-absence » [3]. C’est en ce point que Freud érige la défense, barrière au-delà du refoulement.
Cette part rejetée, c’est le réel dont Lacan s’oriente durant tout son enseignement, et avec lequel il va ferrer [4].
Si Lacan, en s’appuyant sur le graphe, situe la pulsion à un autre étage, sur le modèle de la chaîne signifiante articulée en termes dits organiques – oral, anal, etc. –, il ne contrevient pas au propos de Freud. La pulsion est conçue alors comme « représentant » du réel et le sujet, perçu comme « d’autant plus loin du parler que plus il parle » [5]. Dans cette formulation paradoxale nous pouvons lire que là où ça ne parle pas, au lieu du silence de la pulsion, se fait entendre le bruit de l’objet et ses avatars dans la langue.
Lacan n’aura de cesse de traquer le réel, sa question étant de saisir comment le toucher, en mobilisant la parole,
Dans le Séminaire Le Sinthome, Lacan énonce : « les pulsions, c’est l’écho dans le corps du fait qu’il y a un dire » [6], cette formule concentre le fait que le corps de l’être parlant est jouissance et indique que le signifiant peut produire un vide de signification. Le corps, alors pris comme corps parlant, « parle en termes de pulsions » et l’interprétation est un « dire qui vise le corps parlant pour y produire un évènement, pour passer dans les tripes » [7].
L’analyste se présente alors comme l’obstacle auquel se heurte le dire et d’où se produit l’écho [8].
Il a chance, en ce point, de déranger la pulsion, celle dont le silence indique un au-delà du refoulement qui fonctionne comme défense. C’est la résonnance qui, cassant l’articulation S1 – S2, permet de toucher à l’ombilic du symptôme, là où se sont noués le corps et un signifiant hors sens.
Freud situait le corps en relation avec le ça, lieu du silence. Et Lacan d’ajouter : « Mais à l’articuler ainsi, il ne fait que signifier que ce qui est supposé être “ça” : c’est l’inconscient quand il se tait. Ce silence, c’est un taire. Et ce n’est pas là rien, c’est certainement un effort, un effort dans le sens, dans un sens peut-être un peu régressif par rapport à sa première découverte, dans le sens disons de marquer la place de l’inconscient. Ça ne dit pas pour autant ce qu’il est, cet inconscient, en d’autres termes, à quoi il sert. Là, il se tait : il est la place du silence. » [9]
C’est l’inconscient réel, et c’est ce silence qu’il s’agit de déranger pour faire résonner l’écho d’un dire singulier, ce afin de toucher à la satisfaction, silet [10].
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2006, p. 225.
[2] Vinciguerra R.-P., « L’objet voix », La Cause freudienne, n°71, juin 2009, p. 135, disponible sur CAIRN.
[3] Ibid.
[4] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XXIV, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », leçon du 11 janvier 1977, Ornicar ?, n°14, Pâques 1978, p. 4-9.
[5] Lacan J., « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 816.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 17.
[7] Miller J.-A., « L’inconscient et le corps parlant », La Cause du désir, n°88, octobre 2014, p. 114, disponible sur CAIRN.
[8] Cf. Bonnaud H., « Myriam Chérel interviewe Hélène Bonnaud », entretien avec M. Chérel, Ironik, n°31, 2 juillet 2018, publication en ligne.
[9] Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 11 juin 1974, inédit.
[10] Cf. Miller J.-A., « À partir du silence », Horizon, n°65, octobre 2020, p. 19-30.