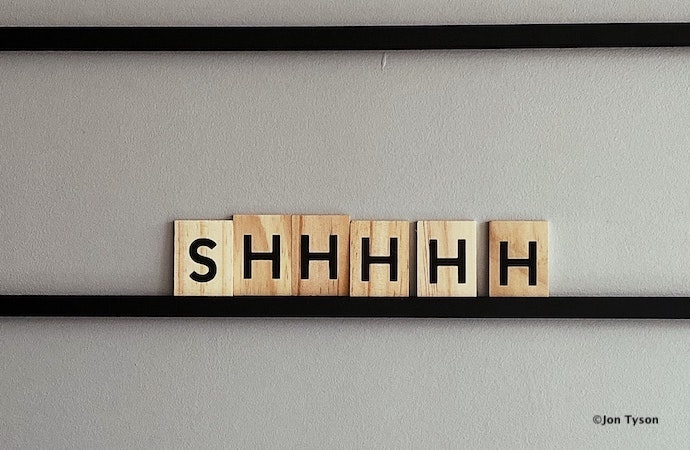— Vous ne dites rien ?
— Ah si, je dis quelque chose. Je dis que l’âge de l’interprétation est derrière nous [*]. […]
Nous disons « l’interprétation », nous n’avons que ce mot à la bouche, il nous assure que, en nous, se poursuit « l’histoire » de la psychanalyse. Mais nous disons « l’interprétation » comme nous disons « l’inconscient », sans plus penser à la conscience, et à la nier. « L’inconscient », « l’interprétation », ce sont les mots de la tribu, à couvert desquels s’insinue le sens nouveau qui s’avance masqué. […]
Pourquoi l’interprétation n’est-elle pas comptée par Lacan au rang des concepts fondamentaux de la psychanalyse ? – sinon parce qu’elle est incluse dans le concept même de l’inconscient. L’équivalence de l’inconscient et de l’interprétation, n’est-ce pas ce qui surgit à la fin du Séminaire du Désir et son interprétation ? – dans ce paradoxe – le désir inconscient est son interprétation. L’équivalence inconscient–interprétation, n’est-ce pas ce qui se redit sous la forme du concept du sujet supposé savoir ? Cela sera-t-il acquis enfin, que je le redise une fois de plus aujourd’hui ?
C’est un leurre, et c’est même une impasse, que d’unilatéraliser l’interprétation du côté de l’analyste, comme son intervention, son action, son acte, son dit, son dire. Sans doute s’est-on trop fasciné sur le speech act de l’analyste pour s’apercevoir de l’équivalence que je disais, de l’inconscient et de l’interprétation – le temps-pour-comprendre s’est ici indûment prolongé.
Les théories de l’interprétation analytiques ne témoignent que du narcissisme des analystes. Il est temps de conclure. L’interprétation est primordialement celle de l’inconscient, au sens subjectif du génitif – c’est l’inconscient qui interprète. L’interprétation analytique vient en second, elle se fonde sur l’interprétation de l’inconscient, d’où l’erreur de croire que c’est l’inconscient de l’analyste qui interprète. […]
Faire résonner, faire allusion, sous-entendre, faire silence, faire l’oracle, citer, faire énigme, mi-dire, révéler – mais qui fait ça ? Qui fait ça mieux que vous ? Qui manie cette rhétorique comme de naissance, alors que vous vous échinez à en apprendre les rudiments ? Qui ? – sinon l’inconscient même.
Toute la théorie de l’interprétation n’a jamais eu qu’un but – vous apprendre à parler comme l’inconscient. […]
L’inconscient interprète. Et l’analyste, s’il interprète, interprète à sa suite. Quelle autre voie lui est ouverte au terme ? – sinon celle de s’identifier à l’inconscient même. C’est le principe d’un narcissisme nouveau, qui n’est plus celui du moi fort. « Vous ne dites rien ? » Sans doute. Se taire est ici un moindre mal. Car interpréter, l’inconscient n’a jamais fait que ça, et il le fait mieux, en règle générale, que l’analyste. Si l’analyste se tait, c’est que l’inconscient interprète.
Pourtant, l’inconscient aussi bien veut être interprété. Il s’offre à l’être. Si l’inconscient ne voulait pas être interprété, si le désir inconscient du rêve n’était pas, dans sa phase la plus profonde, désir d’être interprété – Lacan le dit –, désir de prendre sens, il n’y aurait pas l’analyste.
Entrons dans le paradoxe. L’inconscient interprète, et il veut être interprété. Il n’y a là contradiction que pour un concept sommaire de l’interprétation. L’interprétation, en effet, appelle toujours l’interprétation.
Disons-le autrement : interpréter, c’est déchiffrer. Mais déchiffrer, c’est chiffrer à nouveau. Le mouvement ne s’arrête que sur une satisfaction.
Freud ne dit pas autre chose quand il inscrit le rêve comme discours au registre du processus primaire, comme une réalisation de désir. Et Lacan le déchiffre pour nous en disant que la jouissance est dans le chiffrage.
Mais encore – comment la jouissance est-elle dans le chiffrage ? De quel être est-elle dans le chiffrage ? Et quel lieu habite-t-elle dans le chiffrage ? […]
Freud commença par le rêve, qui de toujours s’était prêté à l’interprétation. Il poursuivit par le symptôme, conçu sur le modèle du rêve, comme message à déchiffrer. Déjà sur son chemin il avait rencontré la réaction thérapeutique négative, le masochisme et le fantasme.
Ce que Lacan continue d’appeler « l’interprétation » n’est plus celle-là, ne serait-ce que parce qu’elle ne s’ordonne pas au symptôme, mais bien au fantasme. Et ne répétons-nous pas que le fantasme ne s’interprète pas, qu’il se construit ?
Le fantasme est une phrase qui se jouit, message chiffré qui recèle la jouissance. Le symptôme même est à penser à partir du fantasme, ce que Lacan appelle le « sinthome ».
Une pratique qui vise dans le sujet le sinthome n’interprète pas à l’instar de l’inconscient. Interpréter à l’instar de l’inconscient, c’est rester au service du principe de plaisir. Se mettre au service du principe de réalité n’y change rien, car le principe de réalité est lui-même au service du principe de plaisir.
Interpréter au service du principe de plaisir – ne cherchez pas ailleurs le principe de l’analyse interminable. Ce n’est pas là ce que Lacan appelle « la voie d’un vrai réveil pour le sujet ».
Reste à dire ce que pourrait être interpréter au-delà du principe de plaisir – interpréter en sens contraire de l’inconscient. Là, le mot d’interprétation ne vaut que comme le tenant-lieu d’un autre, qui ne peut être le silence.
De même qu’il nous faut, pour référence, abandonner le symptôme pour le fantasme, penser le symptôme à partir du fantasme – de même nous faut-il ici abandonner la névrose pour la psychose, penser la névrose à partir de la psychose.
Le signifiant comme tel, c’est-à-dire comme le chiffre, comme séparé des effets de signification, appelle en tant que telle l’interprétation. Le signifiant tout seul est toujours une énigme, et c’est pourquoi il est en manque d’interprétation. Cette interprétation nécessite l’implication d’un autre signifiant, d’où émerge un sens nouveau. […]
C’est la voie de toute interprétation : l’interprétation a structure de délire, et c’est pourquoi Freud n’hésite pas à mettre sur le même plan, sans stratifier, le délire de Schreber et la théorie de la libido.
Si l’interprétation que l’analyste a à offrir au patient est de l’ordre du délire, alors en effet, sans doute vaut-il mieux se taire. Maxime de prudence.
Il y a une autre voie, qui n’est ni celle du délire, ni celle du silence de la prudence. Cette voie, on continuera si l’on veut de l’appeler « interprétation », bien qu’elle n’ait plus rien à voir avec le système de l’interprétation, sinon à en être son envers. […]
L’autre voie consiste à retenir S2, à ne pas l’ajouter aux fins de cerner S1. C’est reconduire le sujet aux signifiants proprement élémentaires sur lesquels il a, dans sa névrose, déliré.
Le signifiant unaire, comme tel insensé, veut dire que le phénomène élémentaire est primordial. L’envers de l’interprétation consiste à cerner le signifiant comme phénomène élémentaire du sujet, et comme d’avant qu’il ne soit articulé dans la formation de l’inconscient qui lui donne sens de délire.
Quand l’interprétation se fait l’émule de l’inconscient, quand elle mobilise les plus subtiles ressources de la rhétorique, quand elle se moule sur la structure des formations de l’inconscient – ce délire, elle le nourrit, là où il s’agit de l’affamer.
S’il y a ici déchiffrage, c’est un déchiffrage qui ne donne pas sens.
La psychose, ici comme ailleurs, met la structure à nu. Comme l’automatisme mental met en évidence la xénopathie foncière de la parole, le phénomène élémentaire est là pour manifester l’état originaire de la relation du sujet à lalangue. Il sait que le dit le concerne, qu’il y a de la signification, il ne sait pas laquelle.
C’est pourquoi, ici précisément, s’avançant dans cette autre dimension de l’interprétation, Lacan fait appel à Finnegans Wake, soit à un texte qui, jouant incessamment des rapports de la parole et de l’écriture, du son et du sens, tissé de condensations, d’équivoques, d’homophonies, n’a néanmoins rien à voir avec le vieil inconscient. C’est que tout point de capiton y est rendu caduc. C’est pourquoi il ne prête pas à interprétation, ni à traduction – en dépit d’efforts héroïques. C’est qu’il n’est pas lui-même une interprétation, et reconduit merveilleusement le sujet de la lecture à la perplexité comme phénomène élémentaire du sujet dans lalangue.
Disons que S1 y absorbe toujours S2. Les mots qui en traduiraient le sens dans une langue autre sont comme par avance dévorés par ce texte même, comme s’il s’auto-traduisait, et, de ce fait, la relation du signifiant et du signifié ne prend pas forme d’inconscient. Vous ne saurez jamais séparer ce que Joyce voulait dire de ce qu’il a dit – transmission intégrale, mais de mode inverse du mathème.
L’effet zéro du phénomène élémentaire est ici obtenu à travers un effet aleph, qui ouvre sur l’infini sémantique, ou mieux, sur la fuite du sens.
Ce que nous appelons encore « interprétation », bien que la pratique analytique soit toujours davantage post-interprétative, révèle, sans doute, mais quoi ? – sinon une opacité irréductible dans la relation du sujet à lalangue. Et c’est pourquoi l’interprétation – cette post-interprétation – n’est plus, à parler exactement, ponctuation.
La ponctuation appartient au système de la signification ; elle est toujours sémantique, elle effectue toujours un point de capiton. C’est pourquoi la pratique post-interprétative qui, de fait, prend tous les jours le relais de l’interprétation, se repère non sur la ponctuation, mais sur la coupure.
Cette coupure, imageons-la pour l’heure d’une séparation entre S1 et S2, celle-là même qui s’inscrit sur la ligne inférieure du mathème « discours analytique » : S2 // S1. […]
La question n’est pas de savoir si la séance est longue ou brève, silencieuse ou parleuse. Ou bien la séance est une unité sémantique, celle où S2 vient faire ponctuation à l’élaboration – délire au service du Nom-du-Père – bien des séances sont ainsi. Ou bien la séance analytique est une unité a-sémantique reconduisant le sujet à l’opacité de sa jouissance. Cela suppose qu’avant d’être bouclée, elle soit coupée.
J’oppose donc ici, à la voie de l’élaboration, la voie de la perplexité. L’élaboration, ne vous en faites pas, il y en aura toujours de surcroît.
Je propose donc à la réflexion de ces Journées que l’interprétation proprement analytique – conservons le mot – fonctionne à l’envers de l’inconscient. […]
[*] Extraits d’une intervention initialement parue dans La Cause freudienne, n°32, février 1996, p. 9-13, texte établi par Catherine Bonningue, relu par l’auteur. Republié ici avec l’aimable autorisation de Jacques-Alain Miller. Version revue pour la présente publication.