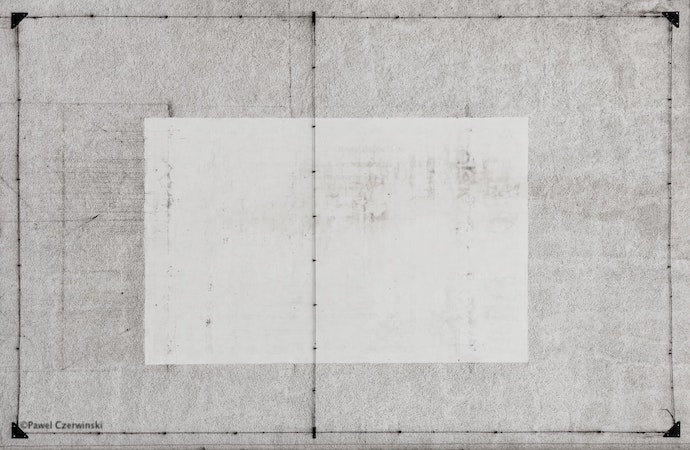« Il y a une face du savoir sur la vérité qui prend sa force d’en négliger totalement le contenu »
Lacan J., Le Séminaire, livre XIX, …ou pire.
« Le savoir sur la vérité est utile à l’analyste pour autant qu’il lui permet d’élargir un peu son rapport à ces effets de sujet dont j’ai dit qu’il les cautionne en laissant le champ libre au discours de l’analysant » [1], dit Lacan dans la douzième leçon de son Séminaire …ou pire.
C’est en lisant ce passage du Séminaire, résonnant avec des questionnements survenus de ma pratique en tant qu’analyste, que je me suis retrouvée à revisiter la « frontière sensible entre vérité et savoir [2], frontière que Lacan situe comme le fondement même du discours psychanalytique.
Dans cette leçon, il met en garde ceux qui ont pris le large par rapport au « travail de reprise logique » [3] qu’il entreprend depuis son « Discours de Rome », pour évoquer les embrouilles de la position de l’analyste face au bavardage du discours de l’analysant, ne voulant plus rien savoir de ce qu’il a élaboré autour du sujet supposé savoir et de la question du semblant.
Lacan précise que l’analyste « occupe légitimement la position du semblant », et cela « parce qu’il n’y a pas d’autre position tenable par rapport à la jouissance telle qu’il a à la saisir dans les propos de celui que, au titre d’analysant, il cautionne dans son énonciation de sujet » [4]. Selon lui, cela ne fait rien d’autre que « démontrer que la terreur ressentie du désir dont s’organise la névrose, ce qu’on appelle défense, n’est, au regard de ce qui s’y produit de travail en pure perte, que conjuration à faire pitié » [5].
Que le savoir, dont procède cette voix, soit du semblant – ce savoir « n’est pas l’ésotérique de la jouissance, ni seulement le savoir-faire de la grimace » –, cela tient à se résoudre à parler de la vérité comme position fondamentale, dit-il, « même si de cette vérité on ne sait pas tout » [6], car elle ne peut que se mi-dire. Ce savoir s’assure de la vérité du fait même de poser la vérité à partir du signifiant, dit-il. Cela tient à la faille, à la béance même, où se loge la spécificité de la psychanalyse.
Dans une autre leçon de ce Séminaire, Lacan affirme : « Le savoir sur la vérité s’articule de la pointe de ce que j’avance cette année sur le Yad’lun. Yad’lun et rien de plus, mais c’est un Un très particulier, celui qui sépare l’Un de deux, et c’est un abîme. Je le répète, la vérité ne peut que se mi-dire » [7].
Cette phrase est un concentré de psychanalyse. D’abord, c’est par son rapport au savoir que nous pouvons situer, entre autres, le caractère inédit du discours psychanalytique. Sa nouveauté consiste à en subvertir le savoir, en le situant du côté de l’ignorance : avec l’inconscient, il s’agit d’un savoir insu à lui-même. Ce savoir se trouve lié à la jouissance.
Dans cette citation, nous pouvons situer le condensé des conséquences extraites des élaborations de ce Séminaire, où Lacan pousse la découverte freudienne dans ses retranchements, faisant valoir ce qui y relève du réel, et non du sens : « la question n’est pas la découverte de l’inconscient, qui dans le symbolique a sa matière préformée, mais de la création du dispositif dont le réel touche au réel, soit ce que j’ai articulé comme le discours analytique » [8].
Ce qui relève de la faille, de la béance, corollaire de l’inconscient, est ici conséquence de ce que Lacan aborde par la logique : le « réel mathématique », dont il dit que « l’intrusion » est la seule voie d’accès à la « notion de l’existence » [9], à l’opposé de l’être. Il nous oriente ainsi dans ce qu’il a entrepris comme travail logique afin de saisir le vif de l’apport qu’a la psychanalyse dans le monde : la prise en compte de la « différence pure » [10].
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2011, p. 174-175.
[2] Lacan J., Je parle aux murs, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2011, p. 17.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, op. cit., p. 172.
[4] Ibid.
[5] Ibid., p. 172-173.
[6] Ibid., p. 173.
[7] Ibid., p. 195.
[8] Ibid., p. 240.
[9] Ibid., p. 181.
[10] Ibid., p. 191.