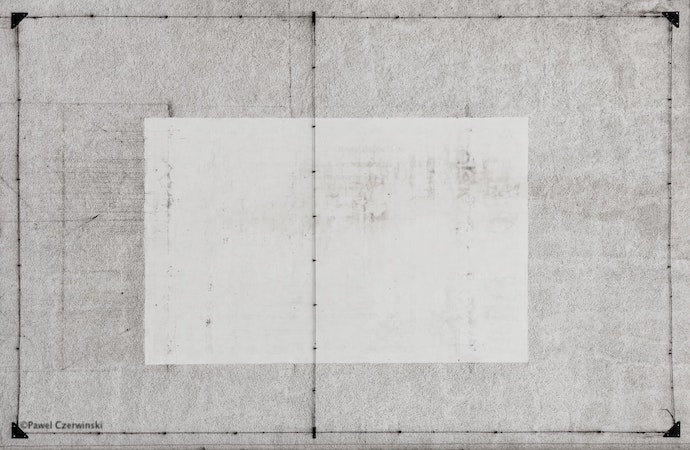Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, est un Séminaire incontournable en ces temps « déboussolés ». Un grand désordre règne entre les sexes et la psychanalyse, en interrogeant les identifications, en mettant à jour des désirs inédits, refoulés, a profondément contribué à cette grande remise en question des traditions. Ce Séminaire permet de trouver une boussole précieuse pour s’orienter dans ce désordre : les symptômes de notre civilisation sont des symptômes du non-rapport sexuel. Et puisque l’Autre (les traditions, le Père) ne prescrit plus comment s’y prendre avec l’Autre sexe, de multiples combinaisons deviennent possibles. Mais ce qui ne change pas, c’est qu’il revient toujours à chacun d’inventer un lien original qui permette de faire tenir ce rapport. Or, sur ce point, Lacan indique que nous sommes tous sur le même bateau – celui du non-rapport – et qu’il n’y a pas d’autre choix que d’inventer, car le mode d’emploi n’existe pas : « l’absence de rapport sexuel n’empêche manifestement pas, bien loin de là, la liaison, mais lui donne ses conditions » [1]. Il y a, pour chacun, des conditions inconscientes d’amour, de désir et de jouissance ; conditions qu’une analyse permet de découvrir. Dans ce Séminaire, Lacan entreprend d’éclairer ce qui fait tenir ce rapport qui n’existe pas : « ça ne tient jamais à deux tout seuls. C’est la racine de ce qu’il en est de l’objet a » [2]. Le lien est un lien de jouissance – et la jouissance a toujours quelque chose de dérangé, d’excessif, d’en trop. C’est pourquoi, Lacan n’encourage pas les analystes à jouer le rôle de providence des ménages[3]. L’harmonie est impossible, car on ne fait pas la paix avec la jouissance. La jouissance ne nous laisse tranquilles que lorsque l’on dort [4] : « Dormir, c’est ne pas être dérangé. » [5]
Le langage supplée au non-rapport
Ainsi, « l’être parlant […], c’est ce rapport dérangé à son propre corps qui s’appelle jouissance » [6]. C’est pourquoi, comme l’indique l’un des titres donnés par Jacques-Alain Miller : les corps sont toujours des corps attrapés par des discours [7], dérangés par des discours.
Puisque, entre les être parlants, ça ne s’accorde pas, à quoi tient l’illusion du rapport sexuel ? Ce qui supplée à ce non-rapport, indique Lacan, c’est le langage : « le langage fonctionne d’origine en suppléance de la jouissance sexuelle » [8]. Que trouve-t-on alors, à la place du non-rapport ? Toutes sortes de choses : « la lettre d’amur – refuser ce que je t’offre parce que ça n’est pas ça » [9].
Et de quoi se parle-t-on ? Quel est le point par où l’homme a accès à la femme ? Pour qu’une liaison se crée, pas d’autre choix que d’emprunter les sentiers de la castration, car c’est à partir de son propre manque que l’on aime et que l’on s’adresse à l’autre. C’est pourquoi Lacan peut dire que « c’est en parlant qu’on fait l’amour » [10].
Une autre question centrale est posée : en quoi les deux partenaires diffèrent-ils ? Quelle est la « petite différence » ? Puisque l’homme et la femme ne se distinguent pas comme le Yin et le Yang [11], qu’est-ce qui les différencie ? Y a-t-il une jouissance proprement féminine [12] ?
Il n’y a pas d’essence de l’homme, ni de la femme
Lacan enseigne que l’on ne trouvera jamais, dans la nature, l’essence dite mâle ou celle dite femelle : « Il est bien clair qu’il n’y a aucun moyen de répartir deux séries quelconques […] d’attributs qui fassent une série mâle d’un côté, et de l’autre côté la série femme. » [13] À la place ne viennent que des inepties : homme actif, femme passive…
Il y a une impasse à croire que l’on pourrait donner une définition de ce que c’est que l’homme et la femme : « Le langage est tel que pour tout sujet parlant, ou bien c’est lui ou bien c’est elle. Ça existe dans toutes les langues du monde. C’est le principe du fonctionnement du genre, féminin ou masculin. […] Cela dit, l’homme et la femme, nous ne savons pas ce que c’est » [14]. Lacan précise qu’il ne suffit pas de marquer le signifiant-homme comme étant distinct du signifiant-femme et d’appeler l’un x et l’autre y, car, justement, la question est de savoir : « comment on se distingue » [15]. La « norme mâle » [16] n’est situable nulle part. Et « il est éclatant que l’homme comme la femme font semblant, chacun dans son rôle » [17].
Nul n’est tranquille en ce qui concerne son être. Et ce sont des réponses à la question de notre être que nous venons chercher en analyse [18]. Lacan nous apporte « quelques petites lumières dans un champ parfaitement obscur » [19].
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2011, p. 19.
[2] Ibid., p. 92.
[3] Cf. ibid., p. 18.
[4] Cf. ibid., p. 217.
[5] Ibid.
[6] Ibid., p. 43.
[7] Cf. ibid., p. 221.
[8] Ibid., p. 44.
[9] Ibid., p. 82.
[10] Ibid., p. 154.
[11] Cf. ibid., p. 100.
[12] Cf. ibid., p. 104.
[13] Ibid., p. 187.
[14] Ibid., p. 40.
[15] Ibid., p. 32.
[16] Ibid., p. 98.
[17] Ibid., p. 70.
[18] Cf. ibid., p. 105.
[19] Ibid., p. 33.