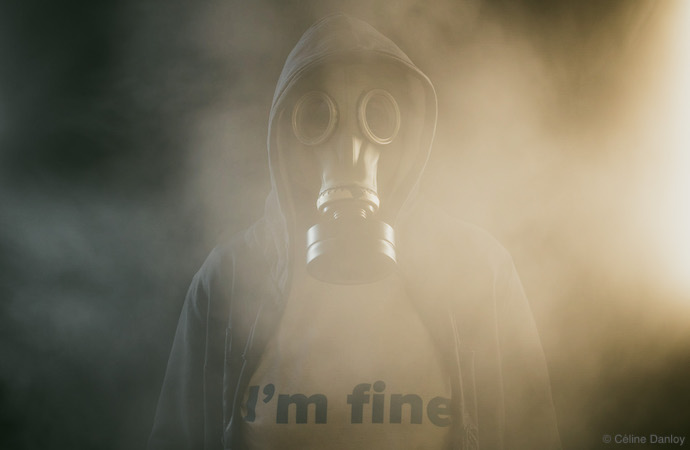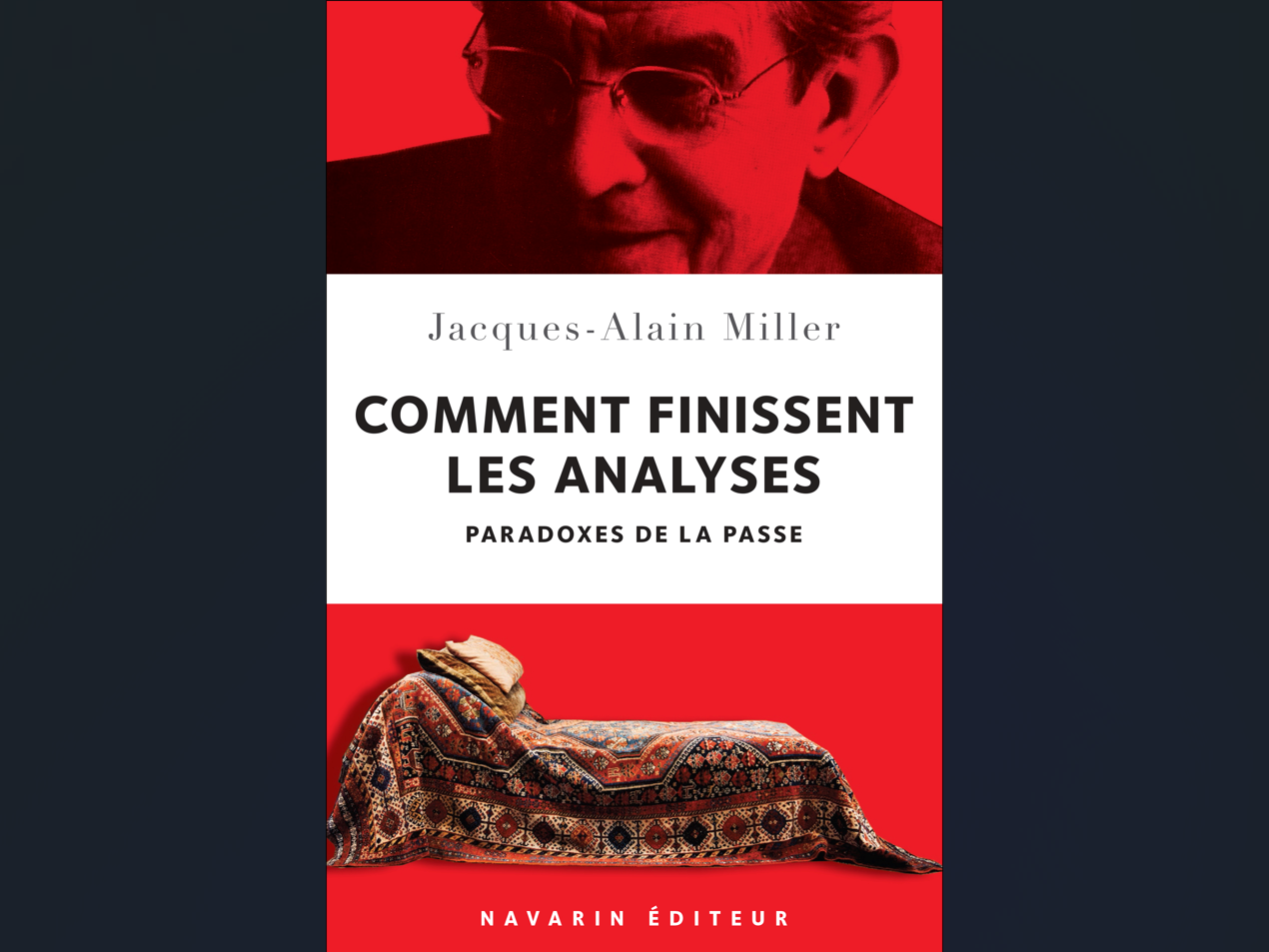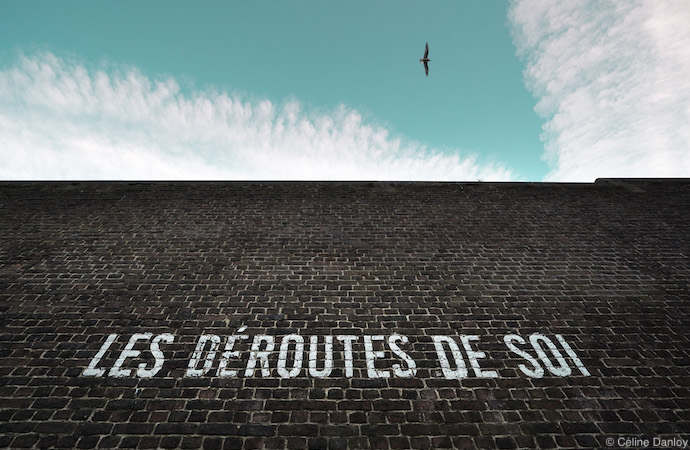Quel est le statut du rire dans la psychose ? Dans son livre passionnant Le spectre du rire et la clinique du sujet, Grigory Arkhipov déplie une scène du film de Buñuel El dans laquelle Francisco, torturé par un délire de jalousie en pleine messe, se trouve en proie à une hallucination où les rires sardoniques des paroissiens se déchaînent et le mettent à nu. Bien souvent, le sujet psychotique se vit comme celui dont on rit, celui dont on se moque. C’est un rire qui exclut sa subjectivité et le réduit à son être de déchet, un rire sardonique lié au « dépouillement des voiles moïques qui constituent l’ego »[1].
De même, le rire de Schreber « n’a rien d’amical »[2]. C’est un rire qui raille Dieu, ce Dieu qui a commerce avec les cadavres et ne comprend strictement rien « en ce qui concerne l’intérieur d’un être humain en vie »[3]. Le président est en retour moqué par la ritournelle des rayons divins qui l’appellent « Miss Schreber, miss Schreber ! ».
Dans la clinique avec les enfants psychotiques, on rencontre souvent la moquerie, le rire imputé au semblable, ou en miroir, provenant du sujet pour discréditer le petit autre sur un versant imaginaire. Dans son article « Clinique ironique », Jacques-Alain Miller distingue l’ironie de l’humour : « les deux font rire, mais se distinguent par structure »[4]. Ce qui les différencie essentiellement, c’est le mode de rapport à l’Autre qu’ils impliquent. J.-A. Miller fait de l’ironie l’apanage du schizophrène qui traite les mots comme les choses car pour le schizophrène, le symbolique est réel. L’humour est réservé au névrosé, dans la mesure où « [l]e dit humoristique se profère par excellence au lieu de l’Autre »[5], il vise un au-delà de l’Autre ainsi que Lacan l’analyse à partir du Witz de Freud. « L’ironie au contraire n’est pas de l’Autre, elle est du sujet, et elle va contre l’Autre. Que dit l’ironie ? Elle dit que l’Autre n’existe pas, que le lien social est en son fond une escroquerie »[6].
Néanmoins, le maniement du rire me semble très précieux dans le traitement des enfants psychotiques et peut marquer des moments importants dans la cure. Ainsi, il est frappant d’observer combien dans la clinique en institution, le rire occupe une place essentielle. Un certain maniement de l’ironie me semble être une tentative de restaurer le lien social, et d’inclure l’Autre. Je fais l’hypothèse que cette forme d’ironie est un traitement du rire moqueur, une manière pour le sujet psychotique de traiter l’Autre. Et cet Autre qui le persécute, c’est d’abord le parasite langagier. Lorsque, au lieu d’être ri par l’Autre, l’enfant peut se faire auteur d’une blague et tenter un jeu de mots en vous incluant dans son rire, quelque chose s’allège et le décolle de l’être d’objet qu’il est pour l’Autre.
Ainsi, les enfants que nous recevons à l’hôpital de jour nous indiquent à quel point la greffe du langage n’a pas pris pour eux : l’un s’exprime par des ritournelles qu’il prélève de dessins animés, l’autre interdit à quiconque de prononcer les noms propres qui le mettent dans une excitation explosive, un autre encore ne supporte pas que l’on fasse la liaison entre les mots, etc. Et voilà que cet enfant qui pense toujours que l’on se moque de lui se met à rire de mon nom qu’il découpe : Bouille rit ! je ris avec lui. Désormais, dès qu’il me croise, il vient vérifier que nous pouvons rire ensemble. Avec un autre, ce sera une erreur de ma part sur un nom qui déclenchera son rire et qu’il corrigera. Il pourra ensuite écorner les mots exprès, pour rire avec moi des mots qui le persécutent.
Quelle fonction a le rire pour ces enfants ? Il ne s’agit pas seulement de rire de moi parce que je me trompe ou que mon nom prête à la blague, en entamant la consistance de l’Autre, mais également de rire avec moi en vérifiant que je ris bien avec eux et que j’ai compris leur blague. Ils me font partenaire de leur rire qui traite et tord l’Autre du langage !
Hélène de La Bouillerie
__________________
[1] Arkhipov G., Le spectre du rire et la clinique du sujet. Varias théoriques et psychopathologiques, Rennes, PUR, 2021, p. 211.
[2] Ibid., p. 215.
[3] Schreber D. P., Mémoires d’un névropathe, Paris, Seuil, 1975, p. 55.
[4] Miller J.-A., « Clinique ironique », La Cause freudienne, n°23, 1992, p. 5.
[5] Ibid.
[6] Ibid.