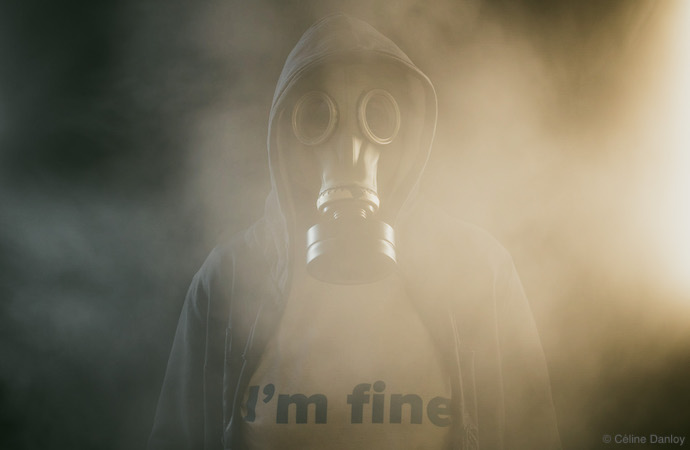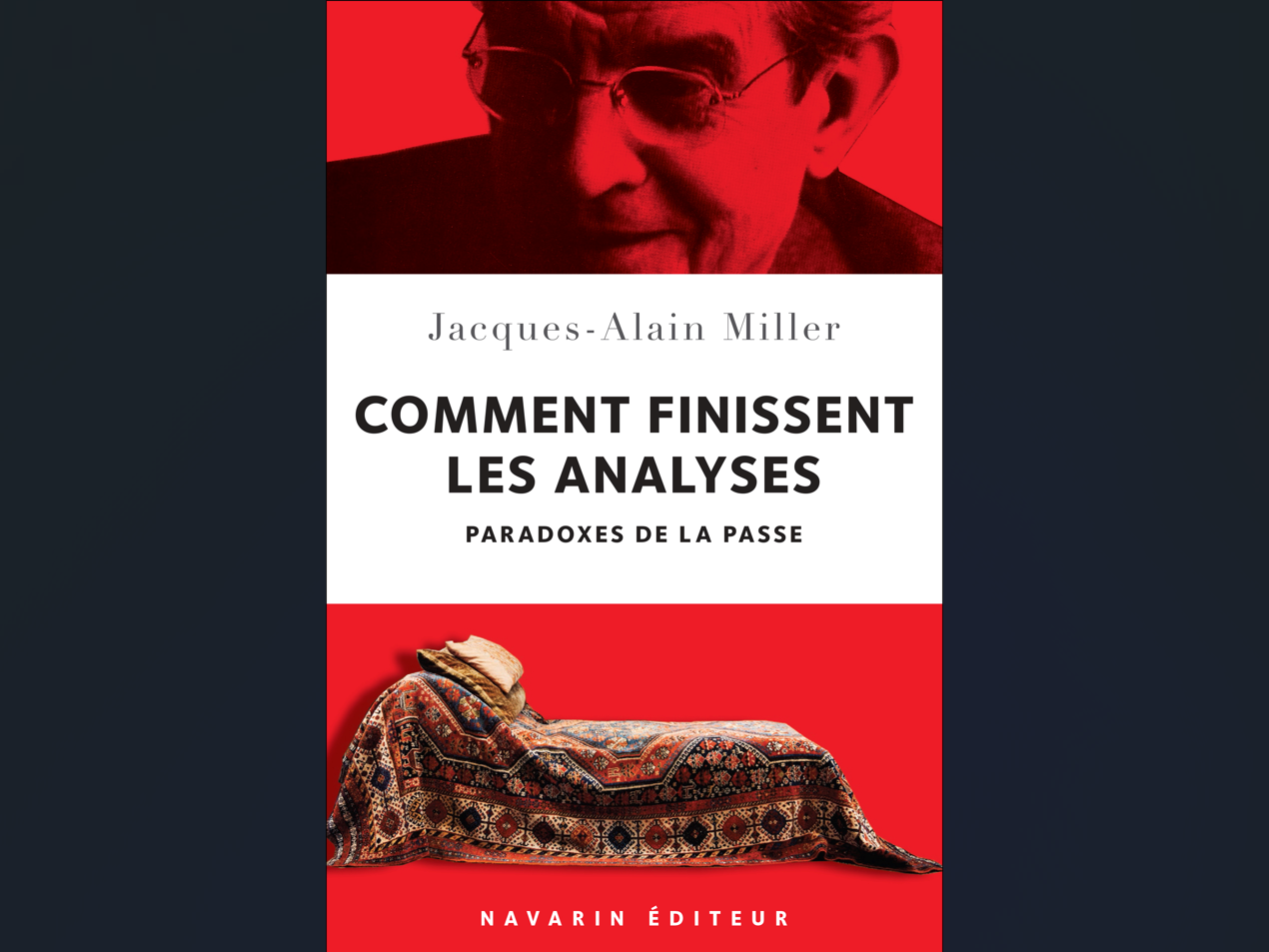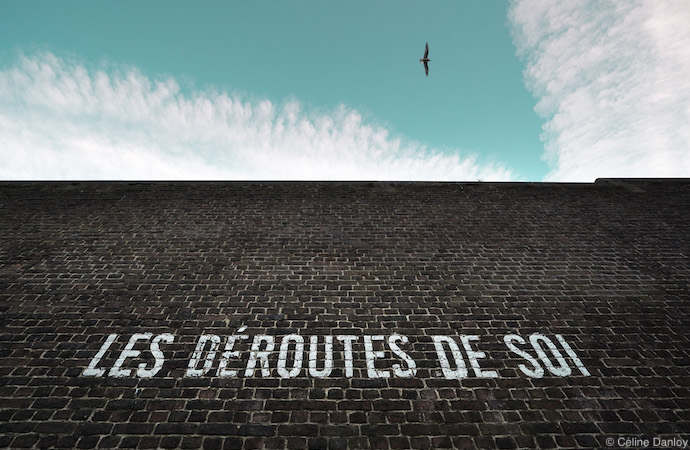Le rire ne passe pas par le processus de compréhension, et s’affairer à seulement en démonter l’articulation reviendrait à figer son envol. À suivre Kant, nous serions amenés à considérer le rire comme « l’anéantissement de l’entendement »[1], mais depuis Freud nous savons que ce qui fait rire c’est la pulsion[2].
Freud pose une homologie entre le travail du rêve et celui du mot d’esprit, à partir de laquelle il établit la relation du mot d’esprit à l’inconscient. Sa recherche – de 1905 – témoigne de tout l’intérêt qu’il porte à la notion de plaisir (Lust) contenu dans le mot d’esprit. Freud établit que la finalité du Witz est cette obtention de satisfaction qui se manifeste par le rire. L’innocent et le tendancieux sont deux types de Witz, l’un fondé sur la dimension formelle de la langue, l’autre étant au service de la pulsion. L’innocent ne provoque qu’un rire modéré, tandis que le tendancieux, hostile ou bien obscène, déchaîne « ces brusques éclats de rire qui [le] rendent si irrésistible »[3].
Évidemment, c’est bien au-delà d’une typologie que nous invite Freud dans cet ouvrage. Sa richesse est de situer cette satisfaction, en son fond, comme au-delà du plaisir. Cette voie frayera la suite de sa recherche sur l’inconscient. Le mot d’esprit nécessite une structure ternaire, où l’Autre sera ce tiers qui s’ajoute au premier personnage d’où jaillit le mot d’esprit, et au deuxième, qui est moqué. Le Witz met donc en scène la fonction de l’Autre, ce qui fait de l’inconscient un discours en acte, entre le sujet et l’Autre.
Cette particularité du mot d’esprit implique la croyance en l’Autre, c’est un préalable à sa production. Lorsqu’une incroyance fondamentale est aux commandes, un sujet peut s’armer de dérision pour traiter son rapport à l’Autre. Les concours de « clash » qui s’organisent parfois entre adolescents seraient les joutes oratoires version rap. Ces affrontements verbaux sont codifiés et vont de la dérision à la vexation, par l’usage d’une langue en prise directe avec le réel du corps et la jouissance. Scander des textes percutants constitue alors une invention, un traitement du réel. Le public constitue ici la dritte Person qui entérine le trait lancé à l’autre, et parfois même l’applaudit.
Du Witz à l’âpreté des « clash » tournant l’autre en dérision, l’étendue des modes de dire est aussi vaste que celle des modes de jouir, de même parfois que leurs égarements. Depuis Encore[4], nous savons que la parole est conçue comme jouissance, comme « mode de satisfaction spécifique du corps parlant »[5].
Le Witz n’est pas du côté du chiffre, mais du Blitz, de l’éclair. Il participe de ce qui donne son étoffe singulière à chacun en tant qu’être parlant. Dans un éclair, parfois à la grâce d’un Witz, saisir l’ouverture de l’inconscient et que quelque chose s’en révèle…
Dans l’expérience de l’analyse, rire ou sourire qui adviennent chez l’analysant font signe d’un gain d’allégement voire d’une libération d’avoir rompu l’entrave d’une signification. Ne serait-elle que cela, l’analyse déjà vaut la mise. Plus loin, pour une trajectoire analysante qui passe de l’impuissance à l’impossible, du tragique de la douleur d’exister au comique de la vie, Jacques-Alain Miller ajoute que « la passe en est le Witz »[6].
Philippe Giovanelli
_________________________
[1] Arkhipov G., Le spectre du rire et la clinique du sujet. Varias théoriques et psychopathologiques, Rennes, PUR, 2021.
[2] Freud S., Le mot d’esprit et ses relations à l’inconscient, Paris, Gallimard, 1988.
[3] Ibid., p. 187.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975.
[5] Miller J.-A., « Les six paradigmes de la jouissance », La Cause freudienne, n°43, octobre 1999, p. 20.
[6] Miller J.-A., « Le partenaire-symptôme », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 17 juin 1998, inédit.