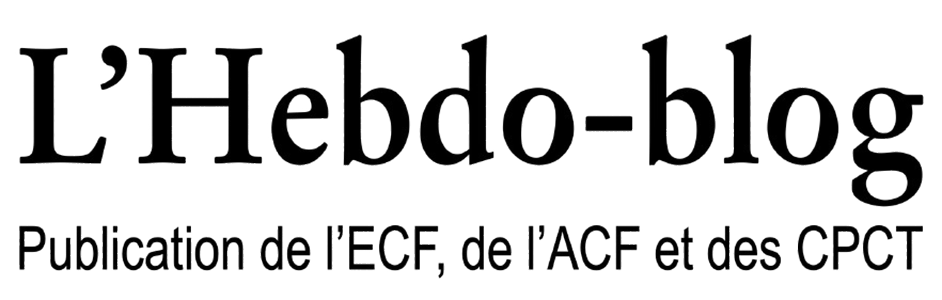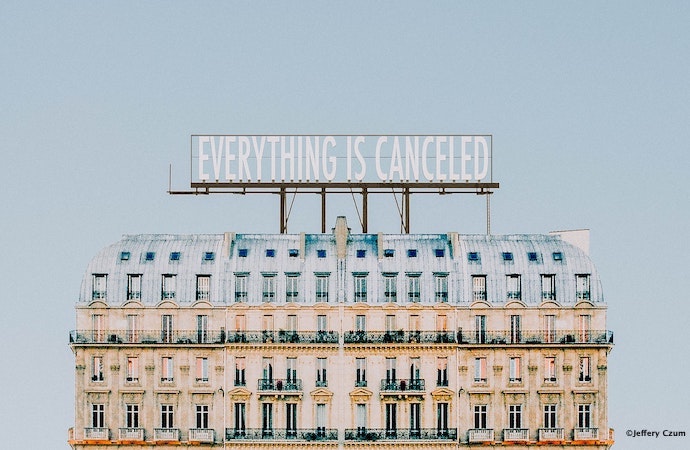Les activistes woke ont pris pour habitude de dénoncer toute personne en vue qui aurait enfreint de façon plus ou moins avérée les codes sociaux relatifs à la race ou au genre, codes qu’ils ont eux-mêmes énoncés. Est-ce la colère qui les pousse, celle dont Sénèque repérait en son temps qu’elle enflammait les esprits irritables à la moindre apparence d’injure qui frappe [1] ?
La rage et la colère ne peuvent seules expliquer cette détermination dont l’ambition première est de lutter contre les inégalités et les discriminations de sexes et de races. Quelque chose de plus profond, de plus obscur, œuvre dans ce mouvement dont l’ambition est une réforme des jouissances ; et, plus précisément, de la jouissance phallique conçue comme un principe de domination.
Malgré les nombreux brouillages qui rendent difficile la compréhension des concepts qui sous-tendent ces furieuses volontés, le point visé est très clair : l’effacement du sujet. L’écrasement de la place du sujet dans son adresse à l’Autre est assuré par la notion d’identité devenue le blason de toutes les haines et de toutes les rivalités. En conséquence, l’effacement de l’Histoire se retrouve dans toute entreprise initiée par la cancel culture, qui est l’une des émanations les plus actives du mouvement woke.
Prenons l’exemple commenté par Robert Badinter concernant la notion dite de race. Le conseil municipal de la ville de New York a décidé d’enlever de sa salle des séances la statue de Thomas Jefferson, l’auteur de la déclaration d’indépendance, un des hommes les plus importants de l’histoire des États-Unis. On lui reproche d’avoir eu des esclaves dans sa plantation en Virginie. Robert Badinter le commente ainsi : « Avant la guerre de Sécession, il y avait des esclaves, c’était comme ça ! On ne peut pas demander à Jefferson de se conformer aux normes de notre époque. C’est le crime de rétroactivité, il est coupable d’un crime qui n’existait pas à son époque. Il y a là une lecture de l’histoire à travers les lunettes d’aujourd’hui qui rend aveugle, qui brouille la vue. […] On doit aller vers le passé avec attention, précision et respect, on ne doit pas exiger du passé qu’il soit conforme aux valeurs du présent » [2].
Cet effacement des symboles « caractéristique de la cancel culture » est la parfaite illustration « du point de rebroussement, du point de réversion » [3] à partir duquel les intentions de départ deviennent tyranniques. Ainsi se constitue un espace irreprésentable qui ne cesse pas de ne pas s’écrire.
* Miller J.-A., « Conversation d’actualité avec l’École espagnole du champ freudien », La Cause du désir, n°108, juillet 2021, p. 54, disponible sur le site de Cairn.
[1] Sénèque, L’Art d’apaiser la colère, Paris, Mille et une nuits, 2008, p. 11.
[2] Badinter R., « Combats, Robert Badinter », entretien avec L. Adler, France Inter, 21 octobre 2021, disponible sur le site de France Inter.
[3] Miller J.-A., « Conversation d’actualité avec l’École espagnole… », op. cit., p. 54.