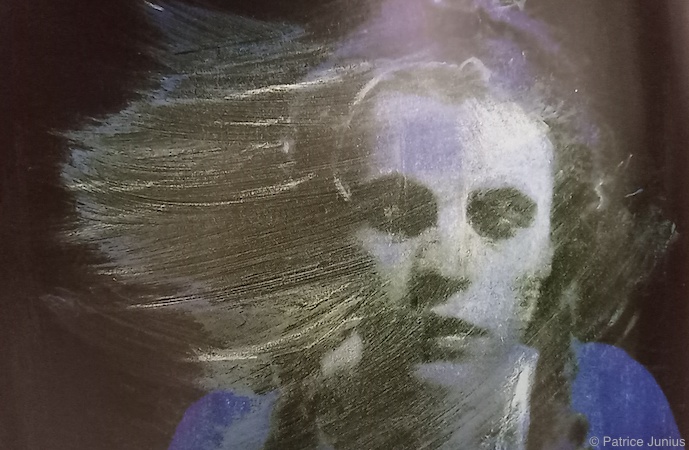Un univers pareil à un bordel en flammes où règne le goût de l’apocalypse, de la dévastation et de la pagaille intérieure : c’est le crayon imagé que Cioran dessine, en y rajoutant même la paresse de la Russie soviétique et des pays sous son emprise dans un petit texte extraordinaire « La Russie et le virus de la liberté » sur lequel Jacques-Alain Miller a récemment attiré l’attention [1]. Écrit en 1957 peu après la répression de la révolution hongroise de l’automne 1956 par l’armée rouge, ce texte est pourtant d’aujourd’hui au point de donner à penser que l’auteur est revenu d’entre les morts pour nous ouvrir les yeux. Ni historien, ni politologue, ni philosophe, ni romancier, bref difficilement identifiable, Cioran échappait au défaut ordinaire des spécialistes qui consiste à passer à côté du réel de ce dont ils parlent. Le résultat est saisissant parce qu’il réussit en une dizaine de pages aussi incandescentes que lucides à éclairer un réel de mille ans d’histoire russe.
Le cœur de sa démonstration est le suivant : la Russie est un colosse qui n’a pas été créé pour rien puisque son sens est de s’étendre au-delà de ses limites en une expansion qui donne moins l’idée d’une crise que d’une épidémie. Elle la justifie au nom de son immense espace : « Du moment que j’en ai assez pourquoi ne pas en avoir trop ?, tel est le paradoxe implicite de ses proclamations et de ses silences » écrit joliment Cioran qui rajoute ces mots qui disent tout : elle a converti l’infini en catégorie politique et bouleversé ainsi le cadre classique de l’impérialisme [2].
Ce mouvement semble se perdre dans la nuit des temps puisque Cioran évoque l’invasion mongole du XIIIe siècle que la Russie a arrêtée avant de la résorber voire de s’y dissoudre. Il reprend ou commence de façon spectaculaire et lisible – c’est-à-dire en devenant thème littéraire avec Pouchkine, Tolstoï, Lermontov, et d’autres – au XVIIe siècle sous l’impulsion de Pierre le Grand, de Catherine II et de son amant Potemkine, dans les confins orientaux de l’empire avec la conquête de la Crimée, du Caucase, de l’Asie centrale. Lors de la deuxième guerre mondiale, la conquête a changé de cap pour virer à l’ouest avec les avancées de Staline jusqu’à Berlin. La première vague nous a distraits, la seconde angoissés.
Les réserves que l’on peut faire sur ces subdivisions commodes pour l’exposé – il y eût avant le XXe siècle de nombreux mouvements d’expansion vers la Pologne, la Finlande, etc.– sont de peu d’importance au regard de ce que furent ces conquêtes. En effet, il ne s’agissait pas d’agrandir l’empire selon les logiques politique ou capitaliste habituelles, mais de l’étendre pour l’étendre. Ce n’était pas un colonialisme ordinaire, mélange de vol et d’exploitation pour s’enrichir, mais une manière de dévastation ou de ravage – la Russie « s’aplatira sur l’Europe par fatalité physique, par l’automatisme de sa masse, par sa vitalité surabondante » écrit Cioran [3]. Pour quoi faire sinon dominer ? Nous ne qualifierons pas cette expansion d’irrationnelle ou de barbare, ce qui ne reviendrait qu’à la méconnaître, mais verrons dans cette volonté de domination rien moins qu’une véritable volonté de jouissance sans rimes ni raisons, sans pourquoi. En outre, en plaçant cette volonté à l’enseigne de l’infini, Cioran indique qu’elle n’aura aucune autre limite que celle de sa force même ou de celle qu’on lui opposera : elle s’arrêtera qu’à ne pouvoir aller plus loin. C’est un quod sans quid, un c’est qui ne peut dire ce qu’il est.
Cette volonté nécessite l’entremise de tyrans puisque la jouissance ne rassemble personne sans l’aide de puissants signifiants maîtres. Pour Karamzine, le premier historien russe au début du XIXe siècle cité par Cioran, c’est l’autocratie qui a fondé la Russie et constitue le fondement même de son être – Madame de Staël réfugiée en Russie pour fuir le seul autocrate que s’est autorisé la France moderne avec Napoléon, précise d’ailleurs dans un style plus parisien que le gouvernement russe c’est un despotisme mitigé par la strangulation ! [4] Les tyrans ne manquèrent donc pas, depuis Ivan le Terrible, Pierre le Grand et Catherine II fascinant les philosophes des Lumières jusqu’à ces autres idoles indéboulonnables que sont Lénine et surtout Staline. La question de savoir si tel d’entre eux est plus ou moins fou est futile puisque quelle que soit la façon dont ils jouèrent leur partition, la mélodie resta identique. Comme l’écrit Cioran, « Cette hantise [de la Russie] seule compte. Le reste n’est qu’attitude. » [5] La même remarque vaut pour tous ceux qui font de la Russie leur objet de pensée, du nationaliste le plus réactionnaire jusqu’à Gogol en passant par Dostoïevski. Autrement dit une certaine idée de la Russie, soit la Grande et Sainte Russie, transforme les différences en faux-semblants.
Cioran avoue aussi une trouble fascination pour les tyrans, qu’il vomit par ailleurs, pour la simple et bonne raison qu’ils nous révèlent à nous-mêmes en dévoilant le mauvais génie qui nous habite [6]. Ne pourrions-nous pas dire, en paraphrasant ce que J.-A. Miller disait du caprice, que le charme maléfique des tyrans tient à qu’ils assument comme leur volonté propre la volonté sans loi qui les agite ? [7]
Chaque peuple n’étant pour Cioran que la somme de ses obsessions, celle qui prévaut en Russie, soit l’idée impériale, a d’autant mieux prospéré qu’elle existait déjà sur le plan spirituel. En effet, depuis la chute de Byzance en 1453, la religion orthodoxe se voulait l’héritière de la vraie foi chrétienne et considérait Moscou comme la troisième Rome. Schisme et hérésie n’étant pour Cioran que nationalismes déguisés, la Russie sut être ce qu’elle voulait, soit différente et autre. Cette différence s’est développée en discours après les guerres napoléoniennes avec le débat entre occidentalistes et slavophiles dont Dostoïevski a donné un écho dans Les démons [8] – et d’ailleurs qu’est-ce que le démon sinon un jouir obscur comme le fameux Nicolas Stavroguine ?
Avant de s’occuper d’histoire des sciences, Koyré a consacré son premier livre au slavophilisme, signe peut-être de son importance persistante [9]. Amalgame de philosophie romantique influencée par l’Allemagne et de nationalisme religieux, le slavophilisme posait, et pose encore, que la Russie, la Sainte Russie, allait sauver le monde, et pour ce faire le dominer. C’est dire que la démocratie convient mal pour la Russie puisqu’elle ne pourrait s’en accommoder qu’à s’affaiblir. Pour Cioran la liberté épuise ce qu’il appelle l’énergie, que nous dirions libido, alors que l’autocratie, en imposant une vie végétative tendue vers un seul but, en est plus économe. Le résultat c’est que l’Occident se serait dépensé, gaspillé alors que l’Orient aurait fait des réserves. Si l’effondrement de l’Empire soviétique l’étonna à l’époque, il n’en concluait pas pour autant à l’épuisement de la volonté qui l’animait [10]. Le mouvement reprendrait inévitablement, l’autocratie ayant veillé au grain [11]. Nous y sommes.
Philippe Hellebois
_____________________________
[1] Il est repris dans un recueil de 1960 intitulé Histoire et utopie où il voisine avec deux autres textes tournant autour des mêmes questions « Sur deux types de société » et « A l’école des tyrans ». Cioran, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 2011, p. 446-458.
[2] Ibid., p. 457.
[3] Ibid., p. 453.
[4] Cité par Pouchkine, « De l’histoire russe au XVIIIème siècle », Pouchkine, Griboiédov, Lermontov, Œuvres, Paris, Gallimard, Coll. La Pléiade, p. 863.
[5] Cioran, op. cit, p. 451.
[6] Ibid., p. 447.
[7] Cf. Miller, J.-A., « Théorie du caprice », Quarto n°71, août 2020, p. 9.
[8] Cf. Dostoïevski F., Les démons, trad. André Markowicz, 3 vol., Arles, Actes Sud, 1995. Voir « Chez Tikhone », II ; p. 437-495, et la précieuse note du traducteur, III, p. 379-397.
[9] Koyré A., La philosophie et le problème national russe au début du XIX siècle, Paris, Gallimard, Idées, 1976, p. 111-37, 225-246.
[10] Tous les chemins mèneraient-ils à Moscou ? se demandait Cioran dans une première version de son texte. Cioran, op. cit., p. 1417.
[11] Voir aussi Cioran, Entretiens, Paris, Gallimard, 1995, p. 261-283.