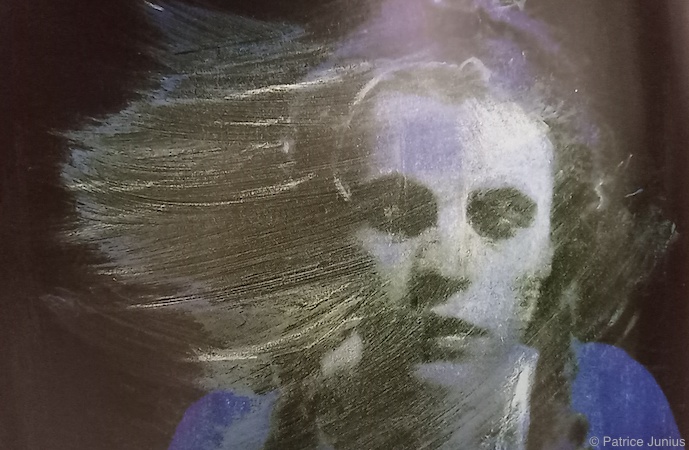« Pourquoi la guerre ? » Freud et Lacan divergent sur ce point. Dans le texte de 1932 qui porte ce titre coécrit par Freud et Einstein, le pacifisme est la position raisonnable de l’homme civilisé. « C’est pourquoi nous ne pouvons que nous indigner contre elle [la guerre], c’est chez nous autres pacifistes une intolérance constitutionnelle » [1]. Freud conclut son texte par une question angoissée. Il est pacifiste, mais tous ne le sont pas. « Combien de temps nous faut-il encore attendre avant que les autres aussi deviennent pacifistes ? » [2].
Limites de la biopolitique
Lacan prenait ses distances avec l’approche « scientifique » d’un phénomène réel : « C’est fou ce que ça rejette la science ! […] et qui existe pourtant quand même. À savoir la guerre. Ils sont tous là, tous, les savants à se creuser la tête : Warum Krieg ? […] Ils se mettent à deux pour ça, Freud et Einstein. Ce n’est pas en leur faveur » [3]. Lacan, lui, parlait de la guerre comme d’une dimension inéliminable du pouvoir. « Le pouvoir […] a besoin d’une guerre tous les vingt ans. […] Cette fois-ci, il ne peut pas la faire, mais enfin, il va bien y arriver quand même » [4]. La nécessité de la guerre ainsi reconnue, comme quelque chose qui ne cesse pas donne une limite à la biopolitique selon Foucault. La paix et les mesures biopolitiques ne sont pas pour tout le monde. Régulièrement, un pouvoir, qu’il soit capitaliste et démocratique ou qu’il soit tyrannique, se rappelle au bon souvenir de ses administrés et déclenche une guerre.
Puissance des Empires et des Tyrans
Sur la guerre et son pourquoi, Cioran est du même côté que Lacan. Guerre et pouvoir sont inséparables. Dans le texte incroyable que nous lisons, Cioran fustige les démocraties occidentales qui ont laissé faire à Budapest, mais au-delà développe une analyse du pouvoir russe à travers les siècles dans une tonalité de science-fiction. Il présente avant tout la Russie soviétique comme un Empire slave avec une forme de pouvoir tyrannique qui est restée pratiquement inchangée à travers les formes de la monarchie ou de la « démocratie populaire » du « petit père des peuples ». Et surtout, cet Empire est investi depuis sa naissance d’une mission, d’abord celle de sauver la chrétienté catholique d’elle-même en devenant la « Troisième Rome ». La révolution russe de 1917 a renouvelé la mission devenue celle d’accoucher de l’homme nouveau soviétique, avenir de l’Europe. Loin de la perspective de la « Fin de l’histoire » et du triomphe annoncé des démocraties occidentales, à la Fukuyama, Cioran annonce l’irréductible de la tyrannie et de la sombre fascination qu’elle exerce sur les hommes. Dans une avalanche d’oxymores et de formules frappantes, il dégage l’obscure clarté du pouvoir absolu et combien elle est ancrée dans la subjectivité de chacun. Comme Freud, il fait du Tyran une possibilité interne et non une aberration politique.
« Ivan le terrible [le plus fascinant d’entre eux] ayant fait de son règne et jusqu’à un certain degré de son pays, un modèle de cauchemar, un prototype d’hallucination vivante et intarissable, mélange de Mongolie et de Byzance, cumulant les qualités et les défauts d’un khan et d’un basileus, monstre aux colères démoniaques et à la mélancolie sordide, partagé entre le goût du sang et celui du repentir […] il avait la passion du crime, nous l’avons aussi tous tant que nous sommes : attentat contre les autres ou contre nous même » [5].
Cioran lit l’histoire comme la répétition de la démission de l’Occident devant les menaces d’invasions diverses et c’est cette démission qui a nourri le messianisme russe, seul aux frontières de l’immensité des steppes eurasiennes. « Les prétentions de la Russie à passer de la primauté vague à l’hégémonie caractérisée ne manquent pas de fondement. Que serait-il advenu du monde occidental, si elle n’avait pas arrêté et résorbé l’invasion mongole ? Pendant plus de deux siècles d’humiliation et de servitude elle fut exclue de l’histoire, cependant qu’à l’Ouest les nations s’offraient le luxe de s’entre-déchirer. » [6] Pendant que les Mongols ravageaient les steppes et la Chine, la chrétienté occidentale a attaqué Byzance, l’a affaiblie, puis l’a abandonnée à sa chute. Le messianisme russe a recueilli l’orthodoxie. Le marxisme a renouvelé la mission, sans en altérer la nécessité « En divinisant l’Histoire pour discréditer Dieu, le marxisme n’a réussi qu’à rendre Dieu plus étrange et plus obsédant. On peut tout étouffer chez l’homme, sauf le besoin d’absolu. »
La conviction chez Cioran de la puissance de l’absolu fait qu’il annonce qu’à mesure de sa montée en puissance politique, la Russie se détournera du marxisme pour revenir à la religion. Là est vraiment le côté science-fiction de l’essai. « Plus [la Russie] deviendra forte, plus elle prendra conscience de ses racines, dont, en une certaine manière, le marxisme l’aura éloignée ; après une cure forcée d’universalisme, elle se rerussifiera, au profit de l’orthodoxie. Du reste, elle a marqué d’une telle empreinte le marxisme qu’elle l’aura slavisé […] N’est-il point révélateur que la Révolution, issue en ligne directe des théories occidentales, se soit de plus en plus orientée vers les idées des slavophiles » [7]. Notons que l’idéologie slavophile a répondu au mépris nazi pour les Slaves et a nourri la force de résistance russe à Stalingrad qui a fini par briser la machine de guerre ennemie.
Puissance des peuples soumis et virus de la liberté
Lorsque nous, Occidentaux, regardons se battre les Ukrainiens avec une force et une vitalité exemplaires, le texte de Cioran nous éclaire sur la puissance des peuples soumis au sein de l’Empire, là encore de façon originale. « [La Russie] est condamnée à l’ascension. À force de monter cependant, ne risque-t-elle pas, débridée qu’elle est, de perdre son équilibre, d’éclater et de se ruiner ? […] Plus un empire s’humanise, plus s’y développent des contradictions dont il périra » [8].
Et là, Cioran discerne à l’Est la vitalité des nations soumises qui n’ont pas dit leur dernier mot. « Certaines comme la Pologne et la Hongrie, jouèrent dans l’histoire un rôle non négligeable ; d’autres comme la Yougoslavie, la Bulgarie et la Roumanie, ayant vécu dans l’ombre, ne connurent que des sursauts sans lendemain […]. Maltraitées, déshéritées, précipitées dans un martyre anonyme, écartelées entre le désemparement et la sédition, elles connaîtront peut-être dans l’avenir une compensation, à tant d’épreuves, d’humiliation et même à tant de lâchetés […]. Imaginons cet empire trop vaste se débilitant et se désagrégeant, avec, comme corollaire l’émancipation des peuples : lesquels d’entre eux prendraient le dessus et apporteraient à l’Europe ce surcroît d’impatience et de force […]. Je n’en saurais douter : ce sont ceux que je viens de mentionner » [9]. Il y ajoute même les Balkans, malgré la mauvaise réputation du nationalisme serbe, et l’aventure fasciste de la Roumanie dans laquelle il s’était fourvoyé.
Cioran, prolongement de Kojève
L’accent mis par Cioran sur la nécessité des Empires et son examen de l’Empire slave complète ce qu’un autre Russe, Kojève pouvait avoir de doctrine sur la nécessité de l’Empire. Sollicité en 1945 par les Affaires étrangères, Kojève, dans un texte resté longtemps inédit, décrit l’avenir supranational de l’Europe de l’après-guerre sous la forme politique de l’empire. La bureaucratie ordo-libérale n’avait pas encore gagné la main.
« L’état moderne, la réalité politique actuelle, exigent des bases plus larges que celles que représentent les Nations proprement dites. Pour être politiquement viable, l’État moderne doit reposer sur une vaste union “impériale” de nations apparentées. L’État moderne n’est vraiment un État que s’il est un Empire » [10]. Kojève considère qu’au moins trois vont émerger. L’empire américain ou anglo-saxon, l’empire slavo-soviétique et il propose qu’en Europe se fasse un empire latin. Les empires sont liés pour Kojève, par ce qu’il appelle une « parenté entre nations ». Il entend par là un lien de civilisation. « La « parenté » des nations est surtout et avant tout, une parenté de langage, de civilisation, de « mentalité » générale …. Et cette parenté spirituelle se traduit entre autres par l’identité de la religion » [11]. Kojève trace donc une ligne de partage entre le monde anglo-saxon, protestant, avec inclusion rapide de l’Allemagne dans l’ensemble, le monde orthodoxe slave, et le catholicisme latin. Ces ensembles sont très proches de ce que nous appellerions un « mode de jouir ».
Le catholicisme de Kojève ne se définit pas par le dogme. Il est aussi étrange que l’orthodoxie selon Cioran. De façon ironique, Kojève oppose les protestants qui travaillent aux catholiques qui savent développer le charme des loisirs en héritiers de l’otium romain. Kojève détourne ici sciemment au profit de sa perspective, le lien entre protestantisme et capitalisme établi par Max Weber dans son ouvrage L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme. [12]
Dans ce texte, Kojève dit peu de choses sur l’Empire slavo-soviétique. C’est sans doute son stalinisme rêvé qui l’a empêché d’en dire plus sur le mode de jouir particulier que l’Empire du Goulag allait mettre au point. En ce sens, le texte messianique de Cioran ajoute un complément indispensable à Kojève.
La description du messianisme russe n’a été possible pour Cioran qu’après une mue subjective extraordinaire. Lui qui a été admirateur d’Hitler et de Codreanu va devenir le porteur d’une autre révélation. Les démocraties ne pourront affronter l’Empire que si elles se lèvent pour combattre. La liberté en elle-même ne suffit pas. Laissée à elle-même, elle est un virus débilitant. Philippe Sollers a bien vu que « Cioran a été messianique, et il va d’ailleurs le rester, de façon inversée, dans le désespoir »[13]. Et la mutation n’a été possible que « par sa conversion éblouissante à la langue française ». Sollers trouve les oxymores pour nommer cette mutation. « Ne voulant plus être le complice de qui que ce soit, il devient un intégriste du scepticisme, un terroriste du doute, un dévot de l’amertume, un fanatique du néant. » [14] De cela il sut extraire une vision qui nous parle aujourd’hui, et nous brûle.
__________________________
[1] Freud S., « Pourquoi la guerre », (1932), in Œuvres complètes. Psychanalyse, Vol. XIX, Paris, PUF, 1995, p. 81.
[2] Ibid.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XXI, « Les non-dupes errent », leçon du 20 novembre 1973, inédit.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2006, p. 242.
[5] Cioran, « La Russie et le virus de la liberté », in Œuvres, Paris, Gallimard, coll. La Pléiade, 2011, p. 446.
[6] Cioran, « La Russie et le virus de la liberté », op .cit., p. 448.
[7] Ibid, p. 450-451.
[8] Ibid., p. 454-455.
[9] Ibid., p. 455.
[10] Kojève A., « Esquisse d’une doctrine de la politique française » (août 1945), La Règle du jeu, n°1, mai 1990, p. 91, disponible à https://laregledujeu.org/2021/10/07/37763/l-empire-latin-par-alexandre-kojeve/
[11] Ibid., p. 103.
[12] Cf. Weber M., L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme, Paris, Flammarion, 2017.
[13] Sollers P., « Quand Cioran admirait Hitler », in Bibliobs, 14 mai 2009, disponible à https://bibliobs.nouvelobs.com/essais/20090514.BIB3427/quand-cioran-admirait-hitler-par-philippe-sollers.html
[14] Ibid.