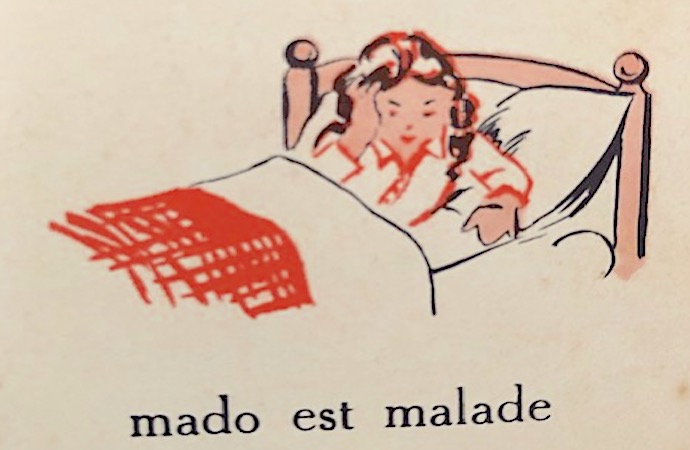Avignon, juillet 2007. Lors d’une exposition monographique consacrée à l’artiste américain Cy Twombly, une femme, cambodgienne de trente ans, embrasse l’un de ses tableaux. C’est dans la salle dédiée aux Trois dialogues de Platon que Rindy Sam, c’est son nom, imprime la forme de ses lèvres imprégnées de rouge à lèvres sur la toile blanche de trois mètres sur deux du triptyque Phèdre.
Croyant que l’artiste comprendrait son « acte d’amour », elle affirme que son baiser possède une consistance ontologique, puisqu’elle précise que les œuvres de Twombly « redonnent de la consistance ontologique à son être » [1], à son être à elle. Après s’être déclaré « horrifié », le peintre la poursuit en justice.
C’est alors que la polémique éclate : d’un côté, le monde de l’art qui condamne unanimement le baiser rouge, comme il l’aurait fait de n’importe quel acte de vandalisme contre une œuvre d’art ; de l’autre, les médias, émerveillés par ce geste d’amour, qui soutiennent massivement R. Sam. D’où vient un tel aveuglement ? Pourquoi ce baiser a-t-il été encensé par les médias ?
Pour excuser leur héroïne, les médias font tourner le « disque-ourcourant » [2]. À la signification de l’amour, ils ajoutent des interprétations psychosociologiques. Ils injectent du sens en présentant R. Sam comme une réfugiée dont la famille fut décimée par les Américains dans les rizières de Battambang : pas de doute, son baiser symbolise un geste de réconciliation entre deux peuples ennemis ! Aveuglés par l’arme du crime – le rouge à lèvres au lieu des habituels couteau, marteau ou jet d’acide – ils construisent la fiction d’une « femme libérée qui assume sa féminité sans demander de permission » [3]. À l’artillerie lourde de par-êtres [4] avec laquelle ils cherchent à couvrir l’inexistence du rapport sexuel, s’ajoutent les nombreuses manifestations de haine contre l’art contemporain.
C’est précisément dans son Séminaire XX que Lacan, orienté par le réel en tant qu’impossible à écrire, opère dans l’expérience analytique un passage de l’écoute à la lecture. Il affirme de manière radicale que « dans le discours analytique, il ne s’agit que de ça, de ce qui se lit […] au-delà de ce que vous avez incité le sujet à dire »[5]. Des années plus tard, il réalise un deuxième passage qui transforme sa conception du transfert. Dans son Séminaire « Le moment de conclure », il passe de l’hypothèse du sujet supposé savoir (sa formule du transfert en tant qu’il ne se distingue pas de l’amour) à la perspective du « supposé savoir lire autrement » [6], cherchant ainsi à dissoudre les illusions de l’inconscient transférentiel. Les deux passages mentionnés exigent la participation de l’écriture.
Lacan prévient qu’« à considérer que les choses vont de soi[,] on ne voit rien de ce qu’on a pourtant devant les yeux […] concernant l’écrit » [7]. En effet, quelque chose reste couvert dans la polémique du baiser rouge : la toile blanche de Twombly, « peintre d’écriture » [8] comme l’appelait Roland Barthes.
Pour les médias, sur cette toile blanche, avant le geste de R. Sam, il n’y avait rien. C’est pourquoi, ils célèbrent le triomphe de l’Un-imaginaire du baiser qui complète la toile. En cherchant à se défendre du réel, ils ignorent le vandalisme de la copule de l’être.
La toile blanche de Twombly n’était cependant ni vierge ni tabula rasa. Plutôt faut-il y lire une crise de la représentation, une absence d’image figurative, un épuisement du sens, c’est-à-dire l’impossible représentation du parlêtre. Le blanc ne raconte pas d’histoires. L’« “effet” Twombly » [9] n’est pas rhétorique.
Aucun baiser, si ontologique soit-il, ne réussira à couvrir complètement le blanc « du réel qui ne puisse pas venir à se former de l’être, à savoir le rapport sexuel » [10].
Certes, une analyse lacanienne ne triomphe pas sur la débilité mentale, mais elle nous permet de lire l’insensée toile blanche avec laquelle chaque parlêtre aura la chance de rendre un peu de dignité aux choses de l’amour.
[1] Extrait du texte du conseiller artistique de Rindy Sam, cité par P. Levieux, in « Faut-il condamner un baiser sur une toile ? », Le Monde, 28 juillet 2007, disponible en ligne. Et cité également par Rondeau C. & Mézil É. (s/dir.), in Dommage(s). À propos de l’histoire d’un baiser, Arles, Actes Sud, 2009, p. 47.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 34.
[3] Rondeau C. & Mézil É. (s/dir.), Dommage(s), op. cit., p. 153.
[4] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 44.
[5] Ibid., p. 29.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XXV, « Le moment de conclure », leçon du 10 janvier 1978, inédit.
[7] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 34.
[8] Barthes R., « Cy Twombly ou “Non multa sed multum” », Cy Twombly, Paris, Seuil, 2016, p. 52.
[9] Barthes R., « Sagesse de l’art », Cy Twombly, op. cit., p. 24.
[10] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 47.