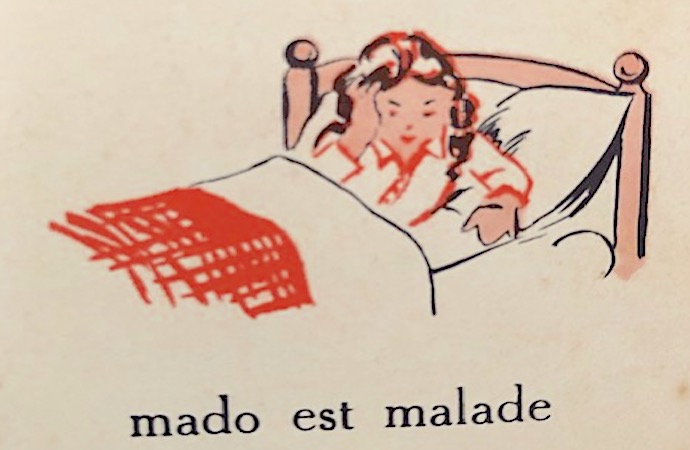Dans son intervention conclusive au congrès de l’École freudienne de Paris à Deauville en 1978, Lacan se demandait comment on peut encore croire en l’analyse [*][1]. L’analysant s’engage dans la cure, avançait-il, pour analyser le tempérament de ses symptômes.
Pourtant, ce à quoi l’analysant aspire, il ne l’espère pas. Et Lacan de préciser que la demande d’élucidation du symptôme est plutôt le vœu de s’en débarrasser, le refus de le lire. Impossible ! Nous sommes dans la logique de la problématique du névrosé qui recule devant son désir et sa jouissance. C’est ce réel-là, celui qui est en acte dans la cure, qui va nous intéresser.
Faisons crédit à Lacan et à Jacques-Alain Miller d’avancer que l’on peut analyser le tempérament du symptôme, ce dont nul n’est cependant porté à parler. Cette offre suppose de construire l’inconscient dans son rapport au ça freudien [2]. Pourtant, il s’agit toujours de faire crédit à l’association libre, jusqu’au point où quelque chose de la jouissance vienne à se dénuder. Dans le développement de la cure, il y a le refoulement et le retour du refoulé accompagné de la pulsion acéphale. Soit une butée que l’analysant rencontre et dont il lui est difficile d’en dire quelque chose. Sur ce versant, ce n’est plus ce qui de l’Autre s’écrit, mais plutôt ce qui dans le corps se laisse aller à écrire. Le corps, disait aussi Lacan à la même époque, n’a de statut respectable que du nœud, R.S.I.
Poursuivons avec Lacan au congrès de Deauville : que peut-on attendre d’un analyste ? Qu’il s’oriente du réel en jeu dans la structure, ce qui suppose qu’il soit, en tant qu’analysant, parvenu au point de conséquence à partir duquel s’est dévoilé pour lui l’inessentiel de l’Autre, du sujet supposé savoir. Dès lors que l’on admet l’inassimilable de la question sexuelle découverte par Freud, le réel, qui met en jeux le corps, oriente la direction de la cure.
La notion de réel, nouée au symbolique et à l’imaginaire est donc au cœur de l’inconscient.
Cela implique qu’en s’engageant dans la cure, l’analysant dépose la part de lui-même qui échappe au savoir. Ce mouvement lui permet de supposer un sujet au lieu même où le savoir manque, puisque l’analysant le postule là où il serait sans lui. La cure lui apprendra que non. Je vous propose de considérer qu’une fois rejoint ce point, cet analysant pourra, s’il le veut, faire exister l’hypothèse d’un savoir inattendu qui résiste à la compréhension et qui est toujours plus que ce que nous pouvons en dire. C’est une logique aussi rigoureuse que subtile. On peut lire Les Formations de l’inconscient [3], Encore [4] et encore. Lire, n’est pas écrire. Avançons que le savoir qui s’extrait de la cure relève de l’écrit.
L’analyse s’intéresse au symbolique, à l’imaginaire et aux réponses du sujet quant à l’inassimilable de la question sexuelle découverte par Freud. Elle opère à partir de ce que le langage détraque. Elle prend son élan d’introduire l’hétérogène, dans la question de la causalité.
Ce qui ordonne l’articulation S1 – S2, aux niveaux individuel et collectif, c’est ce réel. Tout sujet pris dans l’articulation signifiante est confronté à ce défaut qui a fait apercevoir à Freud que le sujet de l’inconscient comme la culture ne se réduisent pas au langage.
Avec l’association libre, l’analysant n’est pas seulement confronté aux réjouissantes créations, il aperçoit aussi qu’une part de son monde est figée. Il est aussi livré aux intimidations de la parole, pas sans la présence de l’analyste qui lui apprend à se saisir comme objet. Très tôt, Lacan a aperçu que la chaîne signifiante attribue une place non équivoque au sujet et que les objets du désir, qui n’appartiennent pas à la structure linguistique, c’est-à-dire la voix et le regard, se conjoignent à l’énonciation. Il s’agit de prendre au sérieux, dans l’inconscient, le point de réel du signifiant par lequel le langage procède.
Quand on touche à « la relation de l’homme au signifiant […], on change le cours de son histoire en modifiant les amarres de son être » [5].
Il y a là la métaphore qui lie le sujet parlant à la question de l’être et la métonymie qui le lie à son manque [6]. Lorsque c’est lié, la lecture est reportée toujours plus loin et le sens est toujours à venir.
Le langage caractérise l’humain, et il a fait croire aux structuralistes qu’il donne un point de vue sur la société, sur le monde. Ce n’est pas l’avis de Lacan : ce qui donne à un sujet un point de vue, c’est le signifiant-maître à partir duquel le langage bâtit son monde. Alors le sujet peut le calculer, le faire rentrer dans des formules ; il peut s’imaginer qu’il le lit. Il peut faire le philosophe, méditer sur l’être etc., pour autant que le signifiant-maître en dessine les contours.
Le signifiant-maître construit un ordre. Il s’inscrit, se prête à la substitution. Il permet de construire des significations. Il donne un sentiment de continuité, mais la structure du signifiant est fondamentalement discontinue.
La primauté que Lacan a donné au signifiant sur le signifié dans ses Écrits fait déjà valoir l’inconscient comme langue privée, forgée par la contingence [7], à l’intérieur des lois du langage. Ce qui dans l’inconscient est sans loi ne s’oppose pas au savoir supposé de l’inconscient. Dans l’expérience analytique, on arrive à purifier le sujet, au sens mathématique du terme. On aperçoit qu’il est fait d’un certain nombre d’articulations qui se sont produites, et dont il est le produit. Ce sujet-là n’est pas celui supposé au savoir, ce pourquoi Lacan choisira d’inventer le signifiant de parlêtre. C’est à partir du signifiant surgissant et rugissant (S1 = surmoi), c’est-à-dire du signifiant-maître, que s’organisent les circuits de la libido, en tant que le langage véhicule une jouissance positive.
Il y a les Uns qui mettent de l’ordre, et il y a les Uns qui défont les ensembles : c’est dans la coupure, lorsqu’ils tombent, que s’entend la dimension pulsionnelle de la langue du sujet, laquelle ne s’adresse à personne. Cette opération est-elle lecture ? Non, des petits bouts s’écrivent, des fragments en chutent qui sont à lire.
Dans la coupure, les chaînes signifiantes qui ont été décisives pour l’analysant apparaissent. C’est aussi à partir de la coupure que s’entend la dimension pulsionnelle de la langue d’un sujet, laquelle ne s’adresse à personne, puisqu’elle ne relève ni de la logique ni des lois du langage.
Lacan témoigne de ce que l’écrit ne se fabrique que de sa référence au langage, bien qu’il s’en écarte.
Quand les quelques articulations qui ont constitué le sujet s’écrivent, dans leur précarité, on a un léger différé, un effet de vide, presque d’absurdité. Un décalage apparaît alors entre le déroulement des associations inconscientes et le vivant.
Autrement dit, dans une analyse, on ne le sait pas, mais on explore un trou et on se débrouille pour qu’il ne devienne pas abîme.
On y parle de ce qui ne peut se dire, à partir des formations de l’inconscient qui rendent présent le désir. Et il y a encore à dire, car l’analyste veille à ce que la cure ne se referme pas sur le mutisme qui est jouissance orale. On tourne autour de la Chose propre à chacun. L’association libre met en évidence une béance qui est la première approche de l’objet. Chemin faisant, l’analyste est mis dans le voisinage des éléments langagiers que la cure réactualise. Il leur donne place ; il se fait partenaire du point de hors-sens qui s’impose, et alors sa présence permet le symptôme, le lapsus, l’acte manqué qui s’inscrivent dans un procès d’écriture. Il se prête à cette mobilisation des ressources de l’inconscient et à son au-delà. L’écriture suppose l’articulation S1 – S2.
Il y a, dans une cure, ce que l’on trouve en négatif, ce qui ne cesse pas d’instaurer de la perte et qui, paradoxalement, crée la jouissance : quelque chose se fixe. Le signifiant cisaille le corps, non sans perte. Alors, quelque chose se sédimente, se dépose, quelque chose de l’objet inassimilable qui est trace du vivant. Ça s’attrape par la logique, mais seulement à considérer le trou, le peu de sens qu’elle fait valoir. L’analyste est bien l’instrument d’une exploration, de bouts d’écritures qui révèlent un sujet, c’est-à-dire une absence. Des points de vue se renouvellent, et c’est réjouissant. Pas longtemps, alors il s’agit pour l’analyste, après avoir été bon entendeur, un bon témoin, qu’il se fasse scribe.
Il faut l’appui du discours analytique pour distinguer soigneusement le maniement du signifiant en tant qu’il habille, qu’il construit le monde du sujet, et l’écriture, cette fois comme ruissellement, comme traitement de ce qui ne peut s’humaniser. L’expérience de l’analyse sépare le signifiant de l’écriture, laquelle est trace. Disons que là où le signifiant a des effets de signifié, il est perte, et qu’il y a aussi le signifiant avec ses effets de corps et de rature.
[*] Extrait d’une conférence prononcée à Montpellier en 2013 et publiée dans le bulletin de l’ACF-Voie domitienne : Tabula, n°19, novembre 2013, p. 33-41.
[1] Cf. Lacan J., « Conclusions », Les Lettres de l’École freudienne de Paris, n°23, 1978, p. 180-181.
[2] Cf. Miller J.-A., « L’inconscient interprète », La Petite Girafe, n°11, octobre 1999, p. 7-16.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre V, Les Formations de l’inconscient, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1998.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975.
[5] Lacan J., « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 527.
[6] Cf. ibid., p. 528.
[7] Les structuralistes parlent d’accident.