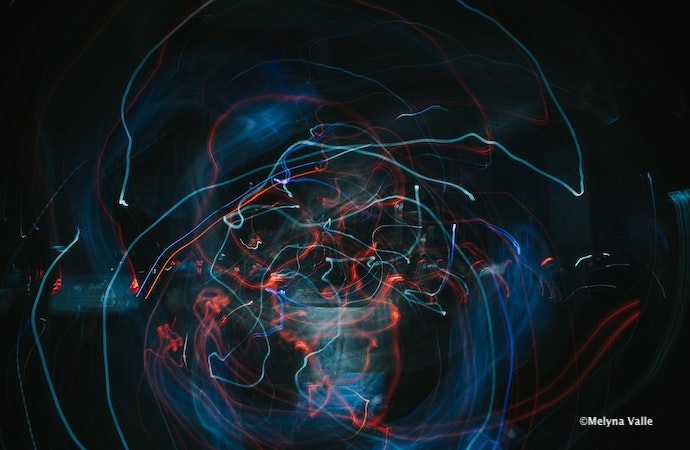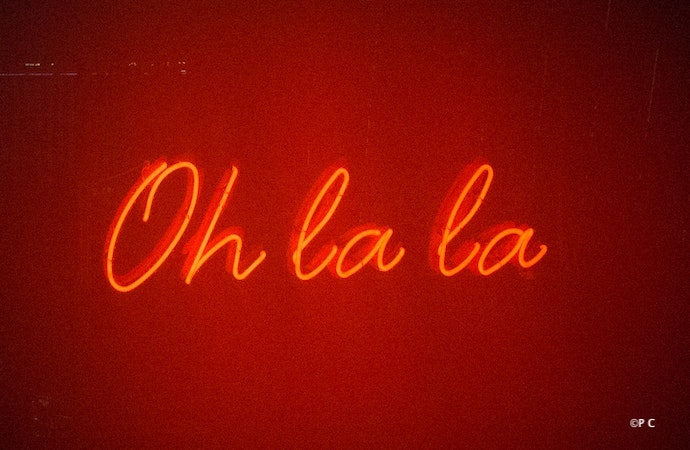Si le symptôme est très souvent la porte d’entrée dans l’expérience analytique, il est également une question théorique centrale depuis la naissance de la psychanalyse [*]. Cela a commencé avec Freud, s’est poursuivi avec Lacan et Jacques-Alain Miller. Par ailleurs, à l’heure des neurosciences, le symptôme, ramené à un trouble fonctionnel, nécessite d’être replacé dans sa dimension de concept fondamental pour la psychanalyse.
C’est une phrase prise dans le cours de J.-A. Miller sur « Le partenaire-symptôme » qui a déterminé mon enseignement de l’année : « le symptôme n’est pas un accident, il n’est pas contingent, […] le symptôme est au contraire de l’ordre de la nécessité » [1]. Un signifiant, prélevé dans cette phrase, en a été le fil rouge : « La nécessité du symptôme dans l’expérience analytique ».
Du point d’origine un retournement s’est ensuite opéré, car après avoir interrogé la nécessité du symptôme et avoir repris l’évolution de ce concept de Freud à Lacan, un autre signifiant s’est imposé, également présent dans la phrase de J.-A. Miller : « il n’est pas contingent ». Si le symptôme n’est pas contingent mais nécessaire, alors un axe nouveau de recherche apparaît qui ouvre une piste à explorer : celle qui va de la nécessité à la contingence. Elle se présente comme la suite logique d’une élaboration à poursuivre.
Ce qui fait la trame de fond de l’approche des différentes modalités du symptôme touche à la place de la jouissance incluse dans le symptôme telle qu’elle se dévoile au cours de l’expérience analytique. Jouir de l’inconscient, répéter jusqu’à épuisement du sens, faire avec ce partenaire-symptôme, dont on se plaint, mais dont on ne peut se séparer, jouir du fantasme en tant qu’il est le plus intime du sujet et dont la fixité rend l’aveu difficile, saisir l’importance du sinthome comme au-delà du fantasme, avec Joyce, et atteindre ce point où Lacan nous conduit : une nouvelle définition du symptôme, en tant qu’il est « un événement de corps » [2] – toutes ces occurrences ont permis d’articuler la question du symptôme avec la théorie analytique au point vif où elle s’élabore aujourd’hui.
Quand le nécessaire du symptôme se caractérise de ce qui ne cesse pas de s’écrire, le réel contingent s’instaure de ce qui cesse de ne pas s’écrire : « C’est dans ce cesse de ne pas s’écrire que réside la pointe de ce que j’ai appelé contingence » [3]. Aborder la contingence, c’est aller vers un réel en tant que ce réel est celui de la psychanalyse. C’est aussi une orientation vers le sinthome, soit le plus singulier de chacun, qui déstabilise les savoirs établis quant à l’inconscient, qui laisse le parlêtre seul avec sa jouissance opaque [4], et au symptôme réduit à son noyau dans le dernier enseignement de Lacan.
Reste que le symptôme, contrairement au fantasme, ne se franchit pas, ne se traverse pas, et « on doit vivre avec, […] s’en débrouiller » [5]. C’est ce à quoi nous a conduit le travail de l’année et, comme l’indique J.-A. Miller, c’est « là-dessus que Lacan nous a laissés, il nous a laissés sur une rétroaction qui est allée jusqu’à effacer […] l’histoire de la psychanalyse et qu’il nous a laissés à traiter, à faire avec, la contingence du réel, c’est-à-dire aussi avec l’invention et la réinvention sans aucun fatalisme » [6].
[*] À propos de « La nécessité du symptôme dans l’expérience analytique » (2020-2021), enseignement ouvert de l’ECF dispensé par Chantal Bonneau. Informations et inscriptions sur : events.causefreudienne.org
[1] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le partenaire-symptôme », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 10 décembre 1997, inédit.
[2] Lacan J., « Joyce le Symptôme », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 569.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 86.
[4] Cf. Lacan J., « Joyce le Symptôme », op. cit., p. 570.
[5] Miller J.-A., L’Os d’une cure, Paris, Navarin, 2018, p. 72.
[6] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Tout le monde est fou », enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université Paris 8, cours du 30 janvier 2008, inédit.