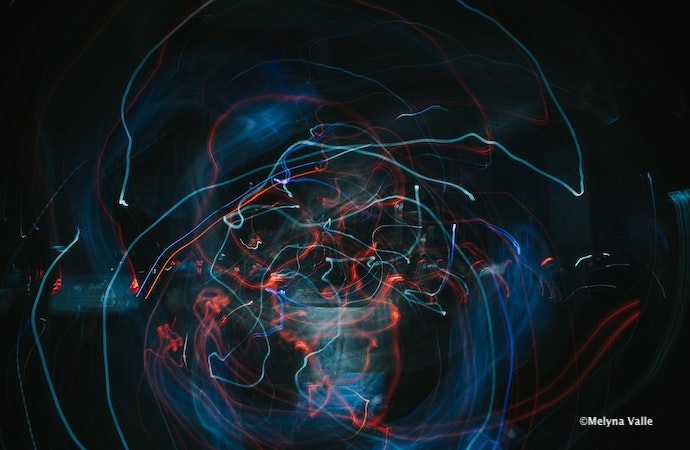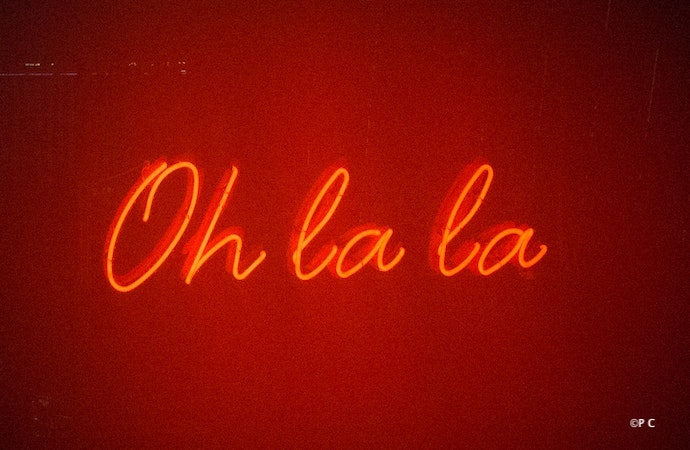Nous avons emprunté [*] le chemin du trauma au symptôme partant des Études sur l’hystérie de Freud et Breuer à l’appui des observations cliniques d’Anna O, Elizabeth von R., poursuivant par celle de Dora et l’analyse de ce cas freudien que fait Lacan au fil de son Séminaire. Déjà, lors de son « Intervention sur le transfert », puis dans les séminaires III, IV, V, VI, Lacan, loin de rabattre l’hystérique sur ses symptômes somatiques, a très tôt fait d’elle un sujet résistant au ravalement de la demande de l’Autre auquel elle oppose son désir singulier. À ce titre, le cas de Dora se révèle paradigmatique, car il montre comment un sujet aux prises avec la carence paternelle y supplée par un montage singulier susceptible de réintroduire la dimension du désir dans une situation pathogène. Lacan constate que certaines situations deviennent particulièrement hystérogènes lorsque le sujet, qui est dans une position soignante à l’égard du soigné auquel il est attaché par des « liens de l’affection, voire de la passion, […] se trouve […] en posture d’avoir à satisfaire, plus qu’en aucune autre occasion, […] la demande » [1]. L’entière soumission, l’abnégation du sujet à la demande, serait une des conditions essentielles au déclenchement des symptômes hystériques. Il en va de la sorte pour Dora qui, arrivée à un moment crucial de sa vie, au seuil de la sortie de l’adolescence, s’occupant de son père malade et impuissant ne recevra pas de celui-ci la promesse phallique nécessaire à son engagement dans une vie de femme. Lacan, dans son Séminaire IV, La Relation d’objet, remarque que la carence phallique traverse toute l’observation freudienne du cas. Le père de Dora n’est pas en mesure de faire le don symbolique du phallus, parce qu’il en est dépossédé, il est « en bout de course », atteint dans sa puissance vitale. Pourtant, Dora demeure très attachée à ce père impuissant – paradoxe que Lacan relève afin de faire valoir par quel aménagement symptomatique elle supporte cette situation. Elle y supplée en installant un quadrilatère, un « menuet de quatre personnages » [2], fragile équilibre grâce auquel elle réintroduit la dimension du désir, absente de sa vie.
Que le don phallique ne s’effectue pas réellement par le père, c’est une chose qui ressort d’une impossibilité structurale, à moins de franchir, pour le pire, la barrière de l’interdit de l’inceste. Par contre, que la promesse phallique n’ait pas lieu, que le père ne puisse achever ce processus du don phallique attendu, c’en est une autre qui, elle, ressortit d’une forme de carence paternelle. Au moment de la nouvelle maturité génitale de Dora, son père n’a pas pu incarner ce lieu de la promesse phallique, qui promeut la dimension du désir et ouvre vers l’avenir, tandis qu’elle s’identifie à celui-ci par la conversion somatique. Toutefois, Dora remédie à cette insuffisance en s’introduisant dans la relation du père avec Mme K grâce à laquelle elle aura accès, par procuration, à la dimension phallique – l’Autre femme réalisant l’au-delà de ce qui est aimé dans un être, à savoir ce qui lui manque, le phallus, signifiant du désir. Mme K représente à la fois le mystère, la question, l’énigme du féminin, ce qui manque à l’être désigné ici par le phallus ainsi que l’objet convoité du désir de Dora et ce, à partir de son identification virile à Mr K, qui, lui, est en posture de satisfaire le désir.
Lors de son cinquième séminaire, Lacan s’intéresse à nouveau à Dora à la lumière de la dialectique de la demande et du désir et place les moments clefs du complexe d’Œdipe sur son graphe du désir. Certains cas d’hystérie lui permettront de lire l’impasse du ravalement à la demande et de montrer la manière dont ces sujets se dégagent de cette impasse en instaurant la dimension du désir en tant qu’insatisfait, dimension au-delà de la satisfaction de la demande.
Ainsi en va-t-il de la belle bouchère et tout autant de Dora qui, par son refus de corps, renonce aux plaisirs immédiats de la chair afin de maintenir une situation de désir insatisfait, un peu à l’instar d’une princesse de Clèves.
Lacan pose la question : « Pourquoi faut-il un au-delà de la demande ? » [3] Parce qu’il s’agit, dit-il, que l’Autre primordial auquel s’adresse la demande « perde de sa prévalence » et que ce qui reste du besoin, comme résidu, comme poussée, après être passé par les défilés des signifiants de la demande, et en tant qu’il était parti du sujet, reprenne la première place en tant que désir du sujet [4]. L’Autre n’a pas ici à répondre oui ou non, le désir abolit la dimension de la permission de l’Autre et prend forme de condition absolue par rapport à l’Autre.
En conséquence, le désir de désir insatisfait représente le désir dans sa forme la plus pure en tant que résistance salvatrice contre le ravalement de la demande à l’objet de satisfaction. Je te demande de refuser ce que je te demande parce que ce n’est pas ça que je désire !
Ce désir de désir relève d’une nécessité que Lacan situe précisément en un point particulier quant au rapport à l’Autre lorsqu’il repère la difficulté pour une hystérique de garder sa place de sujet [5]. Freud a très tôt constaté l’ouverture de l’hystérique à la suggestion de la parole et c’est pourquoi il est nécessaire au sujet de se créer un désir insatisfait, condition pour ne pas être entièrement pris à la satisfaction réciproque de la demande, à la capture entière du sujet par la parole de l’Autre.
Jacques-Alain Miller, dans …du nouveau !, énonçait que le sujet hystérique s’étiole comme une fleur privée d’eau s’il n’y a pas le désir de l’Autre pour le réveiller, lui donner ses couleurs. Ce qui le conduit à tout faire pour réveiller le désir de l’Autre [6].
[*] À propos de « Les partenaires de l’hystérique » (2020-2021), enseignement ouvert de l’ECF dispensé par Patricia Bosquin-Caroz. Informations et inscriptions sur : events.causefreudienne.org
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre V, Les Formations de l’inconscient, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1998, p. 325.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981, p. 105.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre V, Les Formations de l’inconscient, op. cit., p. 381.
[4] Ibid., p. 382.
[5] Cf. ibid., p. 364.
[6] Cf. Miller J.-A., …du nouveau !, Paris, Rue Huysmans, 2000, p. 80.