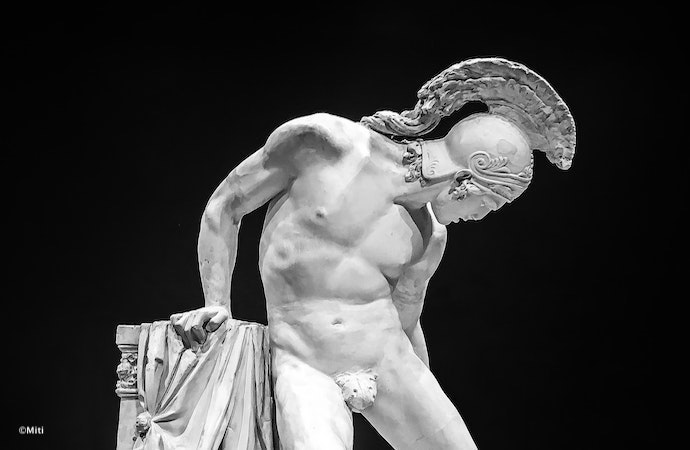À la question de ce qui distinguerait la position d’un homme de celle du machiste, m’est revenu en mémoire ce que disait Jacques-Alain Miller dans un entretien sur la question de l’amour paru dans Psychologies Magazine : « On n’aime vraiment qu’à partir d’une position féminine. Aimer féminise. C’est pourquoi l’amour est toujours un peu comique chez un homme. Mais s’il se laisse intimider par le ridicule, c’est qu’en réalité, il n’est pas assuré de sa virilité. » [1]
C’est à la reconnaissance de son manque, et de pouvoir le « donner à l’autre, le placer dans l’autre » [2], que se mesurerait donc la position d’un homme. Le macho serait, au contraire, celui qui, dans son repli narcissique, se montrerait impuissant à aimer, faisant signe d’une virilité non assurée.
Dans cet entretien, J.-A. Miller évoquait la figure du « serial lover » qui sait « sur quels boutons appuyer pour se faire aimer » [3], mais le serial lover, lui, n’avoue pas son manque. Le macho reste rivé à l’idéal de virilité d’une position phallique. Il ne connaît de l’amour « ni le risque, ni les délices » [4]. Autrement dit, le macho méconnaît le passage de sa jouissance au désir par la médiation de l’amour, comme suppléance au rapport sexuel qu’il n’y a pas, et il se met à l’abri du réel de la contingence comme modalité de la rencontre amoureuse où rien n’est écrit d’avance.
Une autre figure du macho a émergé aujourd’hui outre-Atlantique, autrement plus agressive et inquiétante, celle que J.-A. Miller présente dans son texte « Docile au trans » : ce sont « des militants mâles, défenseurs d’une virilité menacée, croient-ils, par les progrès du féminisme. Ils sont regroupés dans le mouvement masculiniste MGTOW, pour Men Going Their Own Way – à peu près : “Des hommes qui suivent leur propre chemin.” […] MGTOW, c’est en quelque sorte le Tao des machos » [5].
L’enseignement de Lacan sur le phallus nous éclaire sur ce mouvement masculiniste qui revendique au grand jour sa haine à l’endroit des femmes. Si, en 1958, Lacan mettait en valeur le versant signifiant du phallus comme vecteur du lien entre les hommes et les femmes autour de ce capitonnage du sens qui le fait sexuel, à partir des années 1970 et la considération du réel de la différence des sexes, le phallus est référé à sa fonction de jouissance, sur le versant de l’Un-tout-seul, qui annule sa fonction de lien social. Le porteur de l’organe mâle se voit alors aphligé de sa jouissance solitaire, autistique, fermé à la sexualité féminine et son altérité radicale, comme l’élabore Lacan dans le Séminaire Encore.
Mais le Tao des machos est-il réservé aux MGTOW ? J.-A. Miller voit poindre dans Le Génie lesbien [6] d’Alice Coffin sa déclinaison genrée « FGTOW » et son évangile pareil au même : « Tu aimeras le même comme toi-même », annonçant une guerre des sexes particulièrement cinglante, une guerre « à balles réelles » qui reflète « la montée irrésistible, dans l’époque, du désir de ségrégation » [7].
Dans son « Introduction de Scilicet », en 1968, Lacan évoquait « le trait sauvage des expédients » dont se parerait le réel de la différence des sexes, et la probabilité que « la sauvagerie s’en accroisse chaque jour à mesure du reniement de cette révélation » [8].
Autre serait le Tao des amants, éclairé par le réel du non-rapport « [d]’où notre dignité prend son relais, voire sa relève » [9]. À la fin de son entretien, J.-A. Miller situe l’amour comme ce « labyrinthe de malentendus dont la sortie n’existe pas » et qui conduit les amoureux « à apprendre indéfiniment la langue de l’autre » [10].
[*] Miller J.-A., « Docile aux trans », Lacan Quotidien, n°928, 25 avril 2021, publication en ligne.
[1] Miller J.-A., « On aime celui qui répond à notre question : “Qui suis-je ?” », entretien, Psychologies Magazine, n°278, octobre 2008, disponible sur internet.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Miller J.-A., « Docile aux trans », op. cit.
[6] Coffin A., Le Génie lesbien, Paris, Grasset, 2020.
[7] Miller J.-A., « Docile aux trans », op. cit.
[8] Lacan J., « Introduction de Scilicet au titre de la revue de l’École freudienne de Paris », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 283 & 284.
[9] Lacan J., « Télévision », Autres écrits, op. cit., p. 514.
[10] Miller J.-A., « On aime celui qui répond à notre question : “Qui suis-je ?” », op. cit.