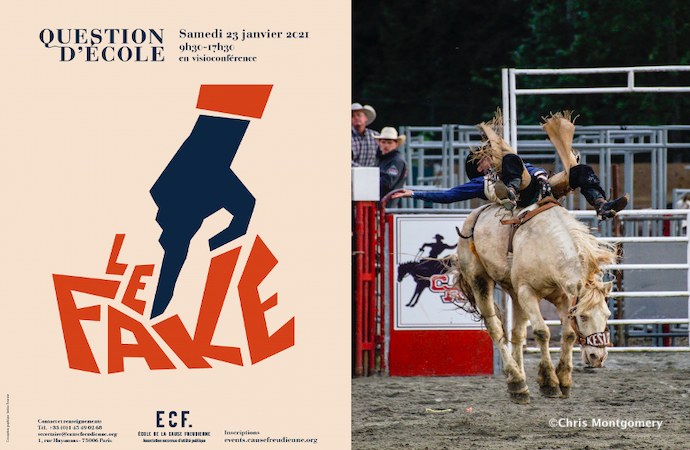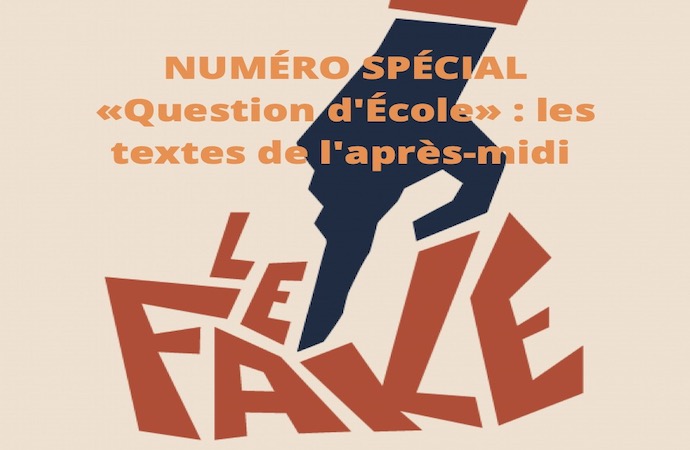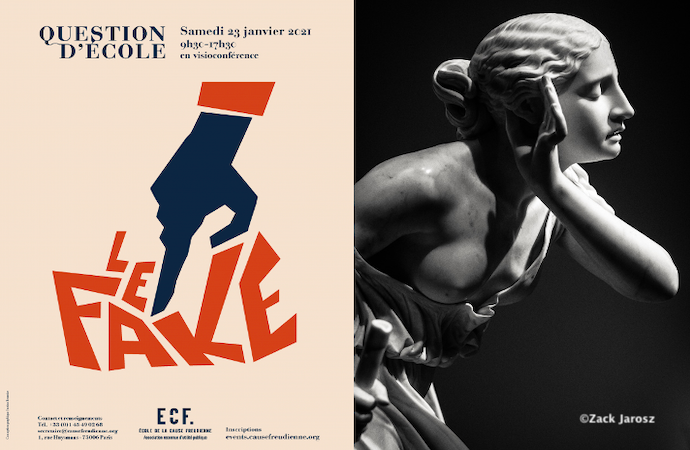Lacan a pu dire qu’il n’était pas anarchiste, car il n’aimait pas assez l’ordre [*]. Je calquerai sur cette formulation deux autres : « je ne suis pas menteur, car je n’aime pas assez la vérité ». D’où se déduit : « je suis menteur, car j’aime trop la vérité ». Les deux valent pour Donald Trump.
Nous avons assisté à « la fin du plus grand premier mandat présidentiel de l’histoire », dont l’acteur est resté « en total désaccord avec le résultat de l’élection », soit à l’apparente vérité, binaire, simpliste, de Trump : il est le plus grand et les opposants mentent. Son univers puéril oppose cow-boys et Indiens, honnêtes et malhonnêtes, loyaux et déloyaux, beaux et moches, ainsi que winners et losers. Son refus d’admettre la défaite, aux airs de mensonge, révèle sa vérité : il ne peut être un loser. Son usage de la vérité s’est forgé pour en masquer une autre, celle de l’interdiction de perdre, construite face à un père dur et indifférent, excepté devant les killers.
Ce que Trump, hors norme mais bien conforme à un penchant contemporain, a induit, ou plutôt renforcé à l’excès, dans la subjectivité de notre époque, c’est l’autorisation sans limite à discréditer la parole de l’autre, à dégrader le langage, à rompre avec les semblants sociaux, sous les traits d’une exigence de vérité. Le lendemain de son appel désastreux, on l’a dit « inconséquent ». Mais il a été tout à fait conséquent au sens ici de la logique des conséquences de ce qu’est sa vérité, de son trop grand amour de sa propre vérité, voire de son propre mensonge. Son sens de l’éthique bien écorné n’entame pas sa logique qui fait qu’il dit le vrai, le sien, et, qu’en conséquence, ses actes en répondent.
Il dit ce qu’il pense et ça plaît. « T’es pas loyal, t’es viré (fired) ! » « T’es injuste (not fair), t’es mort ! » « Tu t’opposes, t’es un escroc (crooked, qualificatif toujours accolé au prénom ou au nom d’Hilary Clinton) », etc. Subjectivité sans filtre, a contrario de ce que Lacan énonçait lorsqu’il développait la notion de représentant : « Quand les diplomates dialoguent, ils sont censés représenter quelque chose dont la signification, d’ailleurs mouvante, est, au-delà de leur personne, la France, l’Angleterre, etc. […] chacun doit n’enregistrer que ce que l’autre transmet dans sa pure fonction de signifiant, il n’a pas à tenir compte de ce que l’autre est, comme présence, comme homme, plus ou moins sympathique » [1].
Une interprète de presse a décrit la façon dont Trump a cassé les codes du langage politique, effaçant la complexité géopolitique par une « médiocrité stylistique » [2]. Il peut surprendre et pense amuser, mais ses tweets sont loin du mot d’esprit ou des textes en trois lignes de Félix Fénéon, commentés par Lacan, dans lesquels le sens n’est pas centré, avec un détachement par rapport à l’énoncé [3]. Chez Trump, sous son vocable, une seule signification, sans surprise, et aucun détachement.
Il en est qui le disent authentique, car direct. Mais quelle figure d’autorité est-il, ce président qui trouva un mentor en Roy Cohn, procureur implacable des Rosenberg ; ce président qui déclare que Kim Jong-Un et lui sont tombés amoureux l’un de l’autre ; ce président qui dit qu’Al Sissi a de super chaussures lors d’un échange officiel ! À partir de la notion d’autorité authentique, qui fut avancée par Jacques-Alain Miller à propos de l’analyste, je reprends ce qu’il énonce de l’autorité inauthentique qui ne dit jamais « J’ai oublié, Je ne l’ai pas fait, etc. », car infaillible et non responsable. Si la tromperie est un ressort ancestral de la politique, chez Trump c’est une autorité qui admet le pire, qui est toujours en guerre, c’est un rapport jaculatoire immédiat aux mots et aux choses, qui est loin de l’art de simuler et de dissimuler du Prince de Machiavel.
Trump attribue le mensonge à l’autre, insulte, menace, s’auto-promeut. Quelle est donc sa vérité ? C’est un petit garçon qui s’est construit dans l’intimidation. Son livre the The Art of Deal (1987) l’illustre [4]. Il y étale son art d’intimider pour étendre son empire. Et, sous forme de dénégation, déclare n’avoir jamais été intimidé par son père. Il y présente son maniement de l’hyperbole véridique, truthfull hyperbole, ou vérité exagérée, selon les traducteurs. Vérité étirable, malléable, selon les commentateurs. « Je joue avec les fantasmes des gens. […] Voilà pourquoi un peu d’exagération ne nuit pas. Les gens aiment croire que quelque chose est ce qu’il y a de plus grand et de plus spectaculaire. J’appelle cela la vérité exagérée. C’est une forme innocente d’exagération et une forme efficace de promotion » [5].
Aucune innocence chez cet homme qui, « bousillé » par son père [6], a décidé, enfant, de suivre les préceptes paternels, inspirés de la pensée positive, et d’être supérieur au père. Son frère aîné l’appelait The Great I Am, en référence à l’Exode quand le Christ rencontre Moïse. Son usage des superlatifs reflète sa grandeur, et son envers : les fantastique, magnifique, énorme, incroyable côtoient les incompétent, escroc, menteur, faible, monstrueux, répugnant (ceci pour les femmes), etc.
Sa nièce, Mary L. Trump, psychologue, vient de livrer un portrait de son oncle, bien moins élaboré que celui du président Wilson, si antipathique à Freud, où certains ressorts surmoïques sont communs aux deux. Elle ne voit pas même où le DSM pourrait ranger le cas Donald. Elle évoque le mensonge comme mode de survie de la fratrie Trump et écrit : « La monstruosité de Donald est la manifestation même de la faiblesse profonde qu’il a cherché à fuir toute sa vie. Pour lui, il n’y a jamais eu d’autre option que de se montrer résolument positif […] car tout autre attitude est synonyme de condamnation à mort […]. Le pays entier souffre à présent de la même positivité toxique dont mon grand-père a fait usage […] pour endommager de façon irrémédiable la psyché de son enfant préféré, Donald » [7].
Trump est mu par sa vérité qui l’a construit dans l’outrance, et la vérité des faits, celle des autres, leur exactitude, y contreviennent. Est-il vraiment menteur ? Avoir ainsi instillé le signifiant fake pourrait le faire penser. Comme l’énonçait Pierre Dac, « Si tous ceux qui croient avoir raison n’avaient pas tort, la vérité ne serait pas loin » ! Ici la vérité, ou aussi bien le mensonge, est du côté de ce qui pourrait se nommer « l’outre-vérité », la vérité outrée, augmentée, de Trump.
[*] Texte prononcé lors de la journée « Question d’École. Le Fake », le 23 janvier 2021, en visioconférence.
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 201.
[2] Viennot B., La Langue de Trump, Paris, Les Arènes, 2019, p. 33.
[3] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre V, Les Formations de l’inconscient, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1998, p. 65-81.
[4] Trump D. & Schwartz T., The Art of the Deal, New York, Random House, 1987.
[5] Ibid., trad. Trump par Trump, Paris, L’Archipel, 2017, p. 60.
[6] Trump D., cité par N. Bacharan, in Le Monde selon Trump, Paris, Tallandier, 2019, p. 28.
[7] Trump M., Trop et jamais assez. Comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde, Paris, Albin Michel, 2020, p. 328.