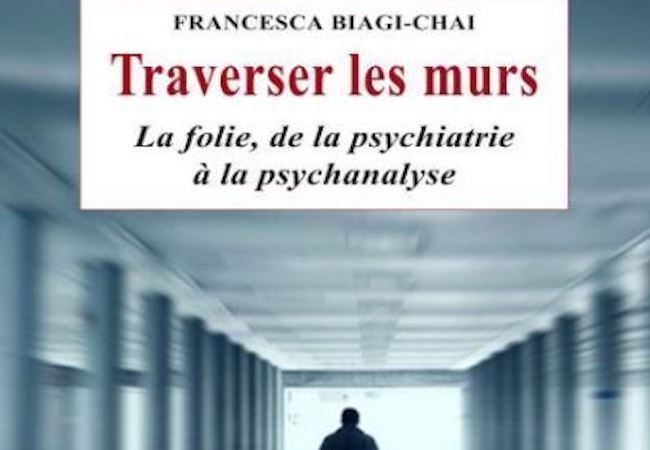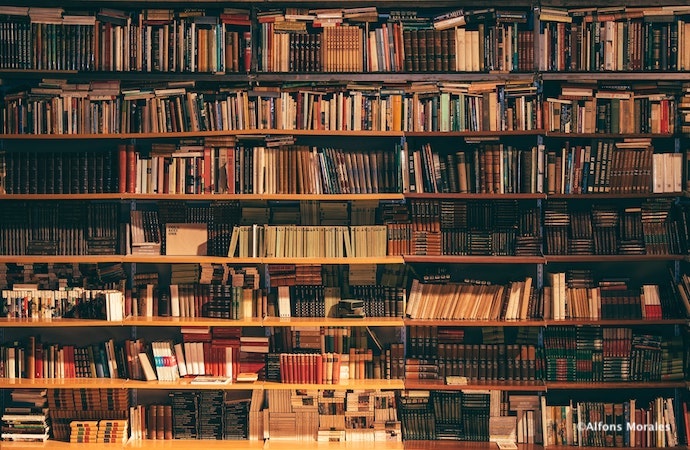Céline Aulit & Agnès Vigué-Camus — Votre livre pose la question globale du rapport entre la psychanalyse et l’institution psychiatrique qui s’est déplacé depuis les années 1970 [*]. De ce point de vue, il nous semble que deux fils peuvent être suivis dans sa lecture.
Le premier concerne la psychiatrie comme discipline. Ainsi, vous écrivez : « L’avenir de la psychiatrie sera psychanalytique ou ne sera pas » [1]. C’est une proposition très forte, radicale. Est-ce que cela voudrait dire que la psychiatrie, en tant que discipline, pourrait disparaître, dissoute dans les neurosciences, car la clinique psychiatrique n’existerait plus ?
À cette clinique psychiatrique se substitue une politique édictée par les agences de santé qui recommandent, par exemple, « aux soignants de permettre au patient de mieux comprendre sa maladie » [2]. Ceux qui prônent l’application de ces bonnes pratiques, signalez-vous, « ne savent aucunement de quoi ils parlent ». Ils ignorent que « ne rien vouloir savoir du réel, n’empêche pas qu’il fasse retour » [3].
Le second fil, qui court tout au long de votre ouvrage, traite de l’institution psychiatrique dans laquelle se loge la psychanalyse, dont la dimension subversive a pour effet, comme vous le dites, de « tordre l’institution » [4]. Comment les choses se sont-elles jouées au fur et à mesure des années et qu’y a-t-il de nouveau aujourd’hui ? Pour répondre au mouvement en vogue de désinstitutionalisation et de crainte de la chronicité, vous avez, entre autres, cette formule percutante : « le patient qui s’installe ne démontre rien d’autre qu’un laisser tomber des soignants » [5].
Ce passage est très enseignant. Il met en exergue l’hôpital comme lieu où peut s’installer le transfert, et par là, la trame d’un discours qui soutient le sujet et lui permet une séparation qui ne soit pas un laisser -tomber heurt. Finalement on veut faire l’impasse sur ce temps constitutif alors même que le sujet en a déjà été privé une fois. Ne pourrait-on pas dire que « le laisser tomber des soignants » [6] est précisément cette absence de « concernement » [7], comme le reprend Lacan dans son petit discours aux psychiatres ?
Pourriez-vous déplier ces différents points et nous dire si une clinique du réel, que vous épinglez comme un avenir possible, a des chances de se faufiler dans les institutions à l’heure actuelle, alors même que la psychanalyse n’occupe plus la place qu’elle a pu avoir ?
Francesca Biagi-Chai — Vous posez la question de la disparition de la psychiatrie comme discipline. Elle se pose comme conséquence du discours du capitalisme et de « sa curieuse copulation avec la science » [8]. Le réel des neurosciences est, comme celui de la science qui l’englobe, manipulable de l’extérieur [9]. Dans le domaine de la psychiatrie, il est fabriqué à mesure de ce qui se présente comme phénomènes : les comportements sont liés au système limbique ou bien sont dépendants des hormones, du cerveau bio-neuro-génético-hormono-fonctionnel. Ce réel de la science n’est pas un classement, comme peut l’être le DSM, il est un savoir construit, non sans rapport avec le fantasme qui guide la recherche du scientifique. Ainsi, un ouvrage récent passe en revue les évènements socio-historiques à la lumière de la crise d’épilepsie [10]. C’est un réel qui veut rendre compte de tout, tout traiter, tout savoir. Le discours du capitaliste ne veut rien savoir de la castration. Il peut tout fournir dans l’anticipation des désirs et dans l’évacuation du savoir du symptôme au profit du produit. L’alliance du capitalisme et de la science est parfaite, ensemble ils produisent du savoir dans le réel, un savoir donc qui n’en est plus un.
La psychanalyse partant du sujet, ou plus exactement du parlêtre, renverse cette conception autant chimérique que fascisante du réel pour reconnaitre le réel sans loi, comme le nom de l’impossible à partir de quoi quelque chose est possible. « Dans la psychanalyse il n’y a pas de savoir dans le réel. Le savoir est une élucubration [transférentielle] sur un réel » [11], indique Jacques-Alain Miller, ce qui renvoie chacun à la possibilité de traiter son réel, de le traiter par le savoir qui ne se sait pas encore. En théorie la psychiatrie pourrait disparaitre, on en voit l’amorce ; en réalité elle ne le peut pas parce que le réel, dans son statut de non-sens, insiste, et bien malin celui qui pourrait l’arrêter avec du savoir préfabriqué. De ce fait, si les politiques de santé mentale négligent cette dimension et la possibilité que la psychanalyse offre au patient d’identifier son réel, d’en connaitre la logique, d’en déjouer les conséquences, la société tout entière sera confrontée aux effets destructeurs qui ne cesseront de faire retour. Elle continuera de se poser des questions sur les meurtres « immotivés », les passages à l’acte, « les transgressions » chez des sujets si doux et gentils ou chez des citoyens au-dessus de tout soupçons.
La clinique orientée par la psychanalyse a-t-elle, dites-vous, des chances de se faufiler dans les institutions à l’heure actuelle alors que la psychanalyse n’y occupe plus la place qu’elle a eue. Non seulement elle a des chances de le faire, mais je dirais qu’elle y est déjà. Elle n’y est pas visible, mais elle y est efficace, conséquente et bien implantée. Efficace, j’entends par là dans la pratique, chez chaque soignant qui s’en soutient, mais aussi par la transmission aux équipes. Il est connu que les lacaniens travaillent beaucoup et travaillent bien, c’est ainsi que la psychanalyse s’y est maintenue et amplifiée, faisant passer dans les institutions l’éclairage sur le réel nécessaire à dépasser une situation en impasse. Et comment le font-ils ? Pas dans un face à face des opinions, mais du lieu du réel. Réel qu’ils ont découvert dans leur propre cure, au-delà du père, dans l’expérience de l’Autre barré. Ainsi, ils distillent, chacun à leur manière, ce qui peut éclairer, dans le champ de la clinique, le discours du maître. Le maître qui ne peut que vouloir que cela « fonctionne » et d’une certaine manière, il se moque des moyens. L’analyste, au contraire, y est nécessairement intéressé, car ce sont les moyens propres du sujet qu’il fait advenir. L’institution se tord quand l’invisible du travail des analystes passe au visible, une subversion a pu se produire. De plus, il y a des institutions dirigées par des psychanalystes d’orientation lacanienne.
Enfin, vous interrogez le « laisser-tomber » des soignants dans la constitution de cette forme d’apathie, de passivité que l’on appelle chronicité. La chronicité c’est un des noms du réel de la jouissance dans la psychose. S’en remettre à l’Autre pour retrouver la motivation du vivant ou s’appuyer sur l’autre, car le symbolique fait défaut, c’est ce que Lacan enseigne tout au long du Séminaire III. La jouissance du patient est une interrogation pour les soignants. De savoir ce point concernant la chronicité, entre autres, contribue à ce qu’ils se sentent « concernés » au sens d’un désir, puisque cela relève désormais de la clinique. Le transfert passe par ces élucidations et l’offre de transfert gagne quelle que soit l’institution. Dans la même veine le « laisser-tomber » s’éclaire comme celui de l’Autre, et non du soignant. Dès lors, dialogues et stratégies se succèdent, une perspective propre à la logique du sujet se dessine, un point de fuite dépassant les impasses imaginaires permet une sortie de l’institution, non du transfert, ou du discours.
[*] Le livre de F. Biagi-Chai, Traverser les murs. La folie, de la psychiatrie à la psychanalyse, Paris, Imago, 2020, est disponible à la vente en ligne sur le site de ECF-Echoppe. Et conversation croisée autour du thème « Contre l’universel, une clinique du réel », avec F. Biagi-Chai, P. La Sagna & R. Adam, le 11 février 2021, en visioconférence, inscriptions en ligne.
[1] Biagi-Chai F., Traverser les murs. La folie, de la psychiatrie à la psychanalyse, Paris, Imago, 2020, p. 27.
[2] Ibid., p. 26.
[3] Ibid., p. 27.
[4] Ibid., p. 123.
[5] Ibid., p. 172.
[6] Ibid.
[7] Lacan J., « Petit discours aux psychiatres de Sainte-Anne », 10 novembre 1967, inédit.
[8] Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 126.
[9] Cf. Cottet S., « En ligne avec Serge Cottet », entretien, La Cause du désir, n°84, mai 2013, p. 12.
[10] Cf. Naccache L., L’Homme réseau-nable. Du microcosme cérébral au macrocosme social, Paris, Odile Jacob, 2015.
[11] Miller J.-A., « Le réel au XXIe siècle. Présentation du thème du IXe Congrès de l’AMP », La Cause du désir, n°82, octobre 2012, p. 92.