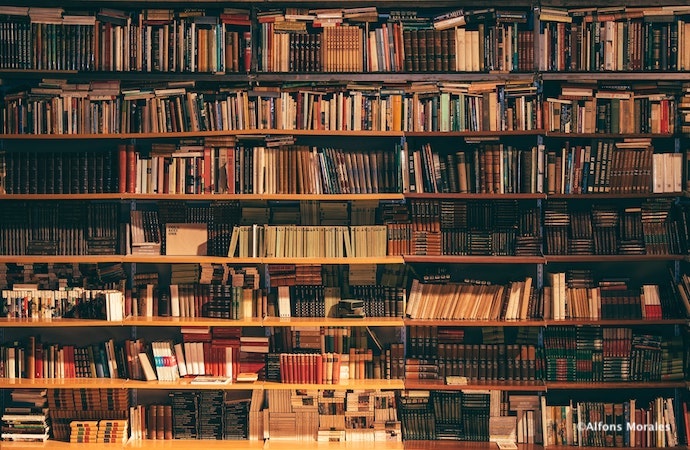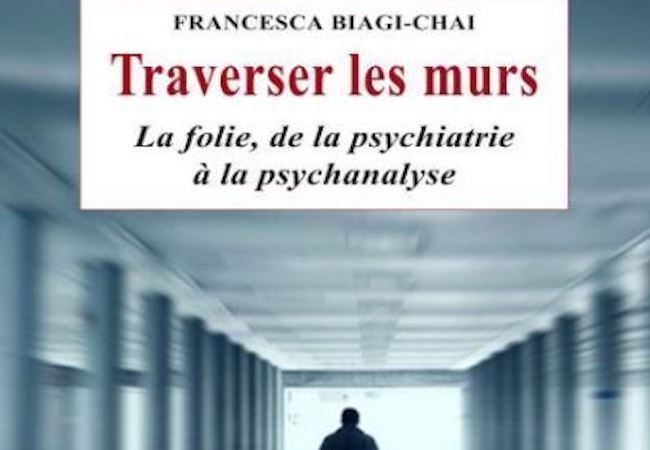Contrer l’universel [*][1] explore, ligne à ligne, les détours de « L’étourdit ». Lacan y déploie l’équivoque logique, et les conséquences que l’on peut en tirer sur la position du psychanalyste dans le lien social et la politique. De nombreux exemples d’équivoques logiques sont présents chez Lacan, mais pour m’en tenir à « L’étourdit », je relève cette phrase : « Ça ne sera pas un progrès, puisqu’il n’y en a pas qui ne fasse regret, regret d’une perte » [2].
Cette logique n’est pas progressiste, pas réactionnaire non plus, mais souligne avec une ironie topologique combien toute entreprise se fonde de l’exclusion d’un point de réel qui la travaille à la base, et qui fera les écueils et obstacles qu’elle rencontrera : ce qui surgit à la fin d’un discours est écrit dès le départ, sur le ticket d’entrée. Le point où ça se boucle est aussi le point où se rejoint quelque chose de l’impensé du départ, même si les deux points n’en sont topologiquement qu’un, d’où l’inaccessible du deux. Tout projet se fonde d’un certain rejet, du fait même que le sujet ne peut se fondre complètement dans la chaîne signifiante, d’où son rapport à l’impossible. Un « discours, quel qu’il soit, se fonde d’exclure ce que le langage y apporte d’impossible, à savoir le rapport sexuel » [3], indique Lacan dans « L’étourdit ». Nous pouvons, dans la même veine saisir ces autres affirmations qui illustrent l’équivoque logique, par exemple la fameuse phrase de Proudhon : la propriété, c’est le vol ; ou bien celle de Saint-Paul : c’est la loi qui fait le péché ; ou encore celle de Machiavel [4] : si vous voulez être assiégé, construisez une forteresse.
Cette logique serait un moteur très puissant dans la théorie lacanienne pour lire la clinique, mais n’est-ce pas aussi un formidable outil pour lire le temps contemporain, en soulignant dans chaque entreprise la part impossible qu’elle installe, tout rejet de l’impossible logique inclus dans le projet lui-même ? Ce qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire de projets, mais pas sans être averti de ces paradoxes. Cela rejoint ce que disait, avec ironie, Lacan à Vincennes à l’étudiant qui voulait faire sortir tout le monde de l’université : « C’est que tout est là, mon vieux. Pour arriver à ce qu’ils en sortent, vous y entrez » [5]. Cela peut s’appliquer aussi aux institutions, analytiques mais pas seulement, mis en forme dans ce qu’on a appelé « principe de Shirky » (d’après le journaliste américain Clay Shirky) selon lequel « les institutions ont tendance à perpétuer le problème dont elles sont la solution ».
La place de l’analyste dans la cité, au sens politique, s’en déduit : n’est-elle pas aussi celle d’interpréter la part de rejet inhérente à tout projet ? Soit toucher à la langue d’une époque en révélant l’équivoque logique produite par ses signifiants-maîtres ?
Il y a, à ce propos, une longue tradition de réflexion sur l’usage de l’équivoque en politique, en particulier la « doctrine de l’équivoque » chez les jésuites [6]. Elle promeut la pratique d’un judo salutaire contre l’univocité et le purisme visés par certaines politiques, ce que relevait aussi le poète Torquato Accetto, dans son traité De la dissimulation honnête : « l’homme, qui est un petit monde, dispose parfois hors de lui-même un certain espace qu’il faut appeler équivoque, non certes entendu comme simplement faux, afin d’y recevoir, pour ainsi dire, les flèches de la fortune et se préparer à la rencontre de qui vaut et veut plus dans le cours présent des intérêts humains » [7].
L’équivoque – dont Lacan nous livre une théorie et une orientation topologique pour l’interprétation dans « L’étourdit », dépliée dans l’ouvrage Contrer l’universel – est le lieu de la respiration humaine, à préserver par un maniement politique subtil de la logique qui peut servir de boussole pour se positionner, en ménageant la place de l’impossible-à-dire.
Cela peut porter à conséquences dans les politiques contemporaines, par exemple concernant la question brûlante de l’inclusion, signifiant-maître si présent à notre époque : pas d’inclusion qui ne se fonde de l’exclusion. En effet, inclure, scolairement par exemple, c’est inclure mais en tant que préalablement exclu, ce qui signe l’exclusion et la désigne, et donc ne va pas sans des effets paradoxaux très tangibles dans les cours de récréation – ceux qu’on voulait inclure se retrouvant stigmatisés, en butte à une nouvelle exclusion interne. Cela donne du fil à retordre aux politiques de discrimination, positive aussi bien, car discriminer, même positivement, c’est quand même discriminer, et donc perpétuer ce contre quoi on se dresse. De ce point de vue, anti- et pro-, même combat ! C’est au fond la logique de l’universel, que Lacan situe côté homme de la sexuation, logique de clôture des ensembles fermés et de leur exclusion corrélative.
Le maître vise à clore – le sujet comme les corps – ce qui ouvre sur l’Empire, l’Un-pire disait Lacan dans « L’étourdit ». Inclusion et exclusion ont une même racine commune, le claudere latin, qui donne clore : inclusion comme exclusion restent tous deux captifs d’une épistémologie de la clôture, de l’ensemble fermé. Ce qui s’en sépare par le biais de l’équivoque, pas contre mais à côté, ouvre plutôt sur ce qui est du registre de l’é-clore : à savoir l’ouverture corrélative de la rupture de la clôture, orientée sur le pas-tout. Une autre voie se déchiffre pour notre temps, pas à pas, dans Contrer l’universel et « L’étourdit ».
[*] Le livre de P. La Sagna & R. Adam, Contrer l’universel. « L’étourdit » de Lacan à la lettre, Paris, Michèle, 2020, est disponible à la vente en ligne sur le site de ECF-Echoppe. Et conversation croisée autour du thème « Contre l’universel, une clinique du réel », avec F. Biagi-Chai, P. La Sagna & R. Adam, le 11 février 2021, en visioconférence, inscriptions en ligne.
[1] La Sagna P. & Adam R., Contrer l’universel. « L’étourdit » de Lacan à la lettre, Paris, Michèle, 2020.
[2] Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 494.
[3] Ibid., p. 487.
[4] Machiavel N., « Discours sur la première décade de Tite-live », Le Prince et autres œuvres, Paris, Robert Laffont, 2018.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre XVII, L’Envers de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1991, p. 236.
[6] Cavaillé J.-P., « Histoires d’équivoques », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques n°33, avril 2004.
[7] Accetto T., Della Dissimulazione onesta, Naples, 1641, chap. III.