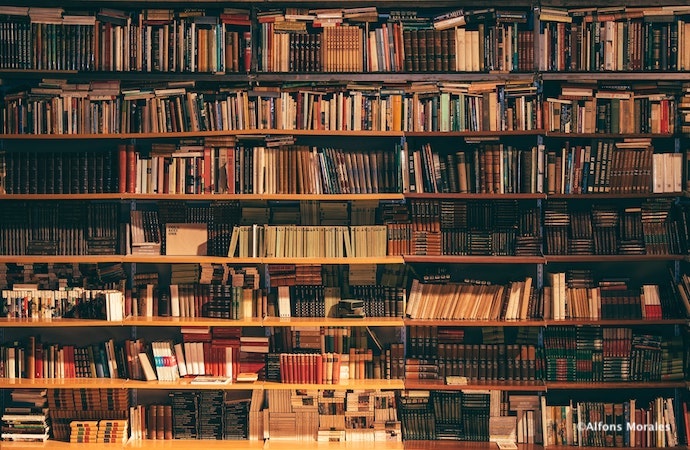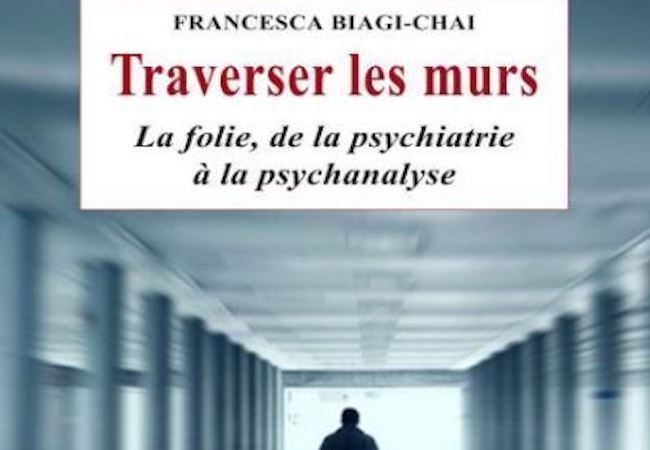Dans ce recueil d’entretiens, Francesca Biagi-Chai affirme que, dans le malaise de la civilisation actuel, « notre époque méconnait et veut méconnaître la folie », faisant des hommes des êtres de « pure volonté », « hors lien », « des êtres qui ne seraient pas sujets dans la parole qu’ils habitent » [*][1]. Pourtant, il y a nécessairement « un effet d’échappement », dans l’art, dans le symptôme, dans la folie, dans le crime, « soit dans ce qui fera obstacle à la pureté d’un marché », il « y aura toujours, parmi ces échappements, des patients, pour lesquels un lieu est nécessaire pour faire lien » [2].
Ce lieu peut être l’analyste avec lequel s’établit un lien. L’articulation signifiante est un mode de lien, mais pour certains en grande difficulté il faut un lieu d’accueil matériel qui puisse incarner cet espace et cette permanence.
F. Biagi-Chai a pensé et conçu un dispositif de soin de cet ordre dans lequel psychiatrie et psychanalyse ne s’excluent pas, mais s’enrichissent l’une l’autre.
Dans Traverser les murs, elle évoque son expérience de la psychiatrie et de la psychanalyse et la création d’un lieu de soin à l’intérieur d’un EPS [3] pour une hospitalisation de jour, car « il était souhaitable que l’extérieur, auquel les patients auraient à se confronter, vienne à l’intérieur… à leur rencontre » [4]. Un lieu fluide et souple dans ses modes de prise en charge.
F. Biagi-Chai montre la valeur de ce modèle remarquablement opérant, malgré un usage des murs qui auraient pu paraitre obsolètes aux vues des nouvelles directives concernant la psychiatrie et l’évolution de la politique de secteur. Selon la psychanalyste, ce type de lieu reste essentiel pour le traitement des patients dits psychotiques, car il forme une sorte de sas permettant une réponse singularisée, orientée par la psychanalyse lacanienne. Ainsi, l’hôpital psychiatrique peut « maintenir le changement de paradigme […] uniquement si l’on opère un retournement complet de la conception du dehors et du dedans. L’hospitalisation temps plein viendrait prendre sa place au sein d’un réseau ouvert d’hospitalisation de jour. Ce qui fait l’hospitalisation de jour, ce n’est pas le lieu, mais le discours qui s’y tient » [5].
Le passage d’un lieu à un autre est envisagé comme trajet sur la bande de Moebius « qu’assure la continuité du transfert » [6], la garantie d’un lien « à vie », au sens de la garantie d’un recours, d’une défense contre la rupture. Le dispositif doit permettre de faire jouer la problématique aliénation–séparation.
F. Biagi-Chai s’attache à démontrer en quoi l’homme libre, soit le fou selon Lacan, est un désaliéné et qu’il y a à l’aliéner « de la bonne manière » en faisant lien avec lui, lien pas sans un lieu qui prenne la place du lien quand celui-ci ne peut plus tenir.
L’accueil va, au minimum, vers la réduction des effets de laisser-tomber comme les conduites pseudo-psychopathiques. Ainsi, le « traitement possible de la psychose dans l’institution, à partir du transfert, permet l’amorce d’une spirale ascendante par laquelle le sujet pourra sortir d’un présent qui se fige et tend à s’éterniser » [7]. L’auteure propose d’y associer divers lieux, composés à la fois de soignants formés à la psychiatrie, à la psychanalyse ainsi que des éléments associés au champ culturel, etc. « véritables pépinières à sublimation côté patients, véritables pépinières à savoir […] côté participants », le tout orienté par les enseignements de Lacan et de Jacques-Alain Miller.
« La psychanalyse […] est éminemment indiquée dans les cas de psychose », précise F. Biagi-Chai, ainsi que dans les expertises. La psychanalyse « induit le remaniement des institutions […] en les incluant pleinement dans la dimension antiségrégative qui la caractérise » [8] et elle permet qu’une circulation « se substitue à l’errance » [9] et à l’isolement. « C’est le lieu où le sujet peut refaire, à travers l’expérience de soin qu’il y rencontre, un lien social » [10].
« La soumission au maître moderne entraîne la psychiatrie sur la pente de la simplification » [11].
Ce livre répond à une urgence face à la forme cynique du malaise actuel de la civilisation. Il nous livre une grande expérience clinique, une somme d’une très grande clarté.
Le travail de F. Biagi-Chai nous éclaire sur la casuistique des passages à l’acte, leur singularité, la façon dont ils ont pu être traités et sur la clinique de l’acte du psychanalyste ou de l’intervention.
[*] Le livre de F. Biagi-Chai, Traverser les murs. La folie, de la psychiatrie à la psychanalyse, Paris, Imago, 2020, est disponible à la vente en ligne sur le site de ECF-Echoppe. Et conversation croisée autour du thème « Contre l’universel, une clinique du réel », avec F. Biagi-Chai, P. La Sagna & R. Adam, le 11 février 2021, en visioconférence, inscriptions en ligne.
[1] Biagi-Chai F., Traverser les murs. La folie, de la psychiatrie à la psychanalyse, Paris, Imago, 2020, p. 233.
[2] Ibid.
[3] EPS : établissement public de santé.
[4] Biagi-Chai F., Traverser les murs, op. cit., p. 233.
[5] Ibid., p. 234.
[6] Ibid., p. 234-235.
[7] Ibid.
[8] Ibid., p. 236.
[9] Ibid.
[10] Ibid., p. 237.
[11] Ibid., p. 236.