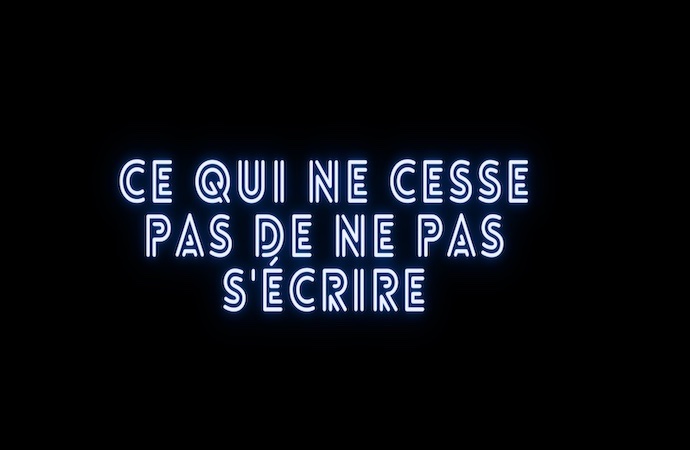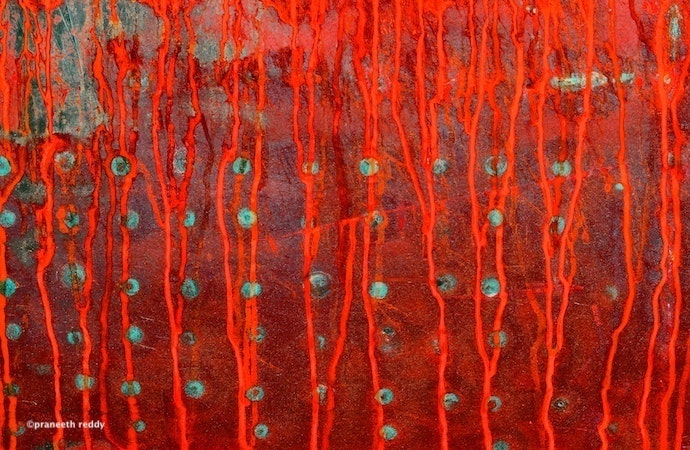L’impossible, qui répond au ne cesse pas de ne pas s’écrire, peut laisser le clinicien interdit mais devient un point d’appui inouï lorsqu’il trouve à s’éclairer dans la pratique analytique par l’impuissance.
Héritière de l’ombilic cher à Freud, cette catégorie intéresse Lacan dès le début de son enseignement et transforme la conception du monde de celui qui se laisse subvertir par elle. À la prendre tout à fait au sérieux, elle nous permet de critiquer l’assertion butlerienne selon laquelle la psychanalyse serait marquée par une « fascination pour l’échec », comme nous le rappelle Éric Marty dans son dernier ouvrage [1] en évoquant cette praxis forgée sur le sol de la vieille Europe dans les soubresauts de la French theory. Faire cette référence à l’échec, n’est-ce pas céder encore à l’impuissance, au mirage de l’écriture d’un rapport possible entre les parlêtres, et passer sous silence ce que Lacan a élaboré ?
En forgeant conjointement la catégorie logique de l’impossible et le registre du réel, Lacan livre des balises décisives pour l’orientation de la cure. L’impossible découle ici d’une lecture de la logique modale fondée par Aristote, à ceci près que Lacan n’oppose pas au nécessaire – qui a la charge de l’axiome psychanalytique par excellence, soit le fait qu’il ne peut n’y avoir une seule jouissance susceptible de permettre l’écriture d’un rapport – la modalité du contingent, comme le propose Aristote, mais l’impossible. À la nécessité du « pas que une » jouissance, s’ajoute une autre, impossible en tant qu’elle est ou serait celle « qu’il ne faut pas » [2].
Dès « La direction de la cure » [3], cette perspective se dévoile sous les traits de l’impossibilité pour le désir à être traduit, saisi par la parole, celle-ci étant articulée par la demande. Rejeté des rets du symbolique, l’impossible est sans cesse masqué, repoussé par l’imaginaire qui tente inlassablement de le méconnaître, que ce soit sous l’espèce du fantasme ou du symptôme qui soutiennent un rapport à la jouissance. Un « je ne peux pas » inhérent à la demande d’analyse résonne particulièrement aux oreilles du clinicien, quand il est prononcé par un sujet assujetti à une répétition qu’il voudrait rectifier.
Et la place de l’analyste ? Si Lacan a pu dire, avec une pointe de provocation, que la résistance dans la cure incombe à l’analyste, comment celui-ci peut-il faire jouer ce qui « ne cesse pas », cette « jouissance qu’il ne faudrait pas » dans l’interprétation ? Comment l’interprétation vient-elle faire signe pour le sujet à l’autre chose comme telle et non plus à une impuissance qui appelle une solution identificatoire ou une prescription morale ?
On a l’idée que « taire l’amour » n’y suffit pas. Lacan l’écrit précisément : « Il s’agit dans la psychanalyse d’élever l’impuissance (celle qui rend raison du fantasme) à l’impossibilité logique (celle qui incarne le réel). » [4] On décèle ici le tremblement de l’acte qui, dans la coupure, suspend la recherche de sens de la chaîne tout en en conservant l’élan métonymique lesté par le désir.
Transformer par l’acte l’impuissance en impossible fait quitter la terre de l’espoir et permet de rencontrer, non pas l’ironie, mais le nouveau, le « nul autre pareil ». La rencontre de l’impossible dans la cure, à laquelle l’analyste donne son écho, préfigure en effet la différence absolue qui barre toutes possibilités d’identification « copie conforme » à l’autre. C’est ce point que les Analystes de l’École démontrent un par un, en tant que la bribe de lalangue, sur laquelle une conclusion est devenue possible, fait la différence absolue – l’« OMO » de Marie-Hélène Blancard [5], pris à la lettre, n’a fait signifiant identificatoire pour aucun. Certes, les analystes demeurent des parlêtres et des modes de passe vont et viennent mais la tension vers cette différence ultime, point d’extimité, reste au cœur de l’expérience. Cette exigence tient à ce point de structure que consacre l’impossible, répondant au manque réel, soit que « le vivant, d’être sujet au sexe, est tombé sous le coup de la mort individuelle » [6].
[1] Marty É., Le Sexe des Modernes. Pensée du Neutre et théorie du genre, Paris, Seuil, 2021, p. 284 ; et Marty É., « Gender Studies : la première grande enquête philosophique sur l’origine des études de genre et leur conséquence aujourd’hui », entretien avec M. Weitzmann, France Culture. Signes des temps, 4 avril 2021, podcast disponible sur internet.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 55.
[3] Lacan J., « La direction de la cure et les principes de son pouvoir », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 585-645.
[4] Lacan J., « Compte rendu du Séminaire XIX », Le Séminaire, livre XIX, …ou pire, Paris, Seuil, 2011, p. 243.
[5] Blancard M.-H., « Prendre la jouissance à la lettre », La Cause du désir, n°83, décembre 2012, p. 69, disponible sur le site de Cairn.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 186.