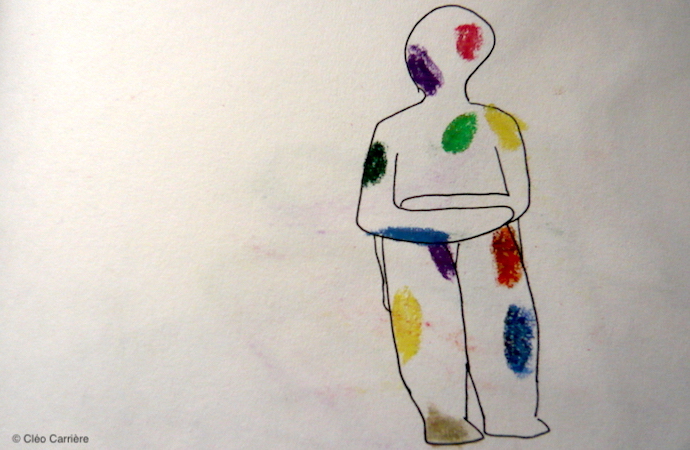Qu’est-ce qui peut pousser un sujet à s’assujettir à une logique amoureuse qui s’apparente à la pulsion de mort ? Simone de Beauvoir fait un constat que Lacan n’aurait pas démenti. « Le mot “amour” n’a pas du tout le même sens pour l’un et l’autre sexe et c’est là une source de graves malentendus qui les séparent. » [1] Examinant le régime d’existence du « vouloir être tout pour lui », elle souligne que « s’il “ne peut pas se passer d’elle”, […] elle tire de là son propre prix » [2]. Mais là où Simone de Beauvoir interroge la façon dont la femme devient une victime volontaire de l’amour, Lacan va donner un autre fondement à ce rapport à l’amour.
Pourquoi on ne le devient pas
Lacan a commencé par répondre à l’auteure du Deuxième Sexe en 1956 en reprenant la question du « devenir femme » pour la subvertir. Là où Simone de Beauvoir disait « on ne naît pas femme : on le devient » [3] pour faire valoir un assujettissement à une condition imposée par la civilisation, Lacan, depuis la perspective de la névrose hystérique, s’intéresse à un autre sens du « devenir » en s’appuyant sur Freud. Ce n’est pas tant qu’on ne naît pas femme, c’est qu’on ne le devient pas non plus, et c’est parce qu’on ne le devient pas qu’on s’interroge. « La métaphysique de sa position est le détour imposé à la réalisation subjective chez la femme. Sa position est essentiellement problématique, et jusqu’à un certain point inassimilable. » [4] Lacan montre que l’identification féminine peut être en impasse. Le sujet s’identifiant alors à un homme s’interroge de cette façon sur ce que c’est que d’être une femme. Le rapport à la féminité prend alors la tournure d’un rapport à l’Autre femme. Ne pas devenir femme, c’est en passer par son moi, pour poser la question de ce qu’est cet être qui suscite le désir d’un homme.
Pas de deuxième sexe
La seconde réponse à Simone de Beauvoir se trouve dans le Séminaire XIX en 1971-1972, où Lacan affirme qu’il n’y a pas de deuxième sexe : « les sexes sont deux, quoi qu’en pense un auteur célèbre, qui, dans son temps, […] avait cru devoir en référer à moi avant de pondre Le Deuxième Sexe. […] Il n’y a pas de deuxième sexe à partir du moment où entre en fonction le langage » [5]. Pas de deuxième sexe, est une façon de dire deux choses : d’une part, dès qu’on parle, il n’y a que la référence au phallus pour les deux sexes, d’autre part, il n’y a pas un premier et un second. En somme, il n’y a pas d’ordre, de hiérarchie. En revanche, il y a « une forme fétichiste et une forme érotomaniaque de l’amour » [6]. L’un jouit d’une partie du corps de l’Autre, l’autre jouit de se croire aimée. C’est eu égard à la valeur que prend pour une femme le « devenir autre à elle-même » lorsqu’elle se croit aimée qu’« il n’y a pas de limites aux concessions » [7] que chacune peut faire au nom de l’amour.
L’en soi de la femme
Enfin, la troisième réponse à Simone de Beauvoir se trouve dans le Séminaire XVIII et elle concerne la lettre. Je l’inscris comme troisième réponse d’un point de vue logique et non chronologique, car elle me semble aller plus loin sur la question de la jouissance féminine que la précédente. « L’en soi de “La femme”, comme si on pouvait dire toutes les femmes, La femme, j’insiste, qui n’existe pas, c’est justement la lettre – la lettre en tant qu’elle est le signifiant qu’il n’y a pas d’Autre, S (A barré). » [8]
Cette assertion complexe et surprenante, je tiens qu’elle est aussi une réponse à Simone de Beauvoir en tant que Lacan y manie de façon inattendue la catégorie sartrienne d’« en soi » que Simone de Beauvoir a introduit dans Le Deuxième Sexe pour penser la condition des femmes. Se servant de l’opposition sartrienne entre l’en soi et le pour soi, elle défend la nécessité pour la femme de ne plus exister uniquement comme objet, mais d’être pour soi, soit d’accéder à sa propre liberté. Lacan fait valoir à l’envers l’en soi, comme étant du registre de la lettre. Que veut-il dire par là ? Tout d’abord, il n’y a pas de femme en soi, au sens où « [i]l n’y a pas La femme » [9]. Le registre du signifiant échoue à répondre au niveau de l’universel à la question « qu’est-ce qu’être une femme ? » Ensuite, il n’y a pas pour autant de femme pour soi au sens où l’expérience de la jouissance féminine, « jouissabsence » [10], la fait absente à elle-même. Le registre de la jouissance féminine est une réponse au niveau du corps à ce qu’il n’y a pas au niveau du sens. Si la jouissance féminine est une dimension exclue « par la nature des choses qui est la nature des mots » [11], il est néanmoins possible d’en cerner quelque chose depuis le registre de la lettre, au niveau de cet en-soi, de ce « seskecé » [12] qui la fait Autre à elle-même. La lettre est ce qui nous conduit aux confins de ce territoire de la jouissance, entre insu et éprouvé pur. La perspective lacanienne éclaire donc de façon inédite ce que Simone de Beauvoir notait comme le dévouement de la femme à la cause de l’amour. Dans ce dévouement, Lacan voit plutôt une folie dont il tente de percer l’énigme en frayant la voie de la jouissance féminine. Cette expérience ne relève pas tant d’un régime de soumission à des normes, que d’une modalité de jouissance désobéissant à toute emprise normalisante.
Clotilde Leguil
____________________
[1] Beauvoir (de) S., Le Deuxième sexe, t. II, « L’expérience vécue », Troisième partie, chapitre XII, Paris, Gallimard, 1949, p. 477.
[2] Ibid., p. 496.
[3] Ibid., p. 13.
[4] Lacan J., Le Séminaire, livre III, Les Psychoses, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1981, p. 200-201.
[5] Lacan J., Le Séminaire, livre XIX, … ou pire, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2011, p. 95.
[6] Lacan J., « Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine », Écrits, Seuil, 1995, p. 733.
[7] Lacan J., Télévision, Paris, Seuil, 1974, p. 63.
[8] Lacan J., Le Séminaire, livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, p. 108.
[9] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 68.
[10] Lacan J., Le Séminaire, livre XIX, … ou pire, op. cit., p. 121.
[11] Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, op. cit., p. 68.
[12] Ibid., p. 33.