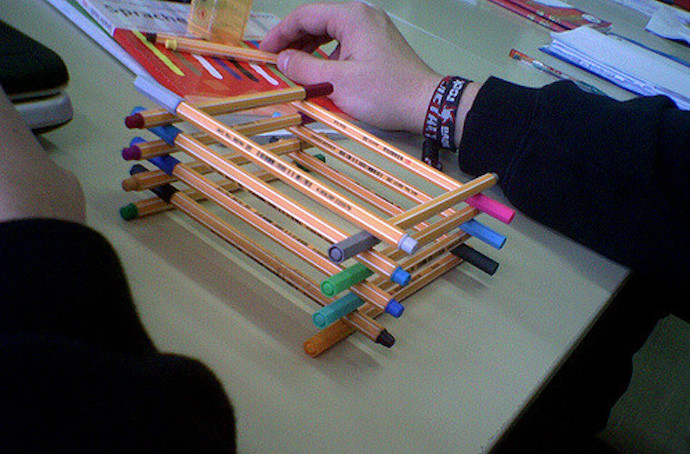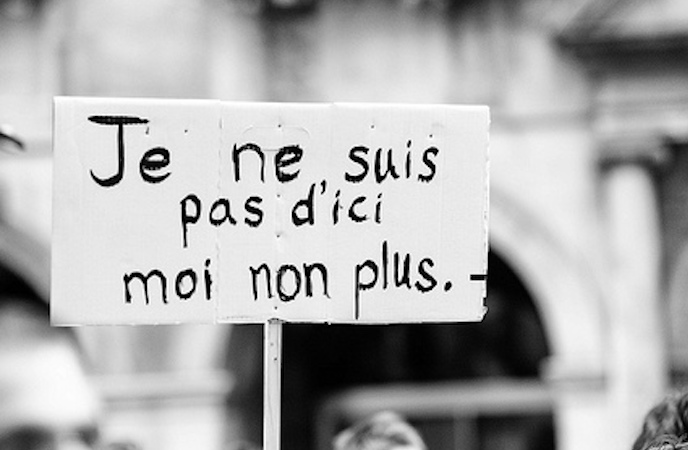La table ronde « Parole d’enseignants », que j’anime avec Eric Zuliani, est centrée sur une question éminemment politique : celle du décrochage scolaire des jeunes. Trois femmes sont invitées à y prendre la parole. Véronique Paillusson et Sophie Poilane, enseignantes dans un lycée Nantais, ont participé à la création de la cellule de lutte contre le décrochage scolaire, mise en place depuis trois années dans ce lycée. C’est le seul lycée Nantais à avoir mis en place un tel dispositif. Celui-ci prend appui sur le désir décidé de l’équipe pédagogique de ne pas laisser les élèves disparaître du lycée et de leur redonner l’envie de venir. Cette cellule implique tous les acteurs professionnels de l’établissement puisqu’il est proposé aux enseignants d’être attentifs à des signes – différents pour chaque jeune – de décrochage scolaire.
Maître Isabelle Oger Ombredanne, avocate au barreau d’Angers et présidente de l’association judiciaire Angevine des droits de l’enfant (AJADDE), nous parle des questions rencontrées dans sa pratique : parmi les jeunes qu’elle défend, la plupart d’entre eux se trouvent en situation de décrochage scolaire.
Lors de cette table ronde, nous pouvons entendre les inventions mises en place pour donner à certains jeunes l’envie de renouer avec l’école. Toutes les trois savent transmettre ce qui les guide dans leur pratique, ce qui les anime et leur sert de boussole. Nous pouvons entendre qu’il n’y a pas de « profil type du décrocheur scolaire ». Ce que ces enseignantes repèrent c’est que l’école représente pour ces jeunes l’angoisse de ce qui est inconnu.
Il n’y a pas non plus de protocole de dépistage de décrochage valable pour tous les jeunes. Les enseignants essayent de déchiffrer ces signes en fonction de l’histoire qu’ils ont avec chaque jeune. Ils essayent de repérer ce qui change, ce qui est inhabituel dans l’attitude d’un jeune : tel jeune ne se lève plus, tel autre s’endort, un tel n’a plus d’amis, un autre n’emmène plus ses affaires, ect… Ce ne sont pas les mêmes critères pour tous, mais un dispositif d’alerte est pensé, qui prend notamment pour boussole la relation à l’autre : l’isolement indexe une difficulté dans la relation aux pairs, l’insolence une difficulté dans la relation à l’autorité. « Cela s’inscrit dans une histoire avec l’élève, on les connait, on voit s’ils changent, ce ne sont pas des critères « objectifs » de décrochage. »
Cette cellule est un appui pour ne pas laisser le jeune isolé. Lorsqu’un élève est dépisté, il est présenté à la commission qui l’étudie pour voir, au cas par cas, quelle réponse apporter. Vigilants à ne pas faire peser sur le jeune le poids de « réussite scolaire », il n’y a pas d’ambition autre que celle que le jeune reste à l’école. À la place de la volonté de réussite, il y a le désir que ces jeunes retrouvent du plaisir à venir à l’école. « Penser que l’école peut les faire rire, certains élèves ne l’ont pas intégré. » L’école n’est pas, pour ces jeunes, ce « jeu de vie » [1] dont Freud soulignait être la mission première du lycée en « éveillant l’intérêt pour la vie à l’extérieur dans le monde ».
L’équipe pédagogique essaye de comprendre le pourquoi du décrochage et organise la mise en place d’un tutorat afin que l’élève se sente attendu par quelqu’un. « L’engagement : avoir rendez-vous avec quelqu’un, c’est vraiment ce qui compte. Cela apporte une dimension humaine. »
Plutôt que d’utiliser les instances de discipline ou la sanction, le pari qui est fait est d’utiliser le dialogue, afin de transformer l’obligation en désir. « Ces élèves qui ont un passé compliqué avec l’école, ont l’impression de ne pas avoir leur place à l’école, ils ne respirent pas, ils étouffent. »
L’avocate, maître Oger Ombredanne, souligne le précieux de ce dispositif, déplorant qu’il ne soit pas plus répandu. Elle constate en effet que tous les jeunes délinquants sont des jeunes inoccupés, qui ne vont plus à l’école et s’ennuient. La justice aurait les moyens de les raccrocher en disant : « « Ma sanction c’est que tu retournes à l’école parce que ta place est là-bas. »
À la question : « Qu’est ce qui accroche ? », la réponse se déduit de l’énonciation sensible et percutante de ces trois femmes : en ayant la chance de rencontrer un désir décidé, un désir qui ne soit pas anonyme et qui fasse sa place à la singularité.
[1] Freud S., « Pour introduire la discussion sur le suicide », Résultats, idées, problèmes, tome I, Paris, PUF, p.132