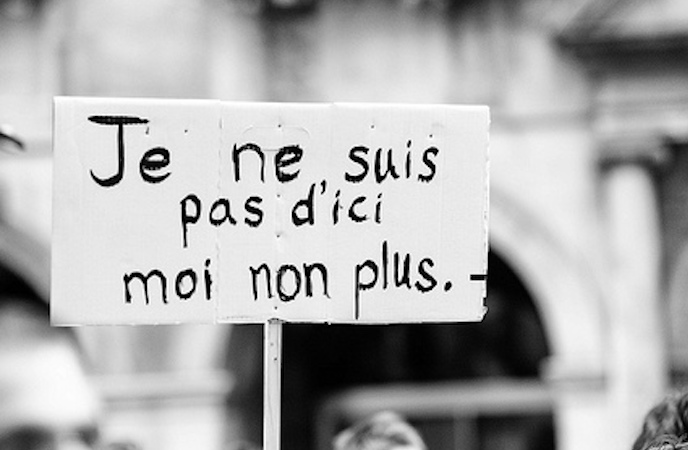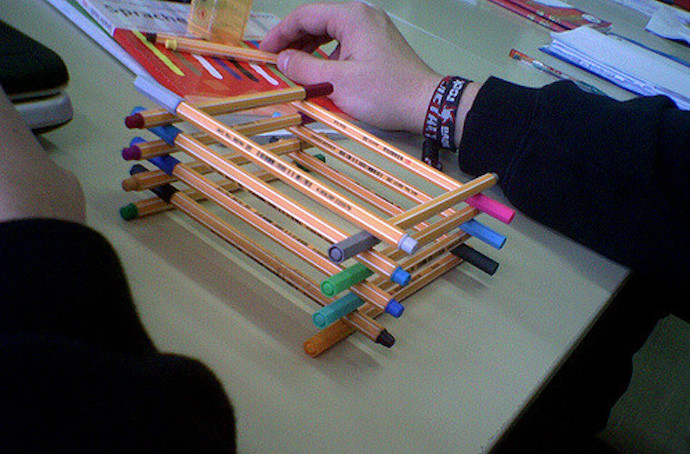Trois psychiatres hospitaliers, dont deux chefs de pôle, trois femmes, ont été invités à parler lors de La Semaine Lacan, à Nantes. Elles ont témoigné de leur travail difficile, en public pour la première fois. Elles ont eu le sentiment d’oser. D’oser dire, avec beaucoup d’humilité et de vérité, ce qu’elles avaient à dire, et ceci sans laïus ni revendication corporatiste : « C’est avec les patients les plus difficiles que l’on retrouve du désir et du plaisir à travailler. C’est comme cela qu’on se récupère. On est obligé d’inventer car ils ne se laissent enfermer dans aucun protocole. On ne peut pas faire autrement car à l’hôpital nous intervenons en dernier recours. »
Je rapproche leur énoncé d’un autre, saisissant de vérité également, cette fois à propos d’enfants et d’adolescents très difficiles, dit par une soignante en institution dans un moment compliqué de la vie du service : « Ces enfants-là ne me laissent pas faire ce que j’ai appris à faire, alors je suis tenue d’inventer ».
Un analyste apprend de sa propre analyse que le sujet est cette part de l’individu qui ne se laisse résorber par aucun discours universel, qu’il fait subversion, et que son symptôme est sa signature, sa règle, là où structurellement il n’y en a pas. Qu’il est fondamentalement inclassable. En tant que parlêtre en effet il s’avance toujours singulièrement, car son mode de vie, sa douleur d’exister, sa jouissance, sont régis par son symptôme ; et ce dernier est unique.
Le patient auquel les psychiatres ont affaire à l’hôpital est un corps vivant très souffrant. Il se tait ou il parle, il crie, hurle ; parfois il agit dangereusement, quand il s’avance sans boussole, ni névrotique, ni délirante, sans même un symptôme distinguable venant condenser sa jouissance et le situer dans le monde.
Poursuivons avec le propos de nos psychiatres : « C’est avec les patients les plus difficiles que l’on retrouve du désir et du plaisir à travailler ensemble ». Le seul recours, disent-elles, est de se réunir, de se mettre à plusieurs. La responsabilité de chacun des soignants est alors, de sa place, de faire part, d’épeler, ce qu’il a saisi, entendu, lu chez ce patient hors classe. Elles disent qu’ainsi un lien de travail précieux s’est établi entre les soignants dans leurs services, lien qui n’efface pas les différences de statuts, mais qui fait se croiser des points de vue et des styles différents. « Le travail à plusieurs nous permet de rester vigilant à nos valeurs ». Elles font remarquer en effet que cela ne va pas sans bénéficier aux patients plus aisément « classables », plus classiques. Dans chacun de ces deux services l’orientation analytique se fait pragmatique, discrète mais pertinente, incarnée par quelques uns dans le quotidien.
Faut-il donc toujours un inclassable, plus radicalement inclassable que les autres, pour maintenir en éveil ? Surtout quand la mission de service public, avec la lourde responsabilité qu’elle implique, avec son inévitable recherche du protocole, la course oppressante après le temps, tend à niveler la curiosité de chacun des acteurs, à la conformer, à l’endormir, à réduire le désir au fonctionnement ! « Heureusement qu’il y a des patients retords ! On retrouve la singularité quand c’est compliqué, quand ça bloque, et qu’on se dit : comment on va faire ? »
Nos psychiatres nous disent qu’il faut ce forçage pour échapper à la routine, pour que la clinique redevienne suffisamment fine et qu’au-delà d’elle on obtienne un aperçu du singulier pour lui donner toute sa valeur et sortir de l’impasse !
Qu’en est-il quand ça explose dans un service de psychiatrie, quand la peur s’installe et dure, que le silence des soignants devient la chape de plomb sous laquelle la souffrance se terre ? Plus la scène soignante devient intenable, plus le passage à l’acte vient répondre au passage à l’acte.
Une remarque : les psychiatres, parce qu’eux en ont la possibilité, de plus en plus se tournent ailleurs, fuient l’hôpital. Pas tous. Heureusement. La preuve.