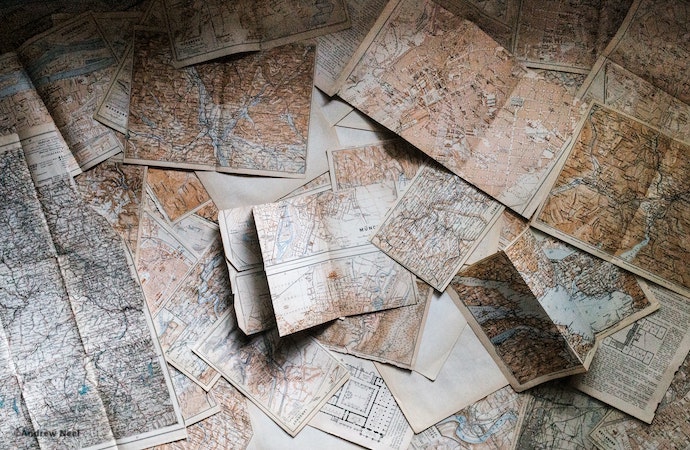Dans l’une de ses toutes premières élaborations sur la psychose, Freud aborde le phénomène de l’hallucination verbale comme un phénomène de discours.
Dans son « Manuscrit H. » du 24 janvier 1895 intitulé « Paranoïa » [1], Freud rapproche obsession et paranoïa, parce que ces affections lui apparaissent toutes deux comme des perturbations intellectuelles. Il définit la paranoïa comme un mode pathologique de défense au même titre que l’hystérie ou la névrose obsessionnelle. Si le sujet devient paranoïaque, c’est parce qu’il ne peut pas supporter certaines choses, mais à condition d’avoir des dispositions particulières, et la question est de savoir en quoi consiste cette spécificité qui conduit à la paranoïa.
Freud commente un cas de paranoïa, celui d’une demoiselle persécutée par ses voisins qui faisaient des allusions sur sa conduite sexuelle et jasaient sur une tentative de séduction dont elle avait été l’objet de la part d’un de ses locataires. Freud rattache les troubles à cette scène, mais il échoue dans sa tentative de la rendre consciente et de la faire admettre à la patiente. Il conclut à une défense, mais dont le contenu, l’incident sexuel, n’est en lui-même nullement spécifique. Il aurait pu tout aussi bien aboutir à un symptôme hystérique ou à une obsession. Il s’agit donc de caractériser le mode propre de la défense paranoïaque.
La patiente, troublée par l’incident sexuel, tentait d’échapper au reproche d’être « une mauvaise femme ». Mais, indique Freud, ce reproche elle l’entendit du dehors et il précise que le contenu du reproche resta identique, seule sa place changea. Au début le reproche était intérieur, et maintenant il lui venait du dehors. Le jugement porté sur elle, lui arrivait de l’extérieur. Les gens disaient ce qu’elle se serait, sans cela, dit à elle-même. De cela, elle tirait profit. Elle aurait été obligée d’accepter un jugement formulé intérieurement alors qu’elle pourrait aussi bien rejeter celui qui lui venait de l’extérieur. Notons les caractères de cette défense paranoïaque tels que les isole Freud :
– Elle porte sur un jugement ;
– mais il ne s’agit pas de n’importe quel jugement, il s’agit d’un jugement moral concernant la conduite sexuelle du sujet ;
– elle consiste dans un déplacement topique de l’intérieur vers l’extérieur ;
– elle implique l’Autre, ce que le sujet ne peut assumer pour lui-même c’est l’Autre qui le lui dit.
Le sujet paranoïaque se défend en repoussant à l’extérieur une représentation inconciliable avec le moi. Deux questions se posent alors :
– Comment se produit un tel déplacement ?
– Se joue-t-il la même chose dans tous les cas de paranoïa ?
Concernant la nature du déplacement, il s’agit, selon Freud, de l’usage abusif d’un procédé psychique ordinaire, celui du transfert ou de la projection. D’une manière générale, le sujet peut assumer lui-même ses propres pensées ou sentiments, mais il arrive couramment qu’il laisse à l’autre la responsabilité de les reconnaître chez le sujet, ou bien il les lui attribue. C’est en cela que consiste l’idée normale d’être observé, ou la projection normale. La projection est un mécanisme psychologique courant, qui se déploie dans la relation imaginaire au semblable, et qui peut se rencontrer chez n’importe quel sujet. En elle-même, elle ne peut permettre de rendre compte de la formation du symptôme paranoïaque.
La projection n’explique donc pas la paranoïa. Aussi, Freud est-il amené à introduire un nouveau paramètre pour tenter de distinguer le phénomène psychotique. Pour caractériser le mode de défense paranoïaque, par rapport à la projection, il fait intervenir la structure du syllogisme, entendu dans son sens logique. L’infidèle peut être jaloux, parce qu’il attribue à l’autre sa propre conduite. Cette jalousie relève de la projection affective, tant que le sujet est en mesure d’établir un lien logique entre sa jalousie et son infidélité. Tant que la chaîne des arguments, qui conduisent de l’infidélité à la jalousie, peut être restituée, il s’agit d’une projection :
– Je suis infidèle ;
– je refuse d’assumer cette conduite, c’est sur elle que je la projette ;
– donc elle me trompe et je suis jaloux.
Telle est la structure du raisonnement, qu’il faut rétablir pour rapporter la jalousie à l’infidélité. Dans la paranoïa, cette chaîne argumentative est rompue. Freud écrit ceci : « ces réactions demeurent normales tant que nous restons conscients de nos propres modifications intérieures. Si nous les oublions, si nous ne tenons compte que du terme du syllogisme qui aboutit au dehors, nous avons une paranoïa ».
Ainsi de l’alcoolique jaloux : si elle le délaisse, c’est parce que c’est une traînée et qu’elle va avec tous les hommes. Il y a un raisonnement qui conduit à cette position et qui est le suivant :
– Elle me trompe ;
– je refuse d’admettre que c’est parce que je suis alcoolique et impuissant ;
– donc c’est une traînée.
Pour qu’il y ait paranoïa, il faut que cette chaîne discursive soit rompue et que la conclusion apparaisse détachée de ses prémisses. L’énoncé qui fait la plainte du patient – elle va avec tous les hommes – est une proposition délirante, parce qu’elle ne peut être rapportée à ses prémisses subjectives. C’est parce qu’elle est ainsi détachée du patient qu’elle apparaît comme venant du dehors et qu’elle est, éventuellement, attribuée à l’Autre. Tel est le mode particulier de la défense paranoïaque qui se rencontre dans tous les cas.
Lacan a mis ses pas dans ceux de Freud quand il rend raison de la psychose par la forclusion, c’est-à-dire par le rejet d’un signifiant, non de l’intérieur vers l’extérieur, mais du symbolique vers le réel, le réel du patient. Il donne alors sa définition de l’hallucination comme présence d’un signifiant dans le réel, et précise : « pour que [l’]irruption [du symbole] dans le réel soit indubitable, il suffit qu’il se présente, comme il est commun, sous forme de chaîne brisée » [2].
[1] Freud S., « Manuscrit H. », Lettres à Wilhem Fliess, Paris, PUF, 2006, p. 140-147.
[2] Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 535.