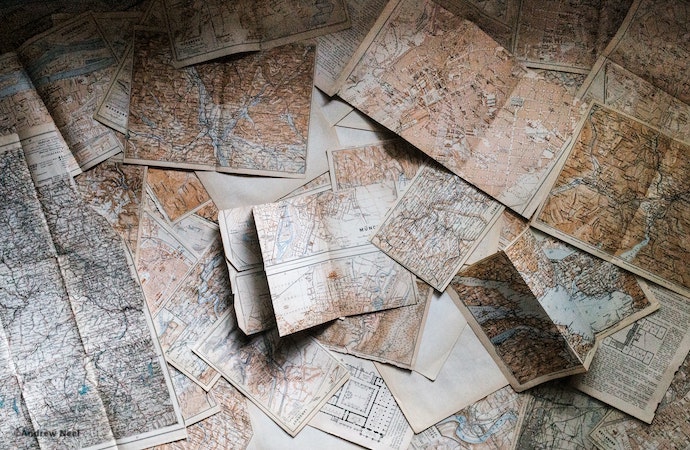En ces temps bouleversés, l’angoisse – cet affect qui ne trompe pas, tel que Lacan l’a élucidé en tant qu’impossible à supporter, désarrimé des signifiants – est au premier plan, faisant signe du réel sans loi.
Des tragédies antiques aux théories de Freud et de Lacan, l’expérience de l’angoisse, toujours chevillée au corps, est indissociable de la condition humaine, aussi n’a-t-elle jamais cessé d’intéresser penseurs, artistes, écrivains et poètes.
Avec l’angoisse, conceptualisée par Freud puis Lacan, ce n’est pas l’être qui est convoqué, ce n’est ni le sens ni la signification, c’est l’existence du parlêtre. Ces quelques considérations invitent à un retour à la toute première conceptualisation de l’angoisse en psychanalyse par Freud dans laquelle il noue le corps et le psychisme. C’est dans le « Manuscrit E. » de ses Lettres à Wilhelm Fliess [1], écrites entre 1887 et 1904, qu’il s’attelle à la théoriser à partir de cette question : comment naît l’angoisse ? Rappelons que dans l’amour qu’il voue à W. Fliess, son alter ego, Freud s’autoanalyse, ce qui fait de cette correspondance la chronique de l’invention de la psychanalyse.
Au début de sa découverte, Freud, en explorateur, met au travail sa clinique en opérant par la classification de la science médicale de son temps où l’observation clinique oblige à la différenciation sur la nature et la cause des pathologies.
D’ailleurs, dans ce manuscrit, il fera de l’angoisse le noyau d’une névrose qu’il nommera névrose d’angoisse en la distinguant, d’une part, de l’hystérie et, d’autre part, de la mélancolie.
Dès les toutes premières lignes du texte, Freud indique que l’angoisse des névrosés est imputable à la sexualité et, en particulier, au coït interrompu, méthode de contraception à son époque.
D’une question ricochant sur une autre, il livre les fondements de la névrose d’angoisse.
L’angoisse apparaît dans le registre physique, elle échappe aux faits psychiques : « C’est un facteur physique de la vie sexuelle qui produit l’angoisse » [2]. Pour étudier ce facteur, Freud recueille des observations cliniques « disparates » de sept types d’angoisse qui, chez les sujets observés, semble avoir une cause sexuelle et dont il tire un premier enseignement : l’angoisse découle d’une transformation de la tension sexuelle accumulée et dont la décharge est entravée.
Ceci le conduit à une nouvelle question : « mais pourquoi, quand il y a cette accumulation, la transformation en angoisse ? » [3]
Il établit alors une comparaison entre la névrose d’angoisse et la mélancolie pour en dégager, dans la première, la tension sexuelle physique. Cette dernière « s’accroît, atteint sa valeur-seuil » qui permet de susciter un affect psychique mais, pour une raison quelconque, il y a « un déficit d’affect sexuel, de libido psychique » [4], ce qui provoque la transformation de la tension non psychiquement liée en angoisse. Et, pour vérifier son hypothèse, Freud réexamine les sept cas mis à l’étude au départ, ce qui lui permet de dire que sa recherche se tient.
Dans la dernière partie du manuscrit, une ultime question se fait jour : pourquoi la transformation génère-t-elle de l’angoisse ?
Freud indique que l’angoisse répond à n’importe quelle tension physique accumulée, ignorant la libido psychique.
Dans les symptômes du tableau clinique de la névrose d’angoisse, il met le focus sur « le grand accès d’angoisse », accès fait de dyspnée et de palpitations cardiaques, lesquelles sont aussi celles du coït, et qui se combinent avec la sensation d’angoisse.
Pour clore sa lettre, il revient à sa comparaison de départ entre la névrose d’angoisse et l’hystérie, qui ont comme point commun une conversion, mais, dans cette fin du manuscrit, il met en exergue leur différence. Dans l’hystérie, il s’agit d’une excitation psychique qui se traduit dans le somatique, tandis que dans la névrose d’angoisse, il s’agit d’une tension physique qui peut se traduire dans psychique.
En guise de conclusion, Freud écrit que sa recherche est incomplète, mais que la base est juste – pour autant ce travail n’est pas publiable en l’état.
La surprise à relire le « Manuscrit E. » conduit son lecteur à dire combien, grâce aux prémices de Freud concernant le concept de l’angoisse, l’analyste lacanien, qui fait du réel sa visée, se sert de l’angoisse comme d’un moteur de l’expérience analytique pour que d’un dire émane le parlêtre.
[*] Freud S., « Manuscrit E. » Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904, Paris, PUF, 2006, p. 103.
[1] Ibid., p. 103-109.
[2] Ibid., p. 103.
[3] Ibid., p. 105.
[4] Ibid., p. 106.